Lorsqu’on évoque le capitalisme, on n’est jamais très loin de la confusion. C’est pourquoi l’ouvrage dirigé par Tom Palmer apporte une contribution utile, afin de mieux cerner ce qu’est le capitalisme, et en quoi on ne peut le dire immoral.
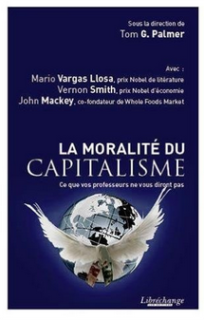 Les professeurs sont loin d’être omniscients et peuvent même parfois effectuer des choix arbitraires, guidés par le respect des programmes ou influencés par les sources ou manuels utilisés, ou tout simplement en se laissant emporter, consciemment ou inconsciemment, par leurs affinités intellectuelles ou convictions intimes.
Les professeurs sont loin d’être omniscients et peuvent même parfois effectuer des choix arbitraires, guidés par le respect des programmes ou influencés par les sources ou manuels utilisés, ou tout simplement en se laissant emporter, consciemment ou inconsciemment, par leurs affinités intellectuelles ou convictions intimes.
C’est pourquoi Tom Palmer, l’auteur de ce passionnant recueil réunissant les contributions de différents auteurs, à travers interviews ou présentation d’essais, ajoute le sous-titre suivant :« Ce que vos professeurs ne vous diront pas ». Une manière de suggérer que le « récit » qui est fait classiquement du capitalisme n’est pas toujours conforme à celui que l’auteur a le sentiment d’observer et qu’il aimerait partager avec le plus grand nombre.
Qu’est-ce que le capitalisme ?
« Le terme « capitalisme » se réfère non seulement aux marchés où sont échangés des biens et services et qui ont existé depuis des temps immémoriaux, mais au système d’innovation, de création de richesses et de changement social qui a apporté à des milliards d’êtres humains une prospérité qui était inimaginable pour les générations précédentes. »
Pour bien exprimer l’idée que le capitalisme ne saurait se limiter au champ économique et en référence au marché, Tom Palmer en donne la définition suivante :
« Le capitalisme est un système juridique, social, économique et culturel qui embrasse l’égalité des droits et les « carrières ouvertes au talent », qui dynamise l’innovation décentralisée ainsi que les processus d’essais et erreurs, ce que l’économiste Joseph Schumpeter appelait la « destruction créatrice », à travers des processus volontaires d’échange marchand. »
Il récuse, au passage, la vision « matérialiste » d’un capitalisme tourné en dérision « par des philosophes (notamment marxistes) qui sont eux-mêmes adeptes du matérialisme », pour lui préférer une vision bien plus positive, en faisant « en son cœur une entreprise spirituelle et culturelle ».
Mieux encore, « loin d’être une arène amorale où s’affrontent les intérêts, comme est souvent dépeint le capitalisme par ceux qui cherchent à le saper ou à le détruire, l’interaction capitaliste est fortement structurée par des normes éthiques et des règles.
En effet, le capitalisme repose sur un rejet de l’éthique du pillage et de l’accaparement, c’est-à-dire le moyen par lequel la plupart des richesses dont jouissent les riches ont été acquises dans d’autres systèmes économiques et politiques. »
Tom Palmer inclut dans ces autres systèmes ce que l’on appelle aujourd’hui le capitalisme de connivence et que lui dénomme « capitalisme de copinage », qui ne saurait s’apparenter au « capitalisme de libre marché » dont il est question ici.
Une confusion d’origine marxienne dont le préjudice continue de peser sur l’usage même du terme capitalisme, nuisant à la réalité de son essence. Si le capitalisme de copinage est malheureusement fort répandu dans nos sociétés contemporaines, il est tout à fait étranger au capitalisme tel que nous pouvons le concevoir. Il correspond à un enrichissement de certaines personnes par le simple fait de détenir du pouvoir politique ou d’être proches de relations qui en détiennent.
Autrement dit, il s’agit de personnes qui détiennent des privilèges et ne tirent pas leur richesse directement d’une quelconque génération de valeur, mais plus d’une forme de lobbying ou d’accointance avec le pouvoir leur assurant des subsides obtenus grâce à l’argent des contribuables, sans que leur seul mérite y ait conduit. On n’est pas très loin de la corruption, même si ici l’argent obtenu l’est de manière légale. Ce qui ne va pas sans ternir l’image d’un capitalisme qui, par nature, ne saurait s’y assimiler.
Relevant l’hostilité souvent affichée au capitalisme de libre marché par des élites bien établies, Tom Palmer met en avant les formes de liberté engagées dans ce mouvement dynamique seul à même d’éliminer la pauvreté. À ce sujet, il a la réflexion suivante :
« La pauvreté est ce qui résulte lorsque la production de richesse n’a pas lieu, alors que la richesse n’est pas le résultat de la production de pauvreté qui n’a pas lieu. »
Une phrase que d’aucuns feraient bien de méditer…
Les vertus du capitalisme entrepreneurial
Un entretien réalisé auprès d’un entrepreneur, John Mackey, permet de démentir l’idée selon laquelle un tel acteur ne serait mu que par son seul intérêt personnel ou la recherche du profit.
À l’instar d’autres professions (médecins, professeurs, etc.), John Mackey affirme l’idée selon laquelle les entreprises poursuivent très souvent un but supérieur.
Se référant à sa propre entreprise, leader américain dans le domaine de l’alimentation bio, le traitement éthique des animaux et l’implication sociale des entreprises, à travers notamment le développement du microcrédit en direction des populations pauvres dans le monde, il indique avoir créé 10 milliards de dollars de valeur en partant de rien ; ce qui a bénéficié à la fois à ses clients, mais aussi, comme il le démontre, à ses employés, fournisseurs, investisseurs, ainsi que les quartiers où Whole Foods Market est présent.
Lui-même ne s’est accordé ni salaire, ni bonus ou stock-options depuis cinq ans, s’estimant suffisamment riche par la détention d’actions de son entreprise et préférant consacrer cet argent qu’il serait en droit de réclamer aux populations qu’il souhaite aider.
Par là-même, il entend défendre un ensemble de valeurs, parmi lesquelles tenter d’éradiquer la pauvreté autour de la planète. Des valeurs qui nécessitent forcément le dégagement de profit, consubstantiel au capitalisme et à la libre-entreprise, seuls à même de pouvoir investir et créer davantage de valeur encore, pour le bien des buts supérieurs défendus.
C’est ainsi, rappelle-t-il à juste titre que, loin de renforcer les inégalités comme certains veulent le faire croire, le capitalisme a permis de réduire de manière spectaculaire l’extrême pauvreté et pourrait l’éradiquer presque totalement dans un proche avenir.
« L’extrême pauvreté a été le trait dominant de la condition humaine normale pour la plupart des hommes à travers toute l’histoire. Les êtres humains étaient tous également pauvres et avaient une vie assez courte. Deux cents ans en arrière, 85% de la population vivant sur la planète Terre vivaient avec moins d’un dollar par jour en dollars d’aujourd’hui – 85% ! Ce chiffre s’élève à seulement 20% aujourd’hui et d’ici la fin de ce siècle, il devrait être quasiment nul. »
Comme il le montre également, c’est là où le capitalisme de libre marché n’a pas été adopté que la pauvreté est demeurée.
Et lui aussi se dresse contre le capitalisme de copinage, irrespectueux de l’état de droit par les privilèges qu’il accorde aux uns et non aux autres. Ce qui peut passer simplement par exemple par des subventions ou redistributions accordées, y compris aux États-Unis, généralement en contrepartie de faveurs politiques, ce qu’il juge parfaitement immoral.
Puis, Tom Palmer nous présente un essai d’une historienne de l’économie, Deirdre N. McCloskey, qui remet en cause les analyses traditionnelles, qu’elle qualifie de « matérialistes », de la révolution industrielle (analyses qui incluent les thèses basées sur l’impérialisme ou l’esclavagisme aux États-Unis).
Le monde capitaliste moderne serait, en réalité, le fruit d’une évolution des mentalités (dans un sens favorable aux idées libérales) qui, seule, a permis de créer les conditions favorables à son avènement. Ce sont les évolutions dans les manières de penser, de considérer le commerce, l’innovation, les entrepreneurs, ou même l’existence de riches, qui ont permis de favoriser un processus de destruction créatrice ayant entraîné les bouleversements que nous avons connus et l’enrichissement du plus grand nombre (elle aussi rappelle la réalité de la faiblesse des revenus moyens sur toute la planète encore en 1800 en comparaison de ce que nous connaissons aujourd’hui).
C’est donc grâce à la dignité et la plus grande liberté accordée aux gens, en particulier aux classes moyennes, que nous avons pu connaître des transformations aussi radicales dans tous les domaines, y compris espérance de vie, éducation, modes de vie et manière de penser. Et que la pauvreté a pu reculer de manière aussi spectaculaire.
L’ouvrage se poursuit par la présentation d’un autre ouvrage, cette fois de David Boaz, vice-président exécutif de l’Institut Cato, mettant en valeur la relation étroite entre concurrence et coopération, trop souvent opposées.
Il s’insurge en particulier contre les caricatures qui sont parfois faites de la concurrence, y compris par des personnes qui lui sont a priori plutôt favorables, comme l’investisseur George Soros, à travers des qualificatifs tels que concurrence « effrénée », « dommageable », ou « meurtrière » ou encore des expressions comme « survie du plus fort ». Alors même « que le marché est en réalité de la coopération ».
De même, les libéraux sont souvent attaqués sur la notion d’individualisme, malheureusement totalement déformée dans la caricature qui en est faite. David Boaz, s’appuyant sur les écrits d’auteurs anciens tels que Locke, A.Smith, ou Hume, mais aussi sur d’autres plus contemporains comme Hayek, Mises ou Murray, entre autres, montre que l’individualisme repose sur l’état de droit, le contrat, et la nécessaire coopération sociale liée à la nature humaine, personne ou presque ne pouvant vivre totalement en autarcie.
Par nature, le marché est donc de la coopération. Il s’inscrit dans la nécessaire société civile, structurée autour de la division du travail.
« Les détracteurs des marchés se plaignent souvent du fait que le capitalisme encourage et récompense l’intérêt personnel. En fait, les gens poursuivent leur intérêt personnel dans n’importe quel système politique. Les marchés canalisent leur intérêt personnel dans des directions socialement bénéfiques. »
– Tom Palmer évoque ensuite un ouvrage qu’il a lui-même écrit, relatif à la médecine à but lucratif, dont il entend démontrer que, contrairement à l’intuition qu’on pourrait avoir, incite davantage à la compassion, la bienveillance et la courtoisie que dans un cadre public où des valeurs communes ne sont pas forcément partagées. Paradoxalement, la notion de profit peut y avoir une influence très positive, à rebours de ce que d’aucuns pourraient penser spontanément.
Interaction volontaire et intérêt personnel
À travers un essai portant sur le paradoxe de la morale, l’économiste, intellectuel et entrepreneur social Mao Yushi, grande figure du libéralisme, tirant parti des expériences désastreuses de la Chine lorsqu’elle a voulu abolir le capitalisme en son sein, explique le rôle joué par les marchés dans la réalisation de la coopération et de l’harmonie, démontant les fantasmes des détracteurs du capitalisme.
Se basant sur quelques exemples concrets, il montre la fatuité de certains raisonnements moralisateurs issus de l’utopie et la propagande du Parti Communiste Chinois où les prix et la monnaie seraient bannis. Les effets pervers qui en découleraient aboutiraient à un résultat inverse de celui recherché.
L’allocation des ressources, la création de valeur, l’efficacité de la société et les bénéfices humains sont ainsi considérablement plus efficaces par la recherche de l’intérêt personnel, propre à la nature humaine quoi qu’on en pense, au libre-marché, à l’échange et la recherche des prix bas et du profit qui y sont liés.
Ainsi, durant la Révolution culturelle, les comportements opportunistes se sont développés sur le terreau de la propagande, comme il le montre, révélant des contradictions flagrantes avec les principes théoriques, là où le marché et la coopération sont mieux à même d’imaginer des solutions pertinentes à des conflits potentiels, entraînant une meilleure satisfaction de toutes les parties, comme il le développe à travers des exemples très concrets.
Cela ne va pas sans l’état de droit, à commencer par le droit de propriété. Si les inégalités existent, et existeront toujours, le vrai fléau tient dans les privilèges. L’égalité des droits, elle, offre la possibilité à chacun de s’enrichir et ce système, à l’arrivée, bénéficie incomparativement plus à l’ensemble de la société que dans une société où on érige les uns contre les autres, à travers la lutte des classes, entraînant des abominations comme il en décrit dans son texte.
– L’essai du philosophe russe Leonid Nikonov sur la logique morale de l’égalité et de l’inégalité dans la société de marché, montre l’incohérence de la plupart des critiques anti-capitalistes relatives aux revendications d’égalité.
Il montre que, à l’opposé de ce qu’affirment les tenants de l’échange inégal, l’inégalité est une condition de l’échange, « sans laquelle ce dernier n’aurait pas de sens ». Là encore, du point de vue des libéraux, c’est l’égalité des droits fondamentaux qui importe et l’échange n’a de sens que si la situation des deux parties s’améliore.
Dès lors, « l’économie de l’échange repose sur une reconnaissance que les parties qui échangent attachent des valeurs inégales aux biens et services ». Et c’est plus le résultat de l’échange qui est à considérer que l’idéal moral que l’on peut y attacher, sans souci du résultat, comme chez certains égalitaristes.
C’est pourquoi l’auteur tente de raisonner, à partir des réflexions millénaires des philosophes et des travaux plus récents, sur cette notion d’égalité, qui a des implications sur la redistribution forcée qui peut être envisagée par certains pour tenter de corriger une inégalité constatée. Seule l’égalité morale compte, en termes de droits, de justice et de comportement. Violer l’égalité morale dans le but de produire des résultats plus égalitaires est, en revanche, un problème moral.
Et comme en conclut l’auteur, « le plus grand scandale dans le monde en matière d’inégalité de richesse n’est pas l’inégalité entre les riches et les pauvres dans les sociétés économiquement libres, mais cet écart énorme entre la richesse des populations dans les pays économiquement libres et celle des populations dans les sociétés qui ne sont pas économiquement libres. » Ce qu’il montre à partir de données chiffrées très évocatrices.
– Tom Palmer présente ensuite un autre de ses essais, portant sur Adam Smith et le mythe de la cupidité. Un ouvrage dans lequel il combat le mythe, défendu par des personnes qui n’ont probablement pas lu davantage que certaines de ses citations, d’un Adam Smith naïf croyant que l’intérêt personnel pourrait créer la paix et la prospérité et qui encouragerait l’égoïsme, censé donner un monde meilleur.
Pour qui a déjà lu, par exemple, la théorie des sentiments moraux (que je vous présenterai ici prochainement), ces mauvaises interprétations n’ont pas de sens.
Il montre, au contraire, que l’intérêt personnel peut parfois aussi avoir des effets néfastes, mais qui peuvent être canalisés grâce à l’état de droit, la propriété, le contrat et l’échange, susceptibles de mener à l’intérêt mutuel, en s’intéressant aux intérêts et au bien-être des autres en même temps qu’on considère le sien, et probablement mieux que des politiques ou intellectuels qui, à l’instar de ce que Voltaire pouvait déjà dire de certains nobles pleins de mépris à l’égard des négociants, peuvent faire beaucoup de mal et rarement beaucoup de bien.
Ce qui fait dire à Tom Palmer que :
« les commerçants et les capitalistes ne doivent pas rougir quand nos politiciens et nos intellectuels contemporains les considèrent avec dédain et se pavanent en déclarant ceci et en décriant cela, tout en exigeant que les marchands, les capitalistes, les travailleurs, les investisseurs, les artisans, les agriculteurs, les inventeurs et les autres individus productifs créent la richesse que ces mêmes politiciens confisquent et que ces mêmes intellectuels anti-capitalistes supportent mal… mais consomment goulûment (…) Mais contrairement à la politique, le libre-échange entre participants consentants génère la richesse et la paix, qui sont les conditions dans lesquelles la générosité, l’amitié et l’amour s’épanouissent. »
Pour conclure cette deuxième partie, un ouvrage de David Kelley consacré à Ayn Rand et le capitalisme, est présenté, en tant que « révolution morale ».
Il s’agit pour l’auteur, directeur exécutif de la société Atlas, de montrer en quoi « le principe éthique selon lequel la capacité individuelle est un actif social est incompatible avec une société libre ».
Commençant par rappeler comment la crise des marchés financiers de 2008 a suscité « un torrent prévisible de sentiment anti-capitaliste », alors même que les réglementations publiques ont joué un rôle majeur dans cette crise, et que cela a entraîné une salve de nouvelles réglementations, interventions et revendications supplémentaires en faveur de la redistribution, il montre en quoi le welfarisme (et ses fameux « droits à ») et l’égalitarisme, dans leurs fondements, sont viciés par une vision qui mène au sacrifice de soi, au nom de la collectivité.
En effet, selon lui, « les critiques du marché ont toujours tiré profit de ces doutes sur la moralité du marché. Le mouvement socialiste a été soutenu par des allégations que le capitalisme engendre l’égoïsme, l’exploitation, l’aliénation, l’injustice. »
C’est ce qui a produit l’État Providence, le concept de justice sociale et l’éthique de l’altruisme, dont la conception lui paraît dangereuse, à l’instar de ce qu’Ayn Rand a pu analyser et qu’il développe ici.
La production et la distribution de la richesse
– Dans un essai portant sur l’économie de marché et la distribution de richesse, l’économiste allemand Ludwig Lachmann s’intéresse aux critiques de l’économie de marché du point de vue, là aussi, de la justice sociale, pour montrer comment le respect de la propriété est tout à fait compatible avec une redistribution massive des richesses par le marché.
Il s’attaque ainsi au déplacement de ces critiques du problème de l’efficacité vers celui de l’injustice dans la répartition des richesses, après que les premières aient clairement perdu de leur validité.
Et il montre que la création de richesses, et donc sa répartition, s’inscrit dans une dynamique évolutive, que n’intègrent pas dans leur raisonnement les partisans d’une redistribution étatique, souvent le fait de politiciens tournés vers leurs électeurs.
Suivant la même préoccupation, l’économiste sud-africain Temba A. Nolutshungu, s’appuyant sur l’histoire récente de son pays, montre comment les libertés politiques aussi bien qu’économiques génèrent le progrès économique et le progrès social.
Mondialisation du capitalisme
L’ouvrage suivant est celui de la femme d’affaires kenyane June Arunga, qui se base à la fois sur son expérience très concrète de femme de terrain et sur sa rencontre marquante avec Johan Norberg, dont elle admire la propension à écouter les gens, notamment les pauvres, et s’appuyer sur l’observation concrète, plutôt que de prêcher des idées toutes théoriques.
Elle entend défendre le capitalisme de libre-marché en Afrique, se basant sur les succès récents en matière de commerce entre pays africains, et lutter contre les privilèges accordés aux investisseurs étrangers ou élites locales, qui faussent le libre-marché et aboutissent dans certains cas à des monopoles de fait ; situations qui maintiennent les populations dans la misère, là où l’état de droit et le libre-commerce mènent au contraire à davantage de prospérité. Dans ce contexte, la mondialisation pourrait avoir des vertus, que le libre-marché est à même de favoriser.
Comme elle y insiste, « Notre prospérité en tant qu’Africains ne viendra pas de l’aide étrangère ou de l’argent facile. » Collusions, protectionnisme et autres absence de liberté de choix ou d’innover, sont qualifiés par elle de « plus grand crime à notre encontre ».
Prenant appui sur les travaux de l’économiste péruvien Hernando de Soto, elle montre que c’est le respect des droits de propriété, de l’état de droit et de la liberté de commercer qui permettront au « capital mort » de se transformer en « capital vivant » pour « améliorer nos vies ».
– La présentation se poursuit avec un essai de l’économiste et prix Nobel Vernon Smith sur la mondialisation en tant que vecteur de progrès humain. À l’instar de son homonyme du XVIIIème siècle, il met en évidence les vertus de la spécialisation, de l’échange et des marchés dans la création de richesse et le progrès humain durable. Ceci étant valable depuis toujours tant dans ses relations de proximité personnelle, où on cherche généralement à faire du bien aux autres, que dans les échanges impersonnels par le biais du commerce à longue distance entre étrangers, où la concentration sur son gain personnel n’en rend pas moins compatibles les avantages communs reçus par les différents protagonistes de l’échange.
Il montre ainsi que « le développement économique est lié à des systèmes politiques et économiques libres, alimentés par l’état de droit et les droits de propriété privée. » Il s’appuie notamment sur les exemples récents de la Chine, de la Nouvelle-Zélande ou encore de l’Irlande, pour montrer que partout où il existe des formes de libéralisation (même si cela n’a pas encore lieu sur un plan politique en Chine), cela a des effets positifs immédiats.
Le cas de l’Irlande, qui a connu un renversement historique de l’exode des cerveaux, est particulièrement intéressant (surtout pour nous, Français, qui connaissons depuis quelques années cette forme d’exode). Ce qui le conduit à être optimiste, en affirmant que « les histoires de ces peuples montrent comment les politiques malavisées des États peuvent être changées afin de créer de nouvelles opportunités économiques qui peuvent considérablement inverser la fuite des cerveaux d’un pays. »
Pour finir, Vernon Smith montre les bienfaits de la mondialisation, phénomène pacifique, à travers différents exemples concrets et études qui convergent à révéler que lutter contre les délocalisations d’entreprises de secteurs en déclin est non seulement vain (les concurrents d’autres pays qui le feront gagneront en compétitivité et financeront ainsi leur croissance future en investissant dans de nouvelles technologies qui précipiteront la perte de ceux qui l’auront refusé), mais privera le pays de retombées bien plus favorables.
Même si, certes, ces délocalisations sont dures à vivre pour ceux qui en sont victimes, en l’absence de réglementations publiques paralysantes (comme dans le cas de l’Allemagne), les retombées pour le pays sont en réalité conséquentes, parfois même bien plus encore (il cite le cas de Warren Buffet, qui avait racheté un fabricant de textile en plein déclin pour utiliser le cash flow qui lui a permis de rampe de lancement pour créer son immense empire créateur au final de très nombreux emplois, bien supérieurs en tous les cas à l’activité et aux emplois perdus du fait de la délocalisation subie.
– Enfin, nous sommes invités, avec Mario Vargas Llosa, à nous intéresser à la culture de la liberté. Le constat que fait le Nobel de littérature est que, au-delà de l’économie, c’est bien plus encore dans le domaine de la culture que les adversaires de la mondialisation se distinguent en faisant craindre une uniformisation autour de la (sous-)culture américaine et leur fameuse « malbouffe ».
Le cas de la France (honte à nous) est particulièrement mis en avant par l’écrivain péruvien, qui fait référence à notre défense de l’exception culturelle française, notre José Bové national, et autres luttes contre les anglicismes ou toute forme de…
Pour Mario Vargas Llosa, le rapprochement des manières de vivre, du vestimentaire ou des manières de s’alimenter sont bien réels, mais la mondialisation n’en est qu’un effet, non une cause. On peut être nostalgique des temps passés, mais à moins de vivre dans l’isolement total et l’autosuffisance, nous dit l’écrivain, ce processus est absolument inéluctable, quel que soit l’endroit de la planète. Elle est surtout le fait de la liberté de choix des peuples.
Mis à part les petites communautés primitives magico-religieuses, remarque-t-il, aucun peuple n’a d’ailleurs conservé une culture restée identique et inchangée au fil du temps. La culture n’est donc pas quelque chose de figé. Quelques exemples issus de nos propres sociétés sur le seul siècle dernier lui permet de démontrer que ce n’est nullement le cas. C’est pourquoi il note :
« Le concept d’identité, lorsqu’il n’est pas utilisé à une échelle exclusivement individuelle, est intrinsèquement réductionniste et déshumanisant, une abstraction collectiviste et idéologique de tout ce qui est original et créatif dans l’être humain, de tout ce qui n’a pas été imposé par l’héritage, la géographie, ou la pression sociale.
La véritable identité ressort plutôt de la capacité des êtres humains à résister à ces influences et à les contrer avec des actes libres de leur propre invention. La notion d’ « identité collective » est une fiction idéologique et le fondement du nationalisme. »
Ainsi, au lieu de devoir respecter, comme par le passé, une identité et des coutumes obligatoires, chacun peut aujourd’hui élargir notablement l’horizon de sa liberté individuelle. Et c’est en ce sens, nous dit Mario Vargas Llosa, que la mondialisation doit être accueillie favorablement.
L’inverse serait absurde et artificiel, ainsi qu’il le montre avec l’exemple de l’Amérique Latine et l’opposition de longue date entre indigénistes et hispanistes, qu’il développe par la suite, en montrant en quoi il les juge toutes deux sectaires, réductionnistes et fausses, et ayant des relents de racisme. En réalité, l’Amérique Latine est composée de multiples identités culturelles et de multilinguisme, et c’est ce qui, selon lui, en fait la richesse.
Les cultures locales et régionales ne se sont d’ailleurs jamais portées aussi bien que dans le monde libre, sans qu’ils aient à voir avec du nationalisme (il en donne des illustrations, comme l’Espagne d’après Franco).
- Tom Palmer et al., La moralité du capitalisme – Ce que vos professeurs ne vous diront pas,Les Éditions du Libre-échange, mai 2016, 256 pages.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire