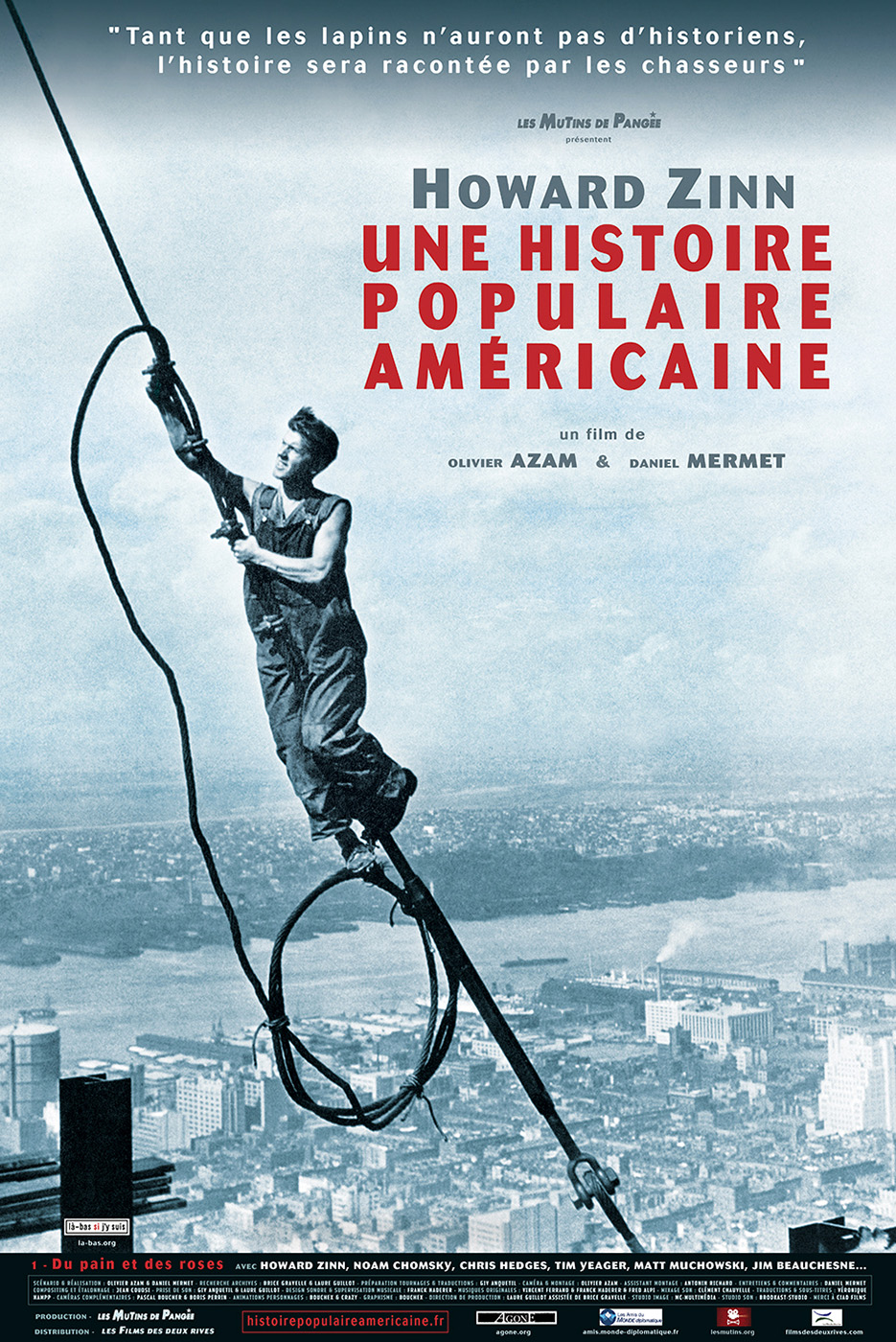Que l’État se contente d’être juste, nous nous chargerons d’être heureux.---- Benjamin Constant
Chaque Québécois doit plus de 34 000 $ au provincial seulement
Vaut mieux en rire!
Avant de couper des centaines de millions dans les services, est-ce qu’on peut avoir les services ? - Michel Beaudry
31 juillet, 2015
La réflexion du jour
La fantastique capacité du marché de multiplier sans cesse les innovations et d’offrir une infinie variété de biens et de les répartir selon l’intensité des préférences de milliards d’acheteurs volontaires, tient du merveilleux. --- Jean-Luc Migué
Les délocalisations : évolution naturelle du concept de la division du travail
Au Québec, il est de bon ton de dénoncer les
délocalisations. Sous prétexte de protéger les emplois et l’environnement, les politiciens
et autres étatistes, de gauche comme de droite, militent activement contre
toute forme de délocalisation. Nos grands médias, alimentés par des
journalistes syndiqués, pour la plupart d’ardents défenseurs de
l’interventionnisme étatique, se font un plaisir de rapporter bêtement les
affirmations de tout un chacun sans analyse critique comme le commanderait un
minimum d’éthique journalistique. Mais lorsque l’information explique les
avantages du libre marché et va à l’encontre du protectionnisme si cher aux
étatistes, personne n’en parle.
C’est sûrement pour cette raison que l’étude de Statistique Canada, La productivité de l’industrie dans le
secteur de la fabrication : le rôle de la délocalisation, est passé à peu
près inaperçue au Québec. En effet, cette étude conclut que les
délocalisations, loin d’affaiblir l’économie comme le prétendent les promoteurs
du protectionnisme, améliorent la productivité des entreprises.
Le terme « délocalisation » désigne des biens importés directement
par les fabricants et utilisés localement dans la fabrication de produits
destinés aux consommateurs ou à d’autres entreprises manufacturières. Ce n’est,
en définitive, que l’évolution naturelle du concept de la division du travail.
Imaginez ce que serait notre vie si nous devions tous produire notre propre
nourriture? Nous devrions travailler 15 heures par jour pour produire à peine
ce qu’il nous faut pour survivre. Grâce à la division du travail, je peux
oeuvrer comme programmeur et échanger le fruit de mon travail pour me procurer
les biens essentiels dont j’ai besoin. Le boulanger, l’agriculteur, le plombier,
etc. en font autant. De surcroît,
l’amélioration de la productivité découlant de la spécialisation des
métiers me laisse suffisamment d’argent pour payer des impôts et contribuer au
bien-être de l’ensemble de la société.
Selon les auteurs de l’étude, Lydia Couture, Aaron Sydor, et
Jianmin Tang, une entreprise
manufacturière qui importe des biens de l’étranger pour fabriquer ses propres
produits, augmente la valeur ajoutée du travail de ses employés, devient plus
concurrentielle, gagne de nouvelles parts de marché et conquièrent de nouveaux
marchés. Le succès de ces entreprises contribue à la croissance économique et ainsi,
au bien-être de la population.
Les délocalisations permettent aux entreprises de se
spécialiser dans les tâches qu’elles accomplissent le mieux. Les auteurs de
l’étude notent aussi que la délocalisation favorise la réaffectation des
ressources des entreprises moins productives vers les entreprises plus
productives d’une même industrie. De plus, elles exposent les entreprises à la
concurrence internationale et lui donne accès aux meilleures pratiques et
technologies de l’industrie. Enfin, la multiplication des fournisseurs
potentiels augmente les chances de trouver les meilleurs intrants au meilleur
prix et permet de raffiner les processus de production. Tous ces facteurs
contribuent à l’amélioration de la productivité. Donc, contrairement aux
croyances répandues par les étatistes et largement diffusées par les médias
québécois, le commerce ne fait pas que partager un volume fixe de richesse,
mais par la magie de la productivité, augmente la richesse totale au bénéfice
de tous.
L’Étude conclut que les gains de productivité des
entreprises canadiennes qui importent une partie de leurs intrants sont en
moyenne de 7 % par rapport à leurs concurrentes. Plus on délocalise, plus l’avantage
de productivité est significatif. Ces gains de productivité augmentent les
profits de l’entreprise pour le plus grand bien des actionnaires, des employés
et des consommateurs.
30 juillet, 2015
La réflexion du jour
Règles d'urbanisme, de zonage, de salubrité, de sécurité, permis pour l'enseigne, les rénovations, la terrasse, le mobilier, la vente d'alcool, rapports et plans à remettre, documents et preuves à fournir, dépôts et paiements à verser, sans compter la gestion des taxes de vente et des retenues à la source sur les salaires des employés: il ne faut pas avoir peur de la paperasse quand on se lance en affaires.--- Isabelle Ducas
29 juillet, 2015
La réflexion du jour
La Colombie-Britannique a introduit en 2004 un cours obligatoire sur la gestion des finances personnelles, et l’Ontario intègre depuis 2011 des notions de finances personnelles dans son programme général de la 4e à la 12e année. Qu’attend le Québec ?---Kathy Noël
28 juillet, 2015
La réflexion du jour
Denis Coderre a ainsi impliqué la grosse et lourde machine municipale dans une industrie qui carbure à l'innovation constante (ndlr l'autopartage). Il est intervenu dans un libre marché qui se portait très bien sans intervention de la Ville. Il a mis le doigt du public dans un engrenage privé bien huilé.
Bref, il a enrayé un marché en pleine lancée pour le remplacer par un service électrique incertain qui nécessitera temps, ressources, bornes de recharge, entretien et soutien public. Comme si la Ville n'avait pas assez de problèmes comme ça. --- François Cardinal
Bref, il a enrayé un marché en pleine lancée pour le remplacer par un service électrique incertain qui nécessitera temps, ressources, bornes de recharge, entretien et soutien public. Comme si la Ville n'avait pas assez de problèmes comme ça. --- François Cardinal
27 juillet, 2015
Rittaud : Mythe climatique et peur exponentielle
Malheureusement, au Québec comme en France, les climato-optimistes, contrairement aux climato-pessimistes, non pas droit de cité dans les grands médias
La conférence de Benoît Rittaud à l'Institut Turgot (Paris), tenue le 29 juin 2015, sur le thème "Mythe climatique et peur exponentielle", vaut le détour. C’est plus qu’un questionnement sur les thèses promues par le GIEC. C’est aussi une analyse de l’utilisation de la peur comme outil de gestion des populations par les politiques.
La conférence de Benoît Rittaud à l'Institut Turgot (Paris), tenue le 29 juin 2015, sur le thème "Mythe climatique et peur exponentielle", vaut le détour. C’est plus qu’un questionnement sur les thèses promues par le GIEC. C’est aussi une analyse de l’utilisation de la peur comme outil de gestion des populations par les politiques.
La réflexion du jour
On sait déjà que gagner de l’argent est mal vu au Québec. Taxer la réussite et le succès, voire les riches, est même devenu pour certains un symbole de justice sociale. Ce qu’on ne savait pas cependant, c’est que cette noble poursuite d’équité s’étendrait jusqu’à taxer l’échec et l’insuccès.--- Pierre Simard
26 juillet, 2015
25 juillet, 2015
La réflexion du jour
Comme l’a écrit ma collègue Nathalie Elgrably-Lévy: «Aurait-on dû empêcher l'électrification des villes afin de sauver l'emploi des allumeurs de réverbères? Aurait-on dû détruire les trains électriques pour sauver les trains à vapeur?»--- Richard Martineau
24 juillet, 2015
L’économie collaborative bouscule l’État sclérosé
Au Québec, il faut des permis pour tout. Vous voulez faire
du taxi, il vous faut un permis de la Commission des transports. Vous voulez
vendre du lait, il vous faut acheter des quotas. Vous voulez recevoir des
touristes, il vous faut un permis du ministère du Tourisme. Vous désirez garder
des enfants, il vous faut obtenir la permission du ministère de la Famille. Etc.
Il est devenu impossible de faire quoi que ce soit sans
avoir obtenu au préalable plusieurs permis auprès de la municipalité, des gouvernements
ou autres organismes dûment mandatés à cette fin. Les délais et les coûts
associés sont prohibitifs et découragent les entrepreneurs les moins aguerris
et contribuent largement à la faillite de plusieurs entreprises.
Je conçois que les régimes de permis sont justifiés par le
besoin d’imposer des normes minimales visant à protéger la population.
Malheureusement, dans le meilleur des cas, ils sont utilisés pour générer des revenus
et renflouer les coffres toujours vides des gouvernements. Mais cela est un
moindre mal. Ils sont autrement plus dommageables lorsqu’ils servent à protéger les intérêts de groupes de pression
au détriment des consommateurs. Dans ce cas, le permis devient un moyen
hypocrite de subventionner une industrie qui a ses entrées au gouvernement. Les
industries laitière et du taxi tombent clairement dans cette dernière catégorie.
Ces régimes de permis coûtent extrêmement cher aux consommateurs et sont devenus
des obstacles importants au développement de l’économie.
L’industrie laitière
La gestion de l’offre, un euphémisme pour désigner un
monopole de fixation des prix, date des années 1970. Pour avoir le droit de
produire et de vendre du lait, l’agriculteur doit obtenir des permis appelés
quotas. Mais le gouvernement n’émet plus de nouveaux quotas depuis belle
lurette. Ce phénomène crée donc une rareté et le prix des quotas a explosé. Au
Québec, un quota équivaut à la production laitière d’une bonne vache et coûte
environ 25 000 $.
Ces quotas ont permis à une génération d’agriculteurs de
s’enrichir sur le dos des consommateurs. Aujourd’hui, le coût des quotas représentent
un pourcentage important de la valeur d’une ferme laitière. Les producteurs
n’ont d’autres choix que d’ajuster à la hausse les prix de leurs produits pour
financer le coût des quotas. Mais pour que le mécanisme fonctionne, les
gouvernements ont dû éliminer toute forme de concurrence extérieure en imposant
des barrières tarifaires aux produits étrangers. C’est ce qui explique que le
lait québécois coûte deux à trois fois plus cher que le lait américain,
australien ou néo-zélandais. À la fin, ce sont les consommateurs, surtout les
plus pauvres, qui sont pénalisés.
L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont mis fin à ce régime
en rachetant les quotas des producteurs. C’est certainement ce que nous devrons
faire si nous voulons un jour rejoindre l’accord de libre-échange
Asie-Pacifique. Non seulement avons-nous payé trop cher pour le lait que nous
consommons depuis plus de quarante ans, mais en plus nous devrons dédommager
les producteurs qui ne sont aucunement responsables des politiques mal avisés
de nos gouvernements.
L’industrie du taxi
Le problème est similaire dans l’industrie du taxi. Sous le
prétexte de protéger les consommateurs, les gouvernements ont institué un
régime de permis. Ensuite, sous le prétexte de permettre aux chauffeurs d’obtenir
un revenu décent, le lobby du taxi a convaincu les politiciens de restreindre
le nombre de permis pour réduire la concurrence. Il est arrivé ce qui devait
arriver, le prix des permis a explosé. À Montréal, le prix d’un permis de taxi
excède 200 000$. Pour financer leur investissement, les propriétaires de
permis n’ont d’autres choix que de réduire la rémunération des chauffeurs et
d’exiger des tarifs toujours plus élevés. Ainsi, les utilisateurs, en payant
plus qu’ils ne devraient, subventionnent l’industrie et les chauffeurs doivent
travailler quatorze heures par jours pour obtenir un revenu décent.
Il est temps d’abolir ce système. Il est évident qu’il n'a
pas donné les résultats recherchés. De surcroît il empêche l'implantation des
nouvelles technologies de l’économie collaborative, telle UberX, qui permettent
de réduire les coûts et d’améliorer les services.
Faut-il dédommager les propriétaires de licences de taxi
lorsque le système sera aboli?
Les changements technologiques affectent la plupart des
entreprises. Certaines en sortent gagnantes, d’autres perdantes. Les
propriétaires des compagnies de taxis ont travaillé main dans la main avec les
fonctionnaires et les politiciens pour limiter la concurrence et ainsi faire
croître la valeur de leur entreprise. À ce titre, ils sont des investisseurs
comme les autres. Ils ont pris un risque d’affaires et ils ont perdu. En toute
logique, pourquoi leur offrirait-on un traitement de faveur?
Toutefois, comme dans le cas des agriculteurs, les
détenteurs de permis individuels ont investi de bonne foi pour acheter le droit
de travailler. Ils ne sont aucunement responsables de la collusion entre l’industrie
et le gouvernement. Il serait donc raisonnable qu’ils soient compensés, du
moins partiellement.
Conclusion
Les gouvernements sont dépassés par les applications de l’économie
collaborative. Le problème est toujours le même. Une réglementation
anachronique pénalise les entreprises traditionnelles. Elles se tournent donc vers
le gouvernement et demandent à être protégées contre la concurrence des
nouveaux venus.
Mais limiter la concurrence comme le proposent les lobbys
industriels n’est certainement pas la bonne solution. Il faut plutôt libéraliser les marchés pour le
plus grand bien des consommateurs. Il est temps de rappeler à nos politiciens
que dans toute réglementation ce n’est pas l’intention qui compte, mais le
résultat.
La réflexion du jour
Il n’est donc pas étonnant de voir les sondages donner, les uns après les autres, le NPD gagnant au Québec; les conservateurs sont invariablement présentés sous un mauvais jour : le pétrole, la guerre et le reste. Même l'équilibre des finances publiques est discuté sous ses angles les plus démagogiques... Après un tel pétrissage de l'opinion publique, doit-on s'étonner du sondage montrant aujourd'hui la gauche néo-démocrate en tête dans les intentions de vote?--- Michel Hébert
23 juillet, 2015
La réflexion du jour
Le président du Conseil Matteo Renzi a annoncé 50 milliards de baisse d'impôt en 3 ans. Des recettes qui rappellent celles… de Silvio Berlusconi.(ndlr même les Italiens ont compris cela) --- LePoint.fr
22 juillet, 2015
Laissez-nous faire !, d’Alexandre Jardin
Le titre du dernier ouvrage d’Alexandre Jardin donne envie
d’ouvrir ce livre.
Revue de livre par Francis Richard
Alexandre Jardin, sans que je l’aie jamais lu, est de
réputation, un écrivain « fleur bleue », « rêveur et
accaparé par des trouvailles sentimentales », ce qu’il confirme dès
les premières pages de son livre. Il reconnaît plus loin qu’il est « un
écrivain ivre de mots légers », ce qui n’est pas, pour le coup, pour me
déplaire, et m’inciterait plutôt à lire ses autres livres…
Le titre de ce dernier ouvrage donne envie de le lire parce
que« laissez-nous
faire » est la maxime attribuée à l’économiste Vincent de Gournay (1712-1759),
partisan de la liberté de commercer, de produire et de travailler. Un titre
réjouissant donc. Qui va à l’encontre de la mentalité mainstreamd’aujourd’hui
en France.
Alexandre Jardin confie que, sous le masque du romancier
qu’il est, se cache un autre lui-même, lequel, depuis longtemps, veut « prendre
soin de la France », depuis ses quinze ans précisément, âge auquel il
écrit une lettre dans ce sens à son père, Pascal Jardin, peu de temps avant que
celui-ci ne soit emporté par le crabe.
Si les souvenirs personnels, qui émaillent le livre,
expliquent l’engagement, différé par la peur, d’Alexandre Jardin et sont donc
utiles pour comprendre d’où lui viennent toutes ses idées pour réparer la
France, ce sont toutefois les actions concrètes, dans la droite ligne de ces
idées, menées ou initiées par lui, qui revêtent de l’intérêt et lui permettent
de dire qu’« on a déjà commencé ».
Ernest Renan avait dit à Paul Déroulède : « jeune
homme, la France se meurt : ne troublez pas son agonie. » Cela fait donc
bien longtemps que l’on parle du déclin de la France, avant même, peut-être,
qu’il n’ait vraiment commencé. Ce n’est en tout cas pas une phrase qu’Alexandre
Jardin aurait supporté d’entendre et qu’il n’évoque d’ailleurs pas, s’il la
connaît.
Car, de toute façon, Alexandre Jardin est de ceux qui, comme
ses modèles, Winston Churchill ou Charles de Gaulle, ne sont pas du genre à se
résigner à la fatalité et qui veulent transmettre aux autres leur joie de
citoyen. Comment ? En agissant, plutôt qu’en disant. En faisant avec ceux qu’il
appelle « les Faizeux », ou « les Zèbres », qu’il
oppose aux « Diseux », qui disent mais ne font pas.
Si la France décline, c’est bien parce que les Français ont
accepté de se laisser diriger, élection après élection, par ceux qu’Alexandre
Jardin appelle des mini-Colbert : « nous avons tous lâchement obéi à des
bureaucrates hors-sol, à des conseils-d’étateux fâchés avec le sens commun, à
des médiocrités convaincues que chaque problème est soluble dans une solution
technocratique. »
Résultat : les étatismes de droite comme de gauche des
partis dits « de gouvernement », par leur impéritie, leurs promesses
non tenues, leurs dires non suivis d’actions, sont en train de faire le lit
d’un hyper-étatisme autrement redoutable, et autrement menaçant, celui prôné
par le FN de Marine Le Pen :
« Par cet étatisme décomplexé, le Front National est encore
pire que la droite, le centre et la gauche réunis ! D’ailleurs c’est bien comme
cela qu’il gagne du terrain : en rameutant la vieille nostalgie de
l’État-recours, alors que c’est précisément notre étatisme prodigieusement
inefficace et coûteux qui empêche la France des Faizeux de régler nos
difficultés. »
Il suffit de faire un tour sur le site bleublanczebre.fr pour
se rendre compte de tout ce que ces Faizeux font déjà, dont l’auteur donne de
nombreux exemples impressionnants, avec pourtant peu de moyens, pour combattre
l’illettrisme, éduquer des jeunes, permettre de trouver ou de retrouver un
emploi, mettre des livres à portée de défavorisés, transporter des personnes à
mobilité réduite, donner accès à un logement décent à ceux qui n’en ont pas
etc. Leurs solutions, rassemblées en bouquets, fonctionnent… parce qu’elles
sortent du cadre.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : « ces
Faizeux sont d’une gauche sincère, d’une droite de conviction, du centre
souriant, verts ou parfaitement dégoûtés de la vie partisane.» Mieux, ces
Faizeux de tout poil se parlent et s’écoutent : « les Faizeux réunis
peuvent être des entreprises portées par des actionnaires privés, des
associations, des maires créatifs, des acteurs de l’économie sociale et
solidaire ou collaborative. »
En 2017, année d’élection présidentielle, les Zèbres
comptent bien peser de tout leur poids, acquis par leurs réalisations concrètes,
pour obliger les partis discrédités à conclure des contrats de mission avec eux
qui représentent la société civile dans l’éclat joyeux de ses réussites. Ils
demanderont « non des facilités, mais des difficultés à résoudre »,
agiront indépendamment « d’une administration empesée » et refuseront
toute tutelle des mini-Colbert. Sinon, ils iront eux-mêmes à la bataille…
Les Zèbres sont des bons vivants : « ils vont
déshabituer ce vieux pays à faire de la politique sans bonheur, inciter les
gens par leur propre exemple à se convertir à leurs désirs, à chevaucher
ardemment leur culot ». À leur instar, Alexandre Jardin exhorte ceux
qui le lisent à passer à l’acte : « laissez jaillir de votre cœur la joie
d’agir soi-même, localement, quand les élites font à ce point défaut ! Renoncez
à l’inaction mortifère, à l’incantation sans portée et à l’indignation stérile.
»
Alexandre Jardin, Laissez-nous faire – On a déjà commencé, Robert
Laffont, 2015, 216 pages.
La réflexion du jour
Sunil Johal, directeur des politiques au Centre Mowat, un groupe de réflexion sur les politiques publiques de l'Université de Toronto, affirme que les politiciens devraient réfléchir à l'intérêt des citoyens plutôt que de vouloir s'assurer que les chauffeurs de taxi traditionnels puissent continuer de gagner leur vie dans le système actuel.--- Giuseppe Valiante
21 juillet, 2015
La réflexion du jour
Gates considère à juste titre que les sommes colossales d’argent investies dans les énergies renouvelables telles qu’on les conçoit aujourd’hui, éolien et photovoltaïque, sont perdues d’avance car elles n’atteindront jamais leur but qui est de remplacer le pétrole et le charbon dans la production d’électricité, non seulement pour l’industrie, les services et les ménages mais également pour les transports à moins d’une diminution brutale de la population mondiale de plusieurs milliards d’habitants.--- Jacques Henry, Contrepoints
20 juillet, 2015
La réflexion du jour
Une fois élus, les politiciens pensent constamment à leur réélection et plusieurs décisions du gouvernement sont fonction de cette préoccupation.--- David Levine via Gérard Bélanger
19 juillet, 2015
18 juillet, 2015
La réflexion du jour
C'est en comparant le rendement financier de la SAQ avec celui de la LCBO que l'on s'aperçoit à quel point la gestion de cette société d'État québécoise est pitoyable. À titre d'exemple, avec plus de 7500 employés, la SAQ rapporte aux Québécois environ 1 milliard de dollars en dividendes. Pour la LCBO, avec ses 3700 salariés, la société génère plus de 1,7 milliard. Le rendement par travailleur de la LCBO est pratiquement quatre fois plus élevé que celui de la SAQ. --- Sylvain Charlebois
17 juillet, 2015
La réflexion du jour
L’irritant le plus marquant dans cet immobilisme réside dans cette manie que nous avons au Québec à niveler par le bas. UberX est pourtant un outil formidable pour tirer toute l’industrie vers le haut, vers l’établissement de nouveaux standards de qualité. Utilisation des dernières technologies, indépendance accrue des chauffeurs, évaluation de la satisfaction par rapport au service reçu par chaque client.---Jonathan Trudeau
16 juillet, 2015
La réflexion du jour
Avant la crise, la dette n’est pas un problème pour les politiques, au contraire. Après la crise, ce n’est pas leur problème : c’est le problème du peuple qui doit rembourser, et des créanciers qui veulent récupérer leur argent. Les politiques décident d’endetter l’État, mais ne sont pas tenus pour responsables. Baptiste Créteur
15 juillet, 2015
La réflexion du jour
Deuxièmement, les politiques fiscales préférentielles offertes aux régions ont un coût qui est assumé par l’ensemble de l’économie. C’est ce qui est arrivé avec les îles grecques qui jusqu’ à présent jouissaient d’exemptions fiscales diverses. Trop de politiques préférentielles est intenable. Avons-nous franchi ce cap au Québec ? C’est possible, tout simplement parce que les zones urbaines sont sous-représentées parmi nos élus, ce qui crée des distorsions de plus en plus néfastes pour l’économie du Québec. Le programme des mini-centrales hydroélectriques est un exemple de ce genre de mauvaises politiques fiscales soutenues par de l’électoralisme régional.--- Loïc Tassé
14 juillet, 2015
La réflexion du jour
Si ce gouvernement avait vraiment à cœur la défense des travailleurs et la création d'un environnement propice au développement, il serait, au contraire, tout à fait heureux que le gouvernement canadien ait adopté (enfin!) le projet de loi C-377 qui contraint les organisations syndicales à ouvrir leurs livres.--- Joanne Marcotte
13 juillet, 2015
« Histoire populaire de l’Amérique » d’Howard Zinn
Une histoire « par en bas » éditée pour la première fois
dans sa version originale en 1980 (et dans sa version française en 2002 par les
éditions Agone), cet ouvrage s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires aux
États-Unis.
Revue de livre par Damien
Theillier
.
Howard Zinn (1922–2010), militant politique puis
universitaire militant, a enseigné l’histoire et les sciences politiques à la
Boston University. Militant de la première heure pour les droits civiques et
contre les guerres, il a conçu son métier d’historien comme indissociable d’un
engagement dans les luttes sociales et politiques de son temps. Son œuvre (une
vingtaine d’ouvrages) est essentiellement consacrée aux minorités et à leur
destin dans la société américaine.
Dans A People’s History of the United States (Une histoire populaire des États-Unis), il écrit l’histoire
« par en bas », une histoire sociale, des oubliés, des vaincus, des opprimés.
Édité pour la première fois dans sa version originale en 1980 (et dans sa
version française en 2002 par les éditions Agone), cet ouvrage s’est vendu
à plus d’un million d’exemplaires aux États-Unis et a été lu par de nombreux
étudiants américains.
Il ne s’agit pas d’une lecture globale de l’histoire de
l’Amérique mais d’une sélection de moments oubliés ou mal connus. D’emblée,
l’auteur adopte le parti pris de ne pas se dissimuler derrière une posture
faussement neutre. En effet, dit-il, « le passé nous est transmis
exclusivement du point de vue des gouvernants, des conquérants, des diplomates
et des dirigeants. Comme si, à l’image de Christophe Colomb, ils méritaient une
admiration universelle, ou comme si les Pères fondateurs, ou Jackson, Lincoln,
Wilson, Roosevelt, Kennedy et autres éminents membres du Congrès et juges
célèbres de la Cour suprême incarnaient réellement la nation tout entière ;
comme s’il existait réellement une entité appelée États-Unis. » (Une
histoire populaire des États-Unis – de 1492 à nos jours, De 1492 à nos
jours, Agone, 2002, p. 13)
Il prévient clairement son lecteur : « ce
livre se montrera radicalement sceptique à l’égard des gouvernements et de
leurs tentatives de piéger, par le biais de la culture et de la politique, les
gens ordinaires dans la gigantesque toile de la communauté nationale censée
tendre à la satisfaction des intérêts communs. » (Ibid.)
En effet, écrit-il encore, « l’histoire des pays,
présentée comme l’histoire d’une famille, occulte les conflits d’intérêt
farouches (parfois explosifs, le plus souvent refoulés) entre vainqueurs et
vaincus, maîtres et esclaves, les capitalistes et les travailleurs, dominateurs
et dominés par la race et le sexe. » (Ibid.)
C’est pourquoi il fait l’histoire de la découverte de
l’Amérique du point de vue des Arawaks, l’histoire de la Constitution du point
de vue des esclaves, celle d’Andrew Jackson vue par les Cherokees, la guerre de
Sécession par les Irlandais de New York, celle contre le Mexique par les
déserteurs de l’armée de Scott, l’essor industriel à travers le regard d’une
jeune femme des ateliers textiles de Lowell, la guerre hispano-américaine à
travers celui des Cubains, la conquête des Philippines telle qu’en témoignent
les soldats noirs de Luson, l’Âge d’or par les fermiers du Sud, la Première
Guerre mondiale par les socialistes et la suivante par les pacifistes, le New
Deal par les Noirs de Harlem, l’impérialisme américain de l’après-guerre par
les péons d’Amérique latine, etc.
Son œuvre est surtout un travail de mémoire. Zinn voit «
dans les plus infimes actes de protestation, les racines invisibles du
changement social ». Pour lui, les héros des États-Unis ne sont ni les Pères fondateurs,
ni les présidents, mais les paysans en révolte, les militants des droits
civiques, les syndicalistes, tous ceux qui se sont battus, parfois victorieux,
parfois non, pour l’égalité.
Une opposition au
capitalisme erronée
Si une telle perspective est séduisante et ne manque pas de
pertinence, l’histoire américaine revue et corrigée par Howard Zinn tend hélas
trop souvent à devenir exclusivement un récit de la honte. L’Amérique ne serait
pas une terre de liberté pour le monde mais un repoussoir. Le capitalisme est
vu comme un système qui empêche la majorité des travailleurs d’obtenir leur
juste part. L’Amérique aurait fondé sa richesse sur le vol, l’inégalité et
l’injustice.
Les jeunes Américains qui lisent ce livre, largement utilisé
dans les écoles et les universités, finissent pas penser que la richesse et
l’abondance de leur pays n’est que le résultat des crimes de leurs ancêtres. Si
l’histoire avait été équitable, ils n’auraient pas cette grande maison et ce
joli canapé, ce téléviseur grand écran et cette belle voiture. La conclusion du
livre est que le gouvernement a le droit de piller les riches et la classe
moyenne, parce que ces gens n’ont pas produit leur richesse, ils l’ont volée.
La réalité est plus complexe. Comme beaucoup, Zinn se
représente la richesse comme un gâteau qu’on se partage : ce que l’un prend,
l’autre le perd. Et si l’on prend la plus grosse part, on laisse aux autres les
plus petites. À ce compte-là, en effet, seule une autorité supérieure pourrait rétablir
la justice en égalisant par la redistribution forcée les parts du gâteau.
Mais cette conception des choses est radicalement erronée et
témoigne d’une ignorance des lois d’une économie de marché. La richesse n’est
pas quelque chose qui existerait par elle-même. Elle est d’abord créée. La
richesse a un point commun avec le bonheur, la santé, le talent,
les enfants. Je peux en avoir sans en priver personne. Je peux être
heureux sans pour cela causer le malheur d’autrui. Et tout comme le bonheur est
souvent communicatif, le riche peut aussi enrichir les autres, en leur donnant
du travail ou en consommant. C’est ainsi que s’effectue la redistribution
naturelle des richesses, y compris à l’échelle internationale.
Certes, dans une économie libre, les revenus sont inégaux,
mais les possibilités qu’ont les gens de se sortir de la pauvreté extrême sont
très grandes parce qu’on peut gagner en servant les intérêts d’autrui et que la
richesse des uns bénéficie nécessairement aux autres. Le libre marché est un
formidable mécanisme naturel de redistribution des richesses.
Bien compris, le capitalisme est donc fondé sur l’idée
d’acquérir des richesses non pas en prenant ce qui appartient à un autre, mais
par l’innovation, l’esprit d’entreprise et le commerce. La liberté économique
permet aux individus d’utiliser librement leurs dons pour créer de la valeur et
servir les autres. En retour, le profit est la juste récompense d’un service
rendu. Elle crée donc une société harmonieuse, fondée sur l’échange
mutuellement bénéfique et le consentement volontaire. Au contraire, une
économie dirigée, dans laquelle le sacrifice de l’intérêt personnel est la
condition de l’intérêt général, conduit à l’égalité dans la misère.
Une juste opposition
à la guerre
En revanche, Zinn a raison de s’opposer à la guerre, qui est
toujours une forme de pillage ou de destruction des richesses. Tout au long de
l’histoire humaine, la richesse a été acquise par la guerre et le vol : I win,
you lose. Toutes les cultures ont méprisé les entrepreneurs et les commerçants.
En Inde, il y a le système des castes. Qui est en haut ? Le brahmane ou les
prêtres. L’entrepreneur est en bas, comme dans la division en classes dans
la République de Platon. L’historien islamique Ibn Khaldoun a écrit
que le pillage était moralement préférable à l’entrepreneuriat ou au commerce.
Pourquoi ? Parce que le pillage, disait-il, est plus viril.
Zinn, dont l’opposition à la guerre est l’un des thèmes
centraux de son œuvre, a dénoncé la guerre du Vietnam, la première guerre du
Golfe, l’intervention militaire de l’OTAN au Kosovo (1999), puis, après le 11
septembre 2001, les guerres en Afghanistan et en Irak.
Selon lui, la guerre contre le nazisme et le communisme fut
souvent une excuse pratique pour maintenir les intérêts économiques et
militaires de l’Amérique dans des régions clés du monde. Par pur nationalisme,
les Américains ont depuis longtemps adopté une notion de supériorité morale ou
de mission divine, affirme Howard Zinn.
En 2006, il écrivait :
« La pensée nationaliste est la perte du sens de la
proportion. La mort de 2300 personnes à Pearl Harbor est devenue la
justification de la mort de plus de 250 000 civils à Hiroshima et Nagasaki. Le
meurtre de 3000 personnes le 11 septembre 2001 devient la justification de
l’assassinat de dizaines de milliers de civils en Afghanistan, en Irak et le
nationalisme possède un ton virulent lorsqu’il est dit être béni par la
providence. Aujourd’hui nous avons un président ayant envahi deux pays en
quatre ans, qui a annoncé au cours de sa campagne de réélection en 2004 que
Dieu parle à travers lui. Nous devons réfuter l’idée que notre nation soit
différente des autres, moralement supérieure aux autres puissances impériales
de l’histoire du monde. »(http://howardzinn.org/put-away-the-flags)
Dans la préface de son histoire populaire, il dénonce une
forme de relativisme moral qui consiste à justifier la guerre au nom d’un but
supérieur : « Je ne prétends pas qu’il faille, en faisant l’histoire,
accuser, juger et condamner Christophe Colomb par contumace. Il est trop tard
pour cette leçon de morale, aussi scolaire qu’inutile. Ce qu’il faut en
revanche condamner, c’est la facilité avec laquelle on assume ces atrocités
comme étant le prix, certes regrettable mais nécessaire, à payer pour assurer
le progrès de l’humanité : Hiroshima et le Vietnam pour sauver la
civilisation occidentale, Kronstadt et la Hongrie pour sauver le socialisme, la
prolifération nucléaire pour sauver tout le monde ». (Ibid.). Ce
relativisme moral est d’autant plus dangereux qu’il est appliqué avec une
apparente objectivité par des universitaires.
Pour autant, ce livre n’est pas accessible à tout public. Il
est intéressant en contrepoint plutôt qu’en première lecture, car il suppose
certaines connaissances préalables de la trame historique pour comprendre les
enjeux politiques, sociaux, économiques et religieux abordés par Zinn. Un tel
ouvrage pourra enrichir le lecteur informé et cultivé car il ouvre des pistes
de réflexion novatrices et critiques. Mais il risque d’égarer celui qui n’a pas
commencé par assimiler l’histoire des États-Unis à travers des ouvrages
classiques comme Les Américains (2 volumes) d’André Kaspi, que je
recommande à tous.
À lire également en anglais : We Who Dared to Say No to
War: American Antiwar Writing from 1812 to Now par Murray Polner et Thomas
E. Woods, Jr., Basic Books, 2008. Ce livre est un recueil de textes
antiguerre et anti-impérialistes écrits par des progressistes, des libertariens
et des conservateurs. Tous ont un point commun : ils défendent une
alternative au consensus bipartite en matière de politique étrangère. On trouve parmi ces textes des
auteurs comme : Daniel Webster, John Randolph, John Quincy Adams, Charles
Sumner, Julia Ward Howe, Lysander Spooner, Stephen Crane, William Graham
Sumner, William Jennings Bryan, Robert La Follette, Randolph Bourne , Helen
Keller, Jeanette Rankin, David Dellinger, Robert Taft, Murray Rothbard, Russell
Kirk, George McGovern, Philippe et Daniel Berrigan, Butler Shaffer, Country Joe
& the Fish, Andrew Bacevich, Pat Buchanan, Bill Kauffman, Paul Craig
Roberts, Howard Zinn, et Lew Rockwell.
En complément, on pourra lire la récente traduction
française de l’autobiographie intellectuelle de Zinn : L’impossible
neutralité : Autobiographie d’un historien et militant, 2006.
Howard Zinn, Une Histoire populaire des États-Unis de 1492 a nos jours,
Agone, 810 pages.
La réflexion du jour
En analysant les rapports financiers du Fonds de solidarité FTQ, l’IEDM a toutefois découvert le pot aux roses en 2013. Alors que le Fonds de solidarité se vantait de respecter la «norme du 60 %» de capital investi en démarrage, cette norme ne concernait pas tous les actifs. Dans les faits, le Fonds n’investissait pas 60 % en démarrage, ni même 50 %, mais seulement 11 % environ.--- Youri Chassin
12 juillet, 2015
11 juillet, 2015
La réflexion du jour
Aujourd’hui, des donneurs de leçons ne cessent de nous dire ce que nous devons penser et ce en quoi nous devons croire. Ce discours intimidant et culpabilisant diabolise, voire criminalise toute pensée non conforme.--- Laurent Fidès via Richard Martineau
10 juillet, 2015
Un taux de fiscalité élevé limite nos libertés
De tous les Canadiens, les Québécois sont ceux qui travaillent
le plus longtemps pour financer les besoins insatiables des divers paliers de
gouvernement. En 2015, selon l’Institut
Fraser, les Canadiens ont travaillé jusqu’au 10 juin pour financer les
trois paliers de gouvernement : municipal, provincial et fédéral. Les
Albertains, les Canadiens les moins imposés, se sont libérés de leurs
gouvernements le 19 mai. Les Québécois, les plus imposés, ont dû travailler
jusqu’au 16 juin.
À quelques exceptions près, année après année, les
gouvernements québécois sont les plus voraces. En 2000, nous avons dû
travailler pour l’État plus de 6 mois, jusqu’au 5 juillet. Malgré cet effort
remarquable, le gouvernement provincial a quand même enregistré un déficit
budgétaire de plus de 1,5 MM$.
La principale cause de cette situation désolante découle du
fait que les divers paliers de gouvernement contrôlent, directement ou
indirectement, plus de 50 % de l’économie québécoise. Non seulement avons-nous
le taux de participation de l’État dans l’économie le plus élevé en Amérique du
Nord, mais en plus, en raison de l’inefficacité légendaire des administrations
publiques, nous devons payer toujours plus pour des services de plus en plus
médiocres.
Jean-Luc Migué, Senior Fellow, Institut Fraser et professeur
émérite ENAP, Québec, explique ce phénomène dans son texte : En démocratie, prédilection pour les services uniformisés
médiocres. Selon le professeur Migué, les impératifs électoralistes ont
vite fait de convaincre les politiciens
d’accorder la priorité aux demandes du plus grand nombre d’électeurs. Ce
phénomène entraîne la multiplication, l’uniformisation et la bureaucratisation des
services gouvernementaux. Rapidement, la bureaucratie et les groupes d’intérêts
prennent le contrôle de tout le processus de livraison des services. À terme,
ils imposent leurs conditions en fonction de leurs intérêts corporatifs. Dans
ce contexte, l’amélioration de la qualité et le contrôle des coûts sont des
considérations secondaires, voire complètement occultées. L’exemple
le plus récent de ce phénomène est celui des garderies subventionnées.
Les conséquences d’une trop grande participation de l’État québécois
dans l’économie sont bien réelles. Nous
devons travailler pour les gouvernements une semaine de plus que les autres
Canadiens et de surcroît nous devons nous contenter de services médiocres.
Que pourrait-on faire avec une semaine de salaire de plus dans
nos poches?
Toujours selon l’étude de l’Institut
Fraser, le revenu annuel moyen d’une famille de deux adultes et deux
enfants de moins de 18 ans est de 106 424$. Donc, une semaine de travail
équivaut à 2 046,62$ ou 1 135,87 après taxes et impôts.
Les possibilités sont nombreuses : une sortie au
restaurant de temps en temps pour se gâter et resserrer les liens familiaux; ou
pourquoi pas quelques jours de camping? Rien de tel pour redécouvrir les vertus
de la simplicité; ou une soirée au théâtre ou à une représentation de l’OSM. Nos
adolescents se découvriraient peut-être un goût pour la culture; nous pourrions
aussi économiser ce montant pendant quelques années pour voyager avec nos
adolescents et découvrir le monde. Une belle façon de combattre le nombrilisme.
Cet argent, si durement gagné, pourrait aussi servir à
remplacer les vélos des enfants qui sont devenus en quelques années des
antiquités; ou à remplacer cette vieille télévision dont les couleurs délavées
nous empêchent d’apprécier pleinement nos programmes préférés; ou, pourquoi pas,
à nous procurer cet électroménager dont nous rêvons depuis si longtemps.
Enfin, ceux qui possèdent déjà tout ce dont ils ont besoin
pourraient faire des économies en prévision de leur retraite. Un placement de
1 000$ par année au taux de 5% pendant 20 ans représenterait
33 669,25$ d’économie. Un pécule qui pourrait s’avérer fort utile pour
parer aux imprévus.
Malheureusement, ces choix sont disponibles à la plupart des
Canadiens, mais pas à nous Québécois. Les gouvernements nous laissent à peine
six mois de nos revenus pour satisfaire tous nos besoins. Nous sommes
littéralement pris à la gorge. Il ne nous reste rien pour se gâter un peu ou pour
économiser en prévision de notre retraite.
Ainsi va la vie lorsque l’État prend trop de place dans
l’économie.
09 juillet, 2015
La réflexion du jour
Il est étonnant qu’on ne souligne pas toutes ces dérives alors que la Grèce, en votant Non, montre ses fesses à l’Europe...qui ne peut l’exclure.
On préfère, au Québec et ailleurs, critiquer le FMI, la BCE ou les banques, associées au diable capitaliste. J'ajoute que les Québécois ont un penchant naturel pour la dépense, comme les Grecs.--- Michel Hébert
On préfère, au Québec et ailleurs, critiquer le FMI, la BCE ou les banques, associées au diable capitaliste. J'ajoute que les Québécois ont un penchant naturel pour la dépense, comme les Grecs.--- Michel Hébert
08 juillet, 2015
Les Grecs ont choisi la voie de la responsabilité
Je dis bravo à tous les Grecs qui ont eu le culot de dire « non » à l’UE. C’est le choix que tout citoyen responsable se devait de faire. Maintenant, les politiciens grecs ne peuvent plus compter sur l’argent des autres pour s’en sortir. Ils devront enfin prendre leurs responsabilités et apprendre aux Grecs à vivre selon leur moyen.
Depuis qu’ils ont rejoint l’UE, les Grecs en sont arrivés à
croire qu’ils pouvaient tout se permettre puisqu’ils bénéficiaient d’une
promesse de crédit illimitée sur le compte des autres. Fraudes, magouilles,
corruptions, etc. sont devenues le lot des fonctionnaires, des contribuables,
des entrepreneurs et surtout des politiciens. Mais pour paraphraser Mme
Thatcher, l’argent des autres finit toujours par manquer.
Maintenant, c’est au tour des Européens de dire non aux politiciens
grecs.
NON, nous ne voulons pas d’un partenaire qui ne veut pas de
nous et qui tente de nous faire chanter.
NON, nous ne paierons pas vos dettes. Nous ne les avons pas
contractées et nous ne voulons pas d’un partenaire qui n’honore pas ses
engagements.
NON, nous n’aurons pas de regret. L’idéal européen est la
solidarité, non le chantage.
NON, nous ne tolérerons pas la démagogie communiste dans le
seul but de nous culpabiliser face aux difficultés du peuple grec.
NON, nous ne regretterons pas d’avoir été intransigeants
pour protéger l’Europe des abus d’un partenaire irresponsable.
Le premier ministre grec, Alexis Tsipras, a remporté une
immense victoire face à l’opinion publique grecque, mais en bernant les
électeurs. Il était irresponsable de sa part de rejeter le blâme de la débâcle financière
de la Grèce sur le triumvirat du FMI, de la BCE et de l’UE. Décidément, c’est
une manie chez les socialistes de toujours blâmer les autres.
Comme si cela n’était pas suffisant, il fallait en plus qu’il
accuse les Allemands des malheurs grecs.
Les Allemands travaillent plus que les
Grecs, prennent leur retraite plus tard et sont les principaux bailleurs de
fonds d’une Grèce en faillite. Je conçois facilement qu’ils en ont plein le dos
de ces Grecs pleurnichards. C’est ce que j’appelle mordre la main qui te nourrit.
Malheureusement, beaucoup trop de gens qui ne l’ont pas
mérité souffriront. Les banques sont fermées, les denrées de base manquent, il
existe des pénuries de médicaments, etc.,
et ce n’est qu’un début. Au mieux, la Grèce reculera de 50 ans, mais c’est le
prix à payer pour réapprendre le sens des responsabilités. Au pire, ce que je
ne souhaite même pas aux plus communistes d’entre eux, le pays vivra une crise
humanitaire digne de l’Afrique.
Les Européens doivent absolument résister à l’envie de céder
au chantage de Tsipras. Dans le cas contraire, le naturel reviendra au galop et
tout sera à recommencer dans moins d’une génération.
Bien sûr, idéalement il faudrait éviter une crise humanitaire,
mais contrairement à ce qu’on a fait croire aux Grecs, la solution ne réside
pas dans les mains de Madame Merkel, mais bien dans les leurs. Au besoin, le
premier ministre Tsipras peut toujours faire appel à son nouvel ami, Vladimir
Putine. Les Grecs découvriront rapidement que les conditions de l’UE étaient
finalement très raisonnables, mais il
sera trop tard.
Il reste enfin…. le putsch militaire. Je souhaite
sincèrement qu’il ne soit pas nécessaire d’aller jusque-là.
La réflexion du jour
Comment se fait-il qu'entre 2009 et 2012, le coût total de la rémunération à l'acte en médecine et chirurgie, selon les données de la RAMQ, ait augmenté de 23,4 %, pendant que le nombre moyen de services par médecin diminuait de 6,8 % et que le nombre de médecins augmentait de 5,7 %, sans aucune amélioration objective de l'accès ? --- La Presse
07 juillet, 2015
La réflexion du jour
Dans les humanités et les sciences sociales, c’est le refrain socialiste et anti capitaliste qui se chante presque universellement. L’alourdissement des taxes, l’expansion de l’État, la discrimination positive, combinés à l’anti américanisme annonciateur de la chute prochaine de « l’empire américain », constituent les éléments du programme scolaire généralisé de nos universités « progressistes » et en général de nos institutions d’enseignement. --- Jean-Luc Migué
06 juillet, 2015
« Une bulle qui ruina le monde » de Garet Garrett
Interview
de Christophe Jacobs, initiateur et réalisateur du projet de traduction de
Garet Garrett, publié par l’Institut Coppet en 2015.
Un petit mot sur Christophe Jacobs
Christophe Jacobs est né en 1967. Il vit en France, a obtenu
une éducation bilingue français-allemand et exerce une profession
d’entrepreneur indépendant. Après des études en Belgique, il a pu acquérir des
notions d’économie de marché et une pratique de la langue anglaise au contact
entre autres, avec le milieu de la finance.
Christophe Jacobs, s’intéresse aux témoignages historiques
qui documentent les défauts de remboursement des emprunts publics ; leurs
implications dans les relations internationales et dans la politique intérieure
européenne. Grâce aux encouragements du professeur d’économie Guido Hülsmann et
avec l’Institut Coppet présidé par Damien Theillier comme éditeur, il a traduit
récemment un des témoignages les plus marquants parmi ceux-ci, traitant du
défaut général sur les dettes souveraines européennes après la Première Guerre
Mondiale : il s’agit des chroniques économiques éditoriales du magazine
littéraire américain Saturday Evening Post. Celles-ci furent publiées en 1932
aux États-Unis comme recueil sous le titre original de A Bubble that
Ruined the World par Garet Garrett, analyste économique et romancier
américain emblématique, dont aucune autre œuvre n’est disponible jusqu’à
présent en français.
Une
bulle qui ruina le monde est l’unique œuvre de cet auteur disponible
en français actuellement. Qui est Garrett ?
Christophe Jacobs : Garrett est un écrivain américain,
auteur entre autres de plusieurs romans passionnants. Grâce au style de ses
chroniques et de ses fictions, Garet Garrett avait su imposer son nom et le
respect tant auprès du grand public que des personnalités publiques américaines
les plus influentes de la politique au début du XXe siècle (Calvin Coolidge,
Bernard Baruch, Herbert Hoover, etc.) .
Il fut entre autres, membre du comité éditorial du New
York Times, puis directeur du Tribune, et durant vingt ans, principal rédacteur
économique du grand hebdomadaire Saturday Evening Post. En dépit des
guerres, et par opposition à toutes les manifestations de pouvoir impérial, il
consacra son œuvre à définir avec passion l’idéal philanthropique de la
république, mais pas toujours en accord avec les orientations du « Parti
Républicain », loin s’en faut. Il est mort en 1954.
Quelles sont les
différences de perception entre cette crise des dettes souveraines
internationales débutée en 1915 comme elles sont relatées par Garrett dans ce
livre deux ans après le grand crash de Wall Street, et ce que nous rapportent
les médias en 2015 sur la crise actuelle ?
À la lumière de cette republication des éditoriaux de
Garrett entre 1915 et 1932 il est impossible de ne pas faire le parallèle avec
le problème de la Grèce suivant de près l’effondrement de la bulle financière
en 2008, mais la perception dans le public est très différente
aujourd’hui car l’étalon-or a été déclaré officiellement
« inadapté » et entièrement supprimé comme référence mondiale
entretemps.
Du temps de Garrett ce mécanisme monétaire était encore
soutenu officiellement car il devait laisser une grande responsabilité
individuelle au citoyen quant au contrôle de son épargne.
Depuis lors, l’action assez opaque, fluctuante et arbitraire
d’agences gouvernementales monétaires s’est progressivement substituée au
contrôle individuel. Aujourd’hui, cette action des banques centrales n’est même
plus directement soumise aux lois et décrets parlementaires… La grande
différence, c’est donc l’état d’apathie croissante dans lequel nos concitoyens
prennent la nouvelle de l’effondrement de leur système bancaire de nos jours. À
l’époque, l’indignation était plus grande, surtout au sein des partis
conservateurs.
Comment le contrôle
individuel a-t-il pu disparaître ainsi ?
Une évolution s’est produite sous les assauts politiques
successifs (essentiellement entre 1913 et 1974), portés contre ce mécanisme
naturel de mesure. En fonction d’intérêts politiques divers et, faute d’en
comprendre les conséquences, cela s’est passé en l’absence relative de débats
démocratiques sur le fond… Garrett cite les témoignages de justification,
auxquels on avait contraint Wall Street devant le Congrès suite à la crise de
1929. On est frappé de lire combien ces nouveaux risques découlant de la
mondialisation du crédit souverain étaient à peine compris par les banquiers
eux-mêmes depuis le début.
Publiée dans un magazine à grand tirage, sa chronique –
outre le fait qu’elle soit un témoignage infalsifiable de cette confiance
historique populaire à l’époque dans la transparence des institutions
monétaires – fait preuve d’une lucidité étonnante préfigurant ce qui ressemble
à une grande dégringolade à partir de là : confiscation de l’or privé par
FDR, contrôle monétaire par tous les gouvernements militaires impliqués dans la
seconde guerre mondiale, création du rideau de fer à l’Est en réaction à une levée
du contrôle militaire en Allemagne après-guerre (la libéralisation de la D-Mark
en 1948), multiples dévaluations européennes dans les économies contrôlées
après-guerre, et plus tard même la suppression officielle de l’étalon-or
américain en 1974 par Nixon.
Y a-t-il des
différences pour le public de cette époque avec la perception individuelle – en
termes de responsabilité économique perceptibles ?
Oui, si on veut, le petit artisan qui gardait ses économies
dans un coffre à la banque, ou dans une boite de biscuits, faute de
s’intéresser au monde de la finance, ne risquait en principe pas d’être spolié.
L’étalon-or légal lui donnait cette liberté, cette transparence et cette
sécurité-là, de pouvoir retrouver son même capital en fin de carrière, ce qui
lui permettait éventuellement après 50 ans de labeur, de profiter paisiblement
de tout ce dont il s’était privé antérieurement, voire d’en faire profiter ceux
qu’il voulait protéger personnellement.
Ce mécanisme d’étalonnage par l’or vieux de 150 ans, se
greffait naturellement sur un confort de vie et un progrès technologique
croissant. En outre il favorisait par principe une gestion prudente des
ressources. Il profitait dans sa conception et sa transparence aux citoyens
sans distinction de race, d’éducation ou de statut social. Le pays qui s’y
tenait le plus strictement bénéficiait de la plus haute considération dans le
commerce international ce qui générait des profits de change supplémentaires.
Qu’est-ce qui a
changé depuis la publication initiale et qui relativiserait cette critique
de Garrett aux nouvelles institutions monétaires ayant entraîné entre autre le
Crash de 1929 ?
Il existe de grandes différences historiques avec la
période d’après-guerre : le désir d’expansion coloniale et l’esprit de pillage
qui l’accompagnait parfois, avait exacerbé les rivalités nationalistes jusqu’à
produire la plus horrible des guerres européennes en 1914. La mondialisation
des dettes a ranimé ce brasier mal éteint en Allemagne, 25 ans plus tard… a
bien des égards ceci n’est heureusement pas vraiment comparable avec ce que
nous vivons aujourd’hui en occident. Pour autant, la tentation de mener une
politique impériale est un penchant humain naturel qui a connu de nombreux
hauts et bas dans l’histoire.
Qu’est-ce qui rend
cette critique de Garrett éventuellement d’autant plus pertinente aujourd’hui ?
Tout en rivalisant de fait avec celui-ci, les agences
gouvernementales monétaires telles la Fed Reserve ont encore été instituées du
temps de l’étalon-or. Garrett a identifié cette rivalité et mis par écrit ses
craintes de voir la suppression du standard monétaire se répandre. Aujourd’hui
c’est chose faite.
Relativement, en dépit de tous les discours de
globalisation, le pouvoir géopolitique arbitraire des banques centrales est
donc bien plus vaste en ce moment. Cette influence centralisatrice locale a été
décuplée par l’abandon de toute possibilité de mesure objective et cohérente du
crédit dans le commerce international.
Même s’ils le veulent, les parlements ne peuvent plus
remettre en cause une décision, la pertinence des objectifs, le mode d’actions,
voire même, obliger ces agences monétaires modernes à divulguer publiquement
toutes leurs décisions économiques en détail. Ils ont signé les lois qui
restreignent même leur propre pouvoir de contrôle.
Une remise en cause parlementaire reste impossible sans
d’abord modifier les statuts d’indépendance garantis à la fondation de ces
agences monétaires par les générations précédentes. Voyez le sénateur
Républicain Rand Paul aux
USA qui poursuit dans la voie de son père et dénonce le pouvoir arbitraire de
la Réserve Fédérale1.
Il n’est pas impossible qu’il remporte un certain succès auprès des Américains
dont l’histoire économique est fondée différemment.
Mais dans le système monétaire européen, la chose est
devenue plus difficile : chaque nation doit d’abord convaincre des
parlementaires étrangers à son pays, afin de s’accorder avec eux sur des
objectifs fédéraux communs. Ces parlementaires représentent majoritairement des
populations disparates dont l’histoire et la langue leur sont très largement
inconnues. Pensez à l’intérêt commun qui lie politiciens grecs et allemands
pour ce qui est de mesurer la dette souveraine : il est nul a priori.
Qu’en est-il des
opposants ? Les critiques faites à l’étalon-or voire à toute forme de
contrôle des dettes souveraines (comme en comporte le traité de Maastricht)
ont-elles changé fondamentalement depuis cette époque ?
Non, on constate qu’elles sont restées les mêmes : les
économistes anglais commencèrent par annoncer que l’étalon ne
« marchait » pas. Qu’il était injuste ou antisocial vis-à-vis des
« faibles » (un peu comme on reprocherait à une règle millimétrée son
manque de compassion envers les petits). Ce mécanisme était prétendument
inutile car il ne permettait pas d’éviter les bulles et les crises de crédit.
On pense au renard de La Fontaine, lequel parlait de l’acidité des raisins qui
pendaient hors de sa portée…
Garrett explique pourtant déjà en 1932 pour sa défense, que
malgré ses avantages démocratiques évidents, le sens de l’étalon ne saurait
être d’éviter toute crise financière ou même de garantir la solidité absolue de
son propre système bancaire (ce que l’on entend souvent comme base de la
justification même des banques centrales censées le remplacer, mais avec un
succès objectif discutable). S’il est pratiqué correctement, l’étalonnage se
contente donc de standardiser l’évolution du crédit monétaire de la manière la
plus objective et sûre possible, tant pour les entreprises que pour le Trésor
public.
Pour maintenir un étalon-or, Garrett souligne qu’il faut
deux choses : des lois parlementaires qui veillent à sa mise en œuvre, à
commencer par le décret de convertibilité inconditionnelle, et la confiance du
monde entier que ces lois soient appliquées démocratiquement à long terme, sans
restriction ni discrimination positive.
Pourquoi les remises
en cause des dettes de l’Europe après guerre n’ont-elles pas déjà fait tomber
l’adhésion publique à l’étalon-or aux USA comme partout ailleurs en Europe à ce
moment-là ?
L’étalon a été supprimé de la loi américaine en d’autres
circonstances, même si les responsables (FDR et Nixon) ont évidemment profité
indirectement de ce vent qui soufflait après-guerre en Europe.
En 1918, la victoire militaire des alliés européens sur
l’Allemagne ne paraissait pas vraiment en être une, tant pour leur population
exsangue que pour celle des vaincus in extremis, et ce qu’elle avait coûté aux
gouvernements de tous bords en crédits sur leur Trésor public dépassait
l’entendement. Plaider pour une sortie de la convertibilité-or en Europe,
c’était donc déjà ébranler un peu la certitude sur ces énormes dettes vis-à-vis
de l’Amérique.
Tandis que le défaut de remboursement sur créances publiques
se généralisait en Europe, et amenait même directement le crash de Wall Street
en 1929, en principe, il renforçait théoriquement la valeur de l’étalon-or aux
yeux des USA.
Pour la population américaine en effet, il ne devait pas
exister d’alternative désirable à une juste mesure des unités de compte
permettant de garder les preuves de l’épargne que l’on devait encore lui
rembourser.
Peut-on penser, après
cette lecture, que les Américains, en prêtant cet argent aux belligérants entre
1915 et 1929, ont été justement punis d’avoir voulu s’enrichir sur le dos de
cette tragédie humaine que fut la première guerre mondiale ?
Garrett se penche longuement sur ce reproche qui justifiait
dès l’abord le défaut des remboursements Européens, surtout dans la bouche des
Anglais. Son indignation, qui est suscitée par certains responsables américains
non moins que par les Européens des deux bords, incrimine pourtant une toute
autre forme de duplicité, plus en profondeur.
Son reproche tacite ne concerne pas simplement l’appât du
gain inévitable de tel ou tel acteur réel de la société. Garrett semble
déplorer la déresponsabilisation progressive que les tribuns politiques ont
d’abord imposée à leurs concitoyens, avec force propagande, et qui oppose cette
Amérique nouvelle, ayant perdu en passant son idéal de neutralité, à l’idéal
antique de la « Res Publica », de l’honneur lié à la Parole Publique
et à l’exercice de la Politique. Les critiques de Garrett portent plutôt sur
l’image d’une nouvelle machine de crédit infernale, aux ramifications
embrouillées dont on aurait perdu le plan, et qui finit par ruiner le monde.
Finalement, après toute cette critique de la
déresponsabilisation qui nous rappelle la crise européenne actuelle, son livre
remet donc une culture à l’honneur, dont on a une vision bien trop restreinte
actuellement en dépit de l’évidence géographique : c’est la culture
républicaine philanthropique de la Grèce antique.
Garet Garrett, Une
bulle qui ruina le monde : Chroniques éditoriales américaines, 1915-1932,
traduction française Christophe Jacobs, Institut
Coppet, 2015, 216 pages.
La réflexion du jour
Nous venons d’exposer la position de ce qu’il est convenu d’appeler les intellectuels, les universitaires, les gens des médias et en général les critiques sociaux. Ces personnes ont encore moins que le votant ou l’homme public d’incitation à acquérir l’information pertinente. Cette catégorie de gens est presque invariablement anticapitaliste et pro interventionniste. --- Jean-Luc Migué
05 juillet, 2015
04 juillet, 2015
La réflexion du jour
De leur côté, les hommes d’État et les administrateurs publics ne subissent pas les conséquences directes de leurs décisions. L’enjeu d’une mauvaise allocation des soins pour eux est minime. Ils jouissent en contrepartie du pouvoir énorme de déterminer ce qui sera consommé par la population. Leurs décisions sont déterminantes. Comme l’enjeu à leurs yeux est moins grand que pour le consommateur lui-même, ils feront des choix moins appropriés que l’usager qui jouirait de la même information.--- Jean-Luc Migué
03 juillet, 2015
La concurrence est au monopole ce que la démocratie est à la dictature.
Tous conviennent que les lacunes inhérentes à la démocratie :
délais, influence indue des lobbys, abus des politiciens, etc., sont de loin préférables
aux horreurs de la dictature.
La démocratie ne se limite pas à voter périodiquement, mais consiste
surtout à permettre à des opinions différentes, voire opposées, de s’exprimer
librement et d’influencer l’évolution des politiques régissant la société. Les
débats entre les pour et les contres permettent de mieux cerner les enjeux et
d’adopter des solutions plus optimales que celles qui auraient été imposées par
une dictature, aussi éclairée soit-elle. Par exemple, les écologistes en
s’opposant à l’exploitation des énergies fossiles obligent les entreprises à
proposer des méthodes d’exploitation propres et sécuritaires. Sans être parfaites,
ultimement les politiques retenues suite à un tel processus seront généralement
plus optimales pour l’ensemble de la société que s’il n’y avait pas eu de
débats.
Ainsi, la démocratie crée les conditions favorisant une
saine concurrence entre les choix politiques qui s’offrent à nous. Cette
concurrence oblige les protagonistes à redoubler d’ardeur et de créativité pour
influencer l’opinion publique en faveur de la position qu’ils défendent.
Ce phénomène a permis aux démocraties occidentales
d’atteindre un degré de liberté et une qualité de vie bien supérieure à tous
les autres modèles de société.
Ce qui est vrai au niveau d’une société l’est tout autant au
niveau de l’économie. Une économie ouverte et libre où la concurrence entre les
entreprises domine le marché, se développera plus rapidement et offrira de
meilleurs services à meilleurs prix aux consommateurs. Par contre, une économie
dominée par les monopoles, privés ou publics, sera peu innovatrice et
favorisera le statu quo au détriment de la qualité et des coûts. Ultimement,
l’économie implosera comme l’ont expérimenté les républiques russes à la fin
des années 80s et le Venezuela
aujourd’hui.
Heureusement, le Québec a toujours une économie relativement
libre. Mais le poids des monopoles d’État et la propension des gouvernements
qui se succèdent à l’Assemblée nationale à tout réglementer nuisent au
développement du plein potentiel de l’économie québécoise.
L’environnement
économique québécois est l’un des moins libres en Amérique du Nord. Quel
que soit le critère utilisé : PIB, revenu disponible, dette, taux de
chômage, pauvreté, etc., le Québec trône honteusement dans le peloton de queue.
Malheureusement, cette situation risque de perdurer. Selon
un sondage
commandité par Cogeco, la moitié des Québécois considèrent que les
entreprises privées nuisent à la société. Dans les circonstances, les
politiciens seront peu enclins à favoriser l’entreprise privée et la
concurrence pour réduire le rôle de l’État dans l’économie.
Cette situation désolante changera seulement lorsqu’une
majorité de Québécois auront compris que la trop grande présence de l’État dans
l’économie n’est pas la solution, mais le problème.
Ce travail pédagogique de longue haleine doit débuter dès
l’école primaire. Les politiciens profitent grandement d’un État
interventionniste et ont donc peu d’intérêt à contribuer à l’effort pédagogique
nécessaire pour éduquer la population.
Heureusement, il existe des organisations telles que l’IÉDM, dont le mandat est
de promouvoir les bonnes pratiques économiques et de faire pression sur nos
élus. Est-ce que cela sera suffisant pour nous éviter la honte de se faire
imposer des solutions par les banques comme dans le cas de la Grèce? L’histoire
nous le dira.
La réflexion du jour
J'ai souvent dénoncé ce système (ndlr la gestion de l'offre), notamment parce qu'il revient à taxer des biens essentiels dans un pays où, en principe, les aliments ne sont pas taxés. L'étude manitobaine met un chiffre sur ce fardeau additionnel ; 339 $ de plus pour les 20 % des ménages au bas de l'échelle, ce qui équivaut à 2,3 % de leur revenu ; 554 $ pour les 20 % les plus riches, soit 0,5 % de leurs revenus. Le fardeau assumé par les plus pauvres est donc presque cinq fois plus élevé que celui des plus riches. C'est la définition même d'une taxe régressive. C'est pervers, et pas seulement dans le sens économique du terme.--- Alain Dubuc
02 juillet, 2015
La réflexion du jour
Le Dr Gilles Julien a fait le choix, il y a longtemps, de ne pas attendre le gouvernement pour s’attaquer aux problèmes qui le préoccupaient. Si nous étions plus nombreux à suivre son exemple, chacun à notre manière, l’État québécois pourrait mieux s’acquitter de sa « vraie job ».--- André Pratte
S'abonner à :
Commentaires (Atom)