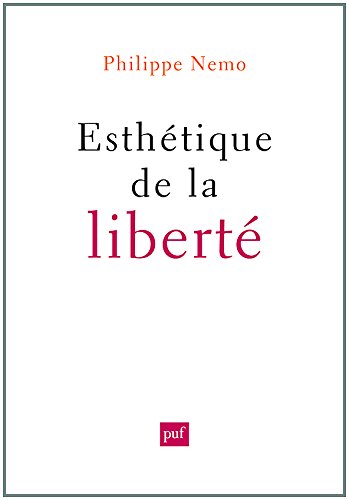Que l’État se contente d’être juste, nous nous chargerons d’être heureux.---- Benjamin Constant
Chaque Québécois doit plus de 34 000 $ au provincial seulement
Vaut mieux en rire!
Avant de couper des centaines de millions dans les services, est-ce qu’on peut avoir les services ? - Michel Beaudry
30 avril, 2015
La réflexion du jour
Le Québec abonde en ressources énergétiques, notamment l’hydroélectricité, mais les gouvernements successifs se sont trop souvent servi de la politique énergétique pour soutenir de coûteux projets réputés favorables à l’environnement, mais qui ont très peu d’impact. En même temps, les efforts en vue de développer les réserves pétrolières de la province ont essuyé retards et obstacles réglementaires, en plus de l’opposition de groupes militants. --- Youri Chassin
29 avril, 2015
Une chanson noire qui fait rire jaune.
Mononc’ Serge chante cette semaine le blues des séparatistes
et le spleen des péquistes, perdus et désorientés, prêts à se prosterner pour
une dernière fois peut-être devant leur nouveau rédempteur antisyndical sorti
des pages jaunies du Journal de Montréal.
Et tout ce qu’ils
brandissaient comme un drapeau,
Leurs héritiers le traînent comme un fardeau,
Et n’ont qu’une envie: changer de disque,
Ah! Les temps sont durs pour les séparatistes,
Et pendant qu’éclate leur baloune,
Ils quittent l’arène, regardés comme des clowns,
Quand c’est pas comme des fascistes.
Leurs héritiers le traînent comme un fardeau,
Et n’ont qu’une envie: changer de disque,
Ah! Les temps sont durs pour les séparatistes,
Et pendant qu’éclate leur baloune,
Ils quittent l’arène, regardés comme des clowns,
Quand c’est pas comme des fascistes.
Avec Raphaël D’amours au ukulele et aux guitares diverses!
La réflexion du jour
Un nouveau pacte fiscal ne fera pas naître le zèle et l’amour-propre.
D’ailleurs, l’essentiel de l’opération résidera, comme d’habitude, dans l’adjectif fiscal... Taxer, c’est la seule véritable expertise des villes. Taxer les citoyens, les entreprises, les chiens, les chats. C’est leur raison d’être. Les services sont des prétextes aux salaires, voilà pourquoi ils sont si mal rendus. Le modèle est conçu ainsi: l’important, c’est la paye.--- Michel Hébert
28 avril, 2015
La réflexion du jour
Nous payons enfin le prix pour avoir bêtement refusé en 2006 la proposition de Guy Laliberté d’ancrer le Cirque à Montréal, avec un grand projet de développement dans Pointe-Saint-Charles, comportant un casino ayant suscité l’indignation des groupes communautaires.
C’est donc dans les casinos de Las Vegas que les Québécois dépenseront leur argent pour voir leurs deux réussites culturelles de stature mondiale, Céline et le Cirque du Soleil.---Christian Dufour
27 avril, 2015
Endettement public : pourquoi utiliser des « règles d’or » ?
Quels effets ont les règles budgétaires ? Pourquoi nos
gouvernements ont-ils tendance à faire des déficits ? Comment y remédier ?
Revue de livre par Rémi Velez.
En septembre 2012, le débat public français était centré sur
la ratification du Pacte budgétaire européen et sa fameuse « règle
d’or » posant le principe de l’équilibre des budgets publics. Elle est
accusée par certains de plonger la France dans une terrible cure d’austérité.
D’autres y voient au contraire une garantie de sérieux budgétaire. Deux ans et
demi après l’intégration du Pacte budgétaire dans le droit français avec la loi
organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances
publiques, les citoyens peuvent constater que la règle d’or budgétaire a bien
peu affecté nos politiques publiques. Dès lors, quels effets ont les règles
budgétaires ? Pourquoi nos gouvernements ont-ils tendance à faire des déficits
? Comment y remédier ? L’ouvrage Les règles budgétaires. Un frein à
l’endettement de Bernard Schwengler, docteur en science politique et
professeur en sciences économiques et sociales en classes préparatoires aux
grandes écoles, répond à tout cela.
Les arguments
théoriques en faveur des règles budgétaires
L’auteur offre une présentation dense et exhaustive d’une
littérature technique à la fois théorique et pratique. L’analyse développée est
tout à fait compréhensible pour les néophytes en économie publique.
L’introduction souligne le rôle de la crise des dettes souveraines sur la
question de la discipline budgétaire. Celle-ci est devenue une obligation pour
la zone euro car les taux d’intérêt dépendent de la confiance des investisseurs
dans la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi, la mise en œuvre de règles
budgétaires réduit le coût de l’emprunt. Mais la mécanique politique fonctionne
souvent sur un endettement non maîtrisé parce que supposé illimité. Cette inclination,
ou biais, pour le déficit public ne peut être encadré que par des lois limitant
le recours à l’emprunt : des règles budgétaires. Cependant, d’après
l’auteur, toute règle budgétaire n’est pas nécessairement bonne pour les
finances publiques. À chaque pays, avec ses institutions particulières et son
environnement politique singulier, correspond un type de règles budgétaires
adaptées et donc réellement efficaces. La grande diversité des systèmes
politiques implique de penser et d’élaborer une pluralité de règles. Si le
pacte de Stabilité et de Croissance (parfois appelé faussement « critères
de Maastricht ») a échoué depuis 1997 à limiter l’endettement public,
c’est notamment parce qu’il s’applique à tous les pays de la zone euro sans les
distinguer.
Les caractéristiques
des règles budgétaires, de contrainte ou d’engagement, et leurs efficacités
Le nombre de pays aux règles limitant les déficits et le
niveau de la dette a augmenté de 5 en 1990 à 87 en 2013. Les États-Unis sont
les précurseurs : dès 1985 l’État fédéral a adopté une règle-contrainte à
son budget par l’adoption du Gramm-Rudman-Hollings Act. Elle impose des
plafonds annuels pour le déficit budgétaire. En cas de non-respect par
le Congrès des plafonds annuels de déficit budgétaire, le président
des États-Unis doit procéder à des coupes automatiques et proportionnelles
dans la plupart des finances publiques. Au contraire, les règles d’engagement,
comme notre loi de programmation des pouvoirs publics, sont insérées dans le
processus de décision politique et ne s’appliquent pas contre les choix
politiques des gouvernements. Si elles ne sont pas inscrites dans la
constitution, les règles d’engagements ne sont que des promesses. Leur support
juridique est de même valeur que la loi budgétaire. Dans le cas où elles
entrent toutes les deux en contradiction, le législateur tranche (souvent en
faveur du déficit public). Dès lors, seule la menace de sanction financière
peut inciter les parlementaires à voter des budgets à l’équilibre. Sans cela,
ces derniers sont victimes d’un biais pour le déficit : recourir aux
déficits publics leur est toujours politiquement favorable, notamment parce
qu’il est peu probable qu’ils aient à voter eux-mêmes les impôts
supplémentaires ou les coupes budgétaires exceptionnelles corrigeant dix ou
vingt plus tard leurs excès. La Cour de justice de l’Union européenne ne s’est
ainsi pas trompée lorsqu’elle a instauré des sanctions quasi automatiques pour
les déficits excessifs et des amendes pouvant aller jusqu’à 0.1% du PIB fautif.
Hélas, ces sanctions ne sont appliquées qu’aux petits pays et la France,
impunie, ne fait preuve d’aucune rigueur budgétaire.
L’impact des règles
sur la politique budgétaire française
Pour Bernard Schwengler, un mécanisme de sanction est
efficace s’il est indépendant et légitime. Ce ne semble pas être le cas dans
l’Union européenne : l’autorité de Bruxelles est parfois remise en cause
par la France qui a obtenu des dérogations de la part de la Commission
Européenne pour la réduction du déficit français. Les règles de l’Union
européenne sont fortes en théorie car elles ne sont pas suspendues à une
majorité politique et parce qu’elles sanctionnent tous les dépassements. Mais
en pratique elles se sont révélées faibles : les sanctions sont trop
légères et pas appliquées. La bonne maîtrise des finances publiques dépend
alors principalement d’une préférence politique pour la discipline budgétaire.
Ce n’est pas le cas en France où la règle budgétaire française, établie dès
juillet 2008 avec la réforme constitutionnelle, est très peu contraignante. Sa
mise en œuvre ne repose pas sur un dispositif coercitif d’un pouvoir juridique.
La loi de programmation des finances ne se situe en effet pas à un niveau
juridique plus élevé que la loi de finance. L’ancrage quasi constitutionnel de
la loi (loi organique) se limite à des dispositions de principe :
l’équilibre des comptes est posé comme objectif mais aucune échéance n’est
fixée. C’est une règle d’engagement sur les soldes structurels. L’État n’a
aucune correction budgétaire à effectuer si le dérapage des finances publiques
s’explique par la mauvaise conjoncture économique. Dès lors, il suffit de
surestimer la croissance du PIB pour valider la loi de programmation des
finances publiques comme l’ont fait nos parlementaires en estimant la
croissance française à 2% du PIB pour 2014. Les déficits importants finalement
constatés ont été mis sur le compte de la mauvaise situation économique de
l’Europe et les finances publiques ont été validées.
Bernard Schwengler, Les règles budgétaires. Un frein à l’endettement ?,
Belgique, De Boeck, 2014, 23.50€
La réflexion du jour
Si le Québec peine à prendre son envol, c’est parce que son État sangsue draine les forces vitales de l’économie pour sa seule subsistance. Tant que l’État pénalisera l’effort et le succès avec un fardeau fiscal écrasant et une montagne de réglementations débilitantes, tant que l’arbitraire de l’élite politique et des fonctionnaires prévaudra, tant que l’environnement d’affaires sera démotivant, les Québécois seront relativement moins prospères que les autres Nord-Américains.--- Nathalie Elgrably-Lévy
26 avril, 2015
25 avril, 2015
La réflexion du jour
Privatiser une partie d’Hydro-Québec Distribution pourrait être un moyen de recentrer la société d’État sur sa mission, de l’affranchir de l’ingérence politique, de la rendre plus efficace et de finalement mieux la mettre au service des Québécois. Aucun doute que plusieurs d’entre nous seraient fiers de posséder véritablement une part de cette entreprise.--- Youri Chassin
24 avril, 2015
La bourse du carbone, une taxe déguisée
Autrefois, les pouvoirs politiques s’associaient au pouvoir
religieux pour mieux contrôler les populations. Aujourd’hui, ils s’associent au
pouvoir écologiste dans le même but. Il existe une multitude de groupes écologistes
instrumentalisés pour soutenir les thèses du réchauffement climatique tel que
développées par le vatican de l’écologie, le GIEC. Grâce aux subventions
gouvernementales et à de nombreuses autres sources de financement plus ou moins
transparentes, ces lobbys ont acquis un pouvoir disproportionné, outrageusement
amplifié par des médias complaisants.
La semaine dernière, le gouvernement québécois a invité les
provinces canadiennes à une grand-messe écologique. À cette occasion, l’Ontario,
la plus grande province canadienne, près de 40% de l’économie, a annoncé
qu’elle participerait à la bourse du carbone créée par le Québec et la Californie au début
de 2015.
Les gouvernements qui participent à la bourse du carbone
imposent aux entreprises une limite maximale d’émission de dioxyde de carbone
(CO2). Celles qui excèdent la limite imposée doivent acheter des droits
d’émissions, ou plus exactement des droits de polluer, au gouvernement ou à une
autre entreprise qui possède un surplus de crédits. La bourse du carbone, une
création européenne en voie de s’établir en Amérique du Nord, a pour objectif
de faciliter la vente et l’achat des droits de polluer par les entreprises
assujetties au régime de plafonnement et d’échange de crédits de carbone.
Quoiqu’en disent les politiciens et les écolos, ce système
n’est rien d’autre qu’une taxe déguisée et un permis de polluer.
C'est le premier janvier 2015 que la bourse du carbone
nord-américaine vit le jour. Sous un prétexte populiste, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, les gouvernements imposent aux entreprises
un régime de plafonnement et d’échange de crédits de carbone qui nuira à
l’économie du Canada et plus particulièrement à celle du Québec. À l’intérieur
de la zone de l’accord de libre-échange nord-américain, incluant le Canada, les
États-Unis et le Mexique, seulement, le Québec, l’Ontario et la Californie adhèrent
à la bourse du carbone. Ainsi, la très grande majorité de nos échanges
commerciaux se font avec des États et des provinces qui n’adhèrent pas à la
bourse du carbone. Dans un contexte de libre marché nord-américain, nos
entreprises sont donc grandement désavantagées par rapport à leurs concurrents.
Selon l'économiste Youri Chassin de l'IÉDM, le prix de l'essence au Québec a
augmenté entre 3,57¢ et 4,55¢ le litre dû uniquement à cette nouvelle taxe.
Déjà que l'essence consommée au Québec est la plus taxée en Amérique du Nord,
il était indécent d'en rajouter.
Toujours selon Youri Chassin, d'ici 2020, ce sont plus de
2,4 milliards de dollars que les entreprises québécoises devront débourser pour
acheter des droits de polluer. Les entreprises devront ajuster leurs prix en
conséquence. C'est plus de 300 $ par Québécois ou 1 200 $ par famille.
Cette taxe régressive pénalisera en premier lieu les plus
pauvres de la société. Si 1 000 $ c'est bien peu pour celui ou celle qui gagne
100 000 $, c'est une tout autre histoire pour ceux et celles qui travaillent au
salaire minimum ou vivent de l'assistance sociale.
Comme si cela n'était pas suffisant, cette nouvelle taxe
nuira à la compétitivité de nos entreprises. Les entreprises du Québec et du
Canada doivent concurrencer les entreprises américaines et mexicaines. Ces
dernières profitent déjà d'un avantage considérable au niveau des coûts des
énergies fossiles. La taxe carbone ne fera qu'empirer les choses. Certaines
devront fermer, d'autres déménageront sous des cieux plus cléments. Enfin,
certaines, qui auraient considéré le Québec et le Canada pour investir et créer
des emplois, opteront pour un état américain ou mexicain.
Bien sûr, nos génies politiques profiteront de la situation
pour intervenir davantage dans l'économie. Ils bonifieront les programmes
d'aide existants et en créeront de nouveaux pour compenser le coût élevé des
énergies fossiles. C'est le cas type du politicien qui crée un problème et
ensuite promet de le résoudre. Mais à la fin, c'est toujours le même contribuable/consommateur
qui paie et s'appauvrit.
Les écologistes argumentent que les entreprises que nous
perdrons à cause de la taxe du carbone seront favorablement remplacées par des
entreprises de l'économie verte.
Je ne doute pas que l'économie verte créera un certain
nombre d'emplois. Mais les bons emplois seront créés par les entreprises qui
oeuvrent dans le domaine. Au mieux, la bourse du carbone n’y changera rien, au
pire, elle nuira à certaines entreprises au profit de celles qui auront su
obtenir les faveurs des écologistes et des politiciens.
La taxe carbone ne constitue pas un apport additionnel de
ressources dans l'économie. Elle ne fait que redistribuer l'argent des
entreprises énergivores aux entreprises oeuvrant dans le domaine des énergies
vertes. Les emplois créés par l'interventionnisme gouvernemental seront créés
au détriment des emplois dans d'autres entreprises. Au mieux, les emplois
seront déplacés de A à B. Au pire, ces emplois ne survivront que dans la mesure
où ils seront grassement subventionnés et donc voués à disparaître à plus ou
moins court terme.
Il y a plus de 150 ans, Bastiat dénonçait ce phénomène dans
le pamphlet intitulé Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Les écrits de
Bastiat sont toujours d'actualité. Ils devraient être une lecture obligatoire
pour qui veut siéger à l'Assemblée nationale.
La réflexion du jour
Je vois très bien cependant une «Pensée Unique» envahissante propagée par l’Union des artistes, les médias, la classe politique, les intellos de gauche et les écolos de tout acabit...
Et cette «Pensée Unique» repose essentiellement sur la haine pathologique des hydrocarbures associée au recours à l’État en vue d’imposer un mode de vie où la Nature divinisée (Mère-Nature) prime sur l’être humain.--- Jacques Brassard
Et cette «Pensée Unique» repose essentiellement sur la haine pathologique des hydrocarbures associée au recours à l’État en vue d’imposer un mode de vie où la Nature divinisée (Mère-Nature) prime sur l’être humain.--- Jacques Brassard
23 avril, 2015
La réflexion du jour
Le problème du Québec – et celui du PQ –, c’est que les nationalistes revendiquent pour eux seuls les attributs de l’identité québécoise et se posent comme le seul véhicule de la «survivance».
Pourtant, comme le suggère le succès mirobolant du Cirque, la quête de l’excellence est peut-être plus fertile que le repli défensif.
Et la meilleure stratégie de survie n’est pas de chercher la protection du gouvernement; c’est plutôt de se rendre incontournable.--- Benoît Aubin
Pourtant, comme le suggère le succès mirobolant du Cirque, la quête de l’excellence est peut-être plus fertile que le repli défensif.
Et la meilleure stratégie de survie n’est pas de chercher la protection du gouvernement; c’est plutôt de se rendre incontournable.--- Benoît Aubin
22 avril, 2015
Petit traité d’irresponsabilité générale
Combien de nos gouvernants ont laissé entendre que la faute
revenait à « Bruxelles », la « mondialisation » ou d’autres forces extérieures
étranges ?
Revue de livre par Erwan
Le Noan.
Un article du site Trop Libre
Les Chrétiens qui, approchant des fêtes de Pâques, ont
récemment relu les passages bibliques de la Passion de Jésus-Christ savent que,
pour se décharger de toute responsabilité, Ponce Pilate s’est « lavé les mains
» : quoi qu’il arrive à cet homme qui se prétendait messie, ce n’était pas sa
faute. Le pauvre préfet romain est resté dans l’histoire depuis 2000 ans comme
un symbole de pleutrerie, de lâcheté politique, un contre-exemple si bien ancré
dans les mentalités collectives que dans le débat qui l’opposait à François
Hollande en 2012, Nicolas Sarkozy avait utilisé son nom comme une attaque
contre le candidat socialiste.
La mythique démocratique a glorifié, à l’inverse, les héros,
ces hommes au courage extraordinaire qui assument leurs rôles et leurs
décisions, dans toute leur grandeur tragique. Dans l’histoire de France, il y a
eu notamment Napoléon, Clémenceau ou De Gaulle : aucun n’a fui devant ses
responsabilités. On n’imagine guère le fondateur de la Ve République apparaître
dans le poste, sur l’ORTF, et s’excuser devant les électeurs : « C’est pas
facile de faire des réformes » de la dépense publique et du marché du
travail ; encore moins leur dire « c’est dur » d’être Président.
Pourtant, François Hollande l’a osé, lui…
Dans leur bref et stimulant livre, Irène Inchauspé et Claude
Leblanc, journalistes à L’Opinion, reviennent sur cette perte totale du
sens des responsabilités. C’est pas ma faute, voilà l’antienne pathétique,
mais favorite, des responsables politiques français de ce début du XXIe siècle.
L’Europe, l’Allemagne, la crise, chacun de nos élus a son bouc émissaire
préféré. Les plus audacieux, comme ce député frondeur battu dimanche aux
départementales, accusent même le peuple qui n’est pas allé voter ; jamais ils
ne supposent que ce sont les faiblesses de leur propre offre politique qui ont
retenu les électeurs loin des urnes.
Il faut dire qu’entre 1958 et 2015 sont passées près de
soixante années d’État providence. Six décennies pendant lesquelles la prise en
charge publique n’a cessé d’étendre son emprise sur la société, en s’appuyant
sur un couple redoutable : impérialisme de l’impôt et généralisation des
prestations. L’un et l’autre n’ont cessé de s’immiscer dans les recoins de la
société française. Une première étape a été d’organiser un régime de Sécurité
sociale et professionnelle, qui planifiait une redistribution des revenus par
ses prises en charge garanties. Par la suite, en 1959, c’est à l’impôt sur le
revenu qu’est revenue également cette mission : la loi de finances pour 1960
l’a rendu intégralement progressif. La fiscalisation croissante des recettes de
la Sécurité sociale poursuit aujourd’hui cette dynamique, nécessaire pour
soutenir un régime qui distribue toujours plus d’argent, plus de 20 % du PIB.
Ce système d’assurance anonyme et généralisée a lentement,
indiciblement, mais sûrement sapé toutes les bases de l’autonomie individuelle
et donc de la responsabilité qui lui est consubstantielle. À quoi bon se
soucier du vieillard voisin de palier par un été de canicule, puisque le Saint
Empire étatique a nécessairement un service administratif chargé de veiller sur
lui ? La dépense publique n’écarte pas seulement l’économie privée, elle
produit un effet d’éviction sur la responsabilité personnelle. Comme le montre
le petit ouvrage, nous voici désormais dans un système de fuite généralisée
devant les responsabilités.
Cette faillite politique explique certainement l’échec
réformateur de la France depuis trente ans. Dans le discours politique, comme
dans les programmes de gouvernement, la réforme n’est pas portée comme un
projet, mais soutenue comme un fardeau épuisant. Elle n’est jamais présentée
comme une opportunité de nous renouveler, mais subie comme une contrainte
imposée de l’extérieur. Combien de nos gouvernants se sont succédés, laissant
entendre que la faute revenait à « Bruxelles », la « mondialisation », la «
finance » ou d’autres forces extérieures étranges et méconnues ?
Pire, combien ont jugé que leurs plans technocratiques
parfaits avaient échoué par bêtise populaire ? Combien sont convaincus que les
réformes sont impossibles parce que les Français seraient incapables de
changer ? Ils se rassurent sur leur immobilisme en rejetant la faute : si rien
ne change, ce n’est pas que le courage leur manque, c’est qu’ils ne veulent pas
heurter inutilement une opinion publique censée être frileuse. En réalité, les
réformes les mieux pensées échouent souvent parce qu’elles sont les plus mal
appliquées, préparées par des aréopages technocratiques, concentrés
d’intelligences abstraites dépourvues de sens pratique, elles sont conçues sans
mode d’emploi, elles sont mises en œuvre sans méthode.
De déresponsabilisation en recherche de boucs émissaires, un
discours d’impuissance politique s’est généralisé. Il a ruiné la réforme. Il
fait le bonheur des deux Fronts (national et de gauche), qui prospèrent sur la
démagogie et prétendent incarner le verbe fait action, alors qu’ils se
contentent de gesticuler et de vociférer.
S’ils veulent regagner en crédibilité, les candidats à
l’élection présidentielle de 2017 et les partis qui les accompagnent doivent
définir précisément ce qu’ils feront et surtout comment ils le feront : le
discours de la méthode sera aussi important que l’esquisse d’un projet
collectif, car il dessinera des pistes concrètes de réalisation et obligera à
assumer des choix, à assumer des responsabilités. Irène Inchauspé et Claude
Leblanc écrivent :
« La France est en crise et le restera tant que chacun
d’entre nous, des gouvernants au citoyen lambda, trouvera prétexte à ne pas se
sentir responsable. »
Leur livre est un appel à la responsabilité, à l’autonomie,
à la liberté. Pour les auteurs, les jeunes pourraient porter un renouveau.
Il faut les comprendre, le taux de chômage des 15-24 ans est systématiquement
supérieur à 15 % quasiment depuis 1982. Comprend-on bien ce que cela signifie ?
Toutes les personnes nées depuis les années 1970 n’ont connu d’autres
perspectives que le chômage de masse ! Pour les plus jeunes, ce contexte
professionnel obturé s’est accompagné de la faillite continue des finances
publiques, de l’explosion de l’échec scolaire et de l’abandon méritocratique,
figés dans l’immobilisme social ou matraqué d’une fiscalité confiscatoire.
Comment, dans ce contexte, croire au prétendu miracle de notre modèle social ?
Comment faire autrement que ne compter que sur soi-même ? Les jeunes des élites
se précipitent à l’étranger, pour étudier, travailler et vivre. À l’issue d’un
extraordinaire paradoxe, l’État providence qui recherchait la solidarité des
Français produit leur atomisation dans la nouvelle génération. La puissance
publique, qui a engendré le syndrome du « c’est pas ma faute », produit chez
les jeunes générations un « c’est plus mon problème » qui sera peut-être,
demain, un nouveau défi…
Irène Inchauspé et Claude Leblanc, C’est pas ma faute, Éditions du Cerf, mars 2015, 143
pages.
La réflexion du jour
Enfin, la culture ambiante rend l'enrichissement difficile ici. Je parle d'une part de cette allergie canadienne et encore plus québécoise à l'égard de la richesse. Cette dernière est perçue un peu comme une maladie ou pire, comme un vice. C'est triste et désolant.--- Bernard Mooney
21 avril, 2015
La réflexion du jour
«J'ai été expatriée au Royaume-Uni pendant quelques années. À mon retour au Québec, en 2010, je ne peux compter le nombre d'heures de travail manquées afin de m'occuper de la paperasse (RAMQ, permis de conduire, etc.). Pas très loin des 12 travaux d'Astérix. À mon arrivée à Calgary, j'ai pu obtenir ma «Health Card», mon permis de conduire et mes immatriculations en 30 minutes à un seul endroit. Oui, il y a des frais pour le service [environ 50$ pour tout ça], mais aucune heure de travail manquée... Faites le calcul.--- Geneviève Groulx via Francis Vailles
20 avril, 2015
Qui sont les vrais voleurs?
Un discours enflammé de l'eurodéputé Godfrey Bloom.
"... quand les gens se seront vraiment rendu-compte de qui vous êtes, il ne leur faudra pas longtemps pour prendre cette Chambre d'assaut et vous pendre. Et ils auront raison."
La réflexion du jour
À mon humble avis, le ministre Blais devrait profiter de la fin de la session législative en juin pour présenter un projet de loi modifiant l'accréditation des associations étudiantes. Ce projet devrait préciser textuellement qu'une association étudiante ne peut - sous aucune considération - décréter ou encourager de quelque façon que ce soit un boycott ou une grève. En cas de contravention, la loi devrait prévoir le retrait de l'accréditation, le tout assorti de pénalités financières pour l'association et ses administrateurs - tenus personnellement responsables.--- Stéphane Gendron
19 avril, 2015
18 avril, 2015
La réflexion du jour
Pas réinventer le monde, sauver les bélugas, stopper les forages et obtenir la gratuité scolaire. Ils rêvent d’aisance financière pour eux et pour leur société. La moitié des 18-34 croit que le Québec doit exploiter ses ressources pétrolières, même si la protection de l’environnement doit passer en premier lieu. On ne peut leur reprocher de porter des lunettes roses: seulement 25 % pensent que le Québec sera sans pétrole d’ici 25 ans.--- Lise Ravary
17 avril, 2015
Le libre marché pour sauver le système de santé québécois
De 2002 à 2014, les
coûts du système de santé ont augmenté de plus de 80% pour atteindre 30
milliards de dollars. Pourtant, les urgences débordent toujours, des centaines
de personnes attendent une chirurgie depuis plus de six mois, des milliers de personnes
âgées attendent une place en foyer d’hébergement, des centaines de milliers de
Québécois n’ont toujours pas de médecins de famille. Où sont allés les 14 milliards
de dollars d’augmentation des dépenses?
Les lois 10 et 20
sont du rafistolage
Bien sûr, l’inflation
et le vieillissement de la population expliquent une partie de cette
augmentation. Toutefois, la majeure partie de la croissance effrénée des coûts
du système de santé est due à la propension du système à s’engraisser :
croissance compulsive de la bureaucratie et multiplication des embûches
génératrices d’inefficacité qui ne peuvent être réglées qu’avec plus de
bureaucrates.
Les lois
10 et 20 visent à réduire la bureaucratie en compressant les structures et
en imposant des quotas de rendement aux médecins. Il est possible que ces mesures
freinent momentanément le taux de croissance historique de 4,5 à 5% des coûts
du régime de santé. Mais cela sera insuffisant, car les défauts du système
demeurent entiers. À plus ou moins long terme, le naturel reviendra au galop et
l’augmentation incontrôlable des coûts sera de nouveau à l’ordre du jour.
Le problème
Notre système de santé fonctionne dans la plus pure
tradition des régimes planifiés de l’ère soviétique.
Dans les économies planifiées comme celles des régimes
communistes, les apparatchiks croyaient que le gouvernement était apte à décider ce dont les individus avaient
besoin. Ils devaient donc prendre les décisions pour eux et les leur imposer si
nécessaire. Mais aucun apparatchik, aussi intelligent soit-il, ne peut posséder
toutes les informations nécessaires à l’élaboration de tels plans. Personne ne
peut voir ou comprendre les multiples ramifications d’une décision sur
l’ensemble de la société. L’histoire a démontré que l’économie et la société
prospèrent seulement lorsque les entrepreneurs, employeurs, travailleurs, et consommateurs
sont libres de prendre les décisions les mieux adaptées à leur situation particulière.
Les gouvernements n’ont tout simplement pas les
moyens : argent, temps, ressources humaines, leur permettant de planifier
toute une économie. Les tentatives d’économie planifiée ont toutes échoué et
ont condamné des millions de personnes à la misère.
Contrairement à la croyance populaire, savamment entretenue
par les proétatistes, ce que beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre, c’est
que l’économie de marché est bel et bien planifiée.
Chaque jour, des millions
de personnes prennent des décisions dans le but exprès de maximiser leur
bien-être. C’est une planification décentralisée en constante évolution. Au fur
et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles, les agents
productifs et les consommateurs ajustent leurs décisions pour minimiser les
inévitables déséquilibres entre surplus et pénuries. Aucun gouvernement ne peut traiter autant
d’informations en si peu de temps et même s’il le pouvait, il ne pourrait pas
traduire cette information en action en temps opportun.
Ce qui est vrai pour
une économie l’est tout autant pour un régime aussi complexe que le système de
santé
L'introduction d'un modèle basé sur les règles du libre
marché est la meilleure façon, sinon la seule, d’améliorer le système de santé.
La concurrence obligerait les établissements à agir pour éviter d’être pointés
du doigt et pénalisés. Les gestionnaires et les représentants syndicaux devraient
s’attaquer aux vrais problèmes, sinon ils seraient voués à disparaître. Ce
phénomène est ce qui ultimement gouverne et stimule la performance des gestionnaires
dans les organisations privées qui opèrent dans un marché compétitif.
Au contraire, le labyrinthe des systèmes de surveillance et
de détermination des objectifs qui caractérise les organisations centralisées a
plutôt pour effet d’empêcher les gestionnaires et les employés d’agir dans l'intérêt
de l’entreprise. Le but des établissements de santé est de fournir à la
population des services de qualité au meilleur prix. Ce n’est certainement pas
de répondre aux priorités électoralistes du ministère ni aux priorités
corporatistes des syndicats et des ordres professionnels.
Offrir aux Québécois
un vrai choix en matière de soins de santé
L’application du principe « l’argent suit le patient »
permettrait de transformer le système de santé pour le plus grand bénéfice des
patients. Ainsi, les Québécois reprendraient le contrôle de leur vie et se
responsabiliseraient vis-à-vis de leur santé. La santé est ce qu’il y a de plus
précieux et l’individu est de loin le mieux placé pour décider comment la
préserver et comment il veut être soigné le cas échéant.
Il est inacceptable d’obliger les gens à s’en remettre sans
condition à un système dont la logique vise d’abord à satisfaire les priorités corporatives
des syndicats et électoralistes des politiciens. Tous les services de santé
offerts par l’État peuvent très bien être offerts par des entreprises privées
et publiques dans un environnement de libre marché. Il suffit de mettre en
place un encadrement qui garantit un traitement juste et équitable à tous les
établissements.
Les principes
inhérents à un système de santé universel
L’équité et l’universalité de l’accès aux services. Dans la
mesure où les services sont payés par le gouvernement, qu’ils soient fournis
par un établissement public ou privé, ce principe est en tout point respecté.
Le libre choix, pour l’usager, de son médecin et de
l’établissement où il désire être traité. Ce principe sera beaucoup mieux
respecté si « l’argent suit le patient » et s’il a le choix entre plusieurs
établissements publics et privés.
La réactivité globale du système, soit sa capacité de mieux
répondre aux attentes de la population en matière d’accès aux services. La
concurrence entre les établissements est la meilleure garantie que ce principe
sera appliqué.
Le droit des patients d’être traités à l’intérieur de délais
acceptables. Un système où les établissements sont en concurrence saura trouver
des solutions originales et économiques au sempiternel problème des listes
d’attente.
Mettre l’emphase sur
la prévention et l’accroissement de la productivité
La prévention est une notion plutôt abstraite qui exige des
efforts maintenant mais dont les bénéfices incertains se situent dans un futur
imprécis. Pour que la prévention apporte des résultats tangibles il faut lui
associer un minimum de conditions plus ou moins contraignantes. Par exemple les
campagnes de promotion anti-tabac donnent des résultats positifs en autant
qu’en même temps le prix des cigarettes augmentent. En soumettant le système de
santé au principe « l’argent suit le patient » il sera alors beaucoup plus
facile, lorsque nécessaire, d’utiliser des mesures coercitives pour supporter
les objectifs des programmes de prévention.
Une saine concurrence entre les établissements assurera au
système de santé des gains de productivité que le monopole d’État a été jusqu’à
présent incapable de livrer. Une augmentation annuelle de la productivité de
2%, ce qui est loin d’être exigeant compte tenu du gras accumulé depuis des
décennies, assurerait la pérennité financière du système. Pour s’en convaincre,
il suffit de penser à la sous-utilisation des équipements et installations, les
taux d’absentéisme du personnel, le maintien en poste d’employés et de
gestionnaires incompétents, etc. Si la productivité du système de la santé et
des services sociaux augmentait de 2% par année, les coûts croîtraient à un rythme
annuel de 2 à 3% alors que les finances du Québec croîtront aussi au rythme de
2 à 3%. Ainsi, la pérennité financière du système de santé serait assurée.
Conclusion
Je reconnais que cette proposition représente une vraie
révolution que le gouvernement jugera inacceptable. Malheureusement, les
politiciens agissent seulement lorsque les électeurs leur poussent dans le dos.
Pour cela, il faudrait que les Québécois aient compris que le centralisme bureaucratique
est moins efficace que la libre entreprise, même en matière de santé. Pourtant,
cette révolution est incontournable pour éviter la détérioration lente mais
certaine de notre système de santé. Un tel revirement ne peut se faire
rapidement et tout retard compromet d’avantage le bien-être futur de l’ensemble
des Québécois.
La réflexion du jour
En regardant passer Steven Guilbault et l’armée du monde meilleur, je me suis demandé comment nos héros (ndlr les leaders syndicaux) faisaient pour nous la jouer écolo. Pur opportunisme, sans doute. L’austérité, l’environnement, les négos... Peu importe l’endroit ou la cause, l’important, pour eux, est de se faire voir avec une foule. Ça ne change rien à leurs petits arrangements avec le capitalisme pétrolier.--- Michel Hébert
16 avril, 2015
La réflexion du jour
Eh bien, ce dédain de l’argent et de la prospérité, on le retrouve chez nombre de Québécois aujourd’hui qui n’ont de cesse d’accuser «les riches», mot suspect et passe-partout, de tous nos malheurs collectifs. Ces militants qui se retrouvent dans la rue prônent une vie simple, certes, mais non productive, à l’abri de la pollution, des banques, de la démocratie électorale, en somme du mal incarné par le néocapitalisme. Cette apologie de la pureté, un retour à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, qui affirme que l’homme naît bon, mais que la société le corrompt, est plus qu’inquiétante. Rappelons que les génocides du XXe siècle ont été initiés par des obsédés de la pureté.--- Denise Bombardier
15 avril, 2015
Éloge de la concurrence contre la connivence
Contre l’État protectionniste, Jean-Marc Daniel signe un
essai novateur qui s’inscrit dans le sillage de la pensée de l’économiste
libéral François Quesnay.
Revue de livre par Damien Theillier.
Jean-Marc Daniel économiste français, est professeur
d’économie à l’ESCP Europe. Il est également chroniqueur sur BFM Business et
directeur de la revue intellectuelle Sociétal. Il travaille essentiellement sur
la politique économique, dans ses dimensions théoriques et historiques.
« Soyons clairs, l’élite de la fin du XXe siècle était
keynésienne, il faut que celle du XXIe siècle soit quesnaysienne », écrit-il
dans l’État de connivence, par référence au grand physiocrate François Quesnay (1694-1774). Dans
cet essai à la fois brillant et provocateur, Jean-Marc Daniel analyse les
mécanismes modernes de la rente et dénonce le retour des rentiers. Oui il y a
montée des inégalités, mais pas comme on le croit !
Quesnaysiens contre
keynésiens
Pour commencer, Jean-Marc Daniel renvoie dos-à-dos les
défenseurs néomercantilistes de la « compétitivité », et les protectionnistes
qui se cachent derrière des néologismes comme la « démondialisation », tous
héritiers de théories réfutées avec succès par Quesnay dès le XVIIIe siècle. La
stratégie mercantiliste consistait à capter la croissance des autres pays, tout
en protégeant un appareil productif obsolète. Or cela se faisait au détriment
du pouvoir d’achat de la population qui subissait une dévaluation de sa monnaie
et un coût des importations élevé.
À la fin du XVIIIe siècle, l’école de la physiocratie avait
compris que la réponse au problème de la dette publique et de la pauvreté était
la croissance économique. Pour lutter contre les banqueroutes à répétition et
leur cortège de faillites, il fallait permettre la concurrence et ainsi
encourager le progrès technique. Dans son éloge funèbre de François Quesnay, le
comte d’Albion résumait ainsi les travaux de l’économiste pour assurer la
croissance : « Restreindre autant qu’il est possible les frais des
travaux, des transports, des fabrications de toute espèce. On ne peut y
parvenir sans dégradation et sans injustice que par la liberté la plus grande
de la concurrence […]. Il faut donc sur le travail ni prohibitions, ni taxes,
ni privilèges exclusifs. »
Selon Jean-Marc Daniel, comme le préconisait François
Quesnay, il est temps d’en finir avec la tentation du protectionnisme, il faut
renforcer le libre-échange, lutter contre les « prohibitions », les «
privilèges exclusifs », et miser sur la croissance de l’offre productive à long
terme, seule capable d’élever durablement notre niveau de vie.
Comment l’État génère
des rentes
Quels sont aujourd’hui les vrais obstacles aux réformes
structurelles dont la France a besoin ?
Dans L’État de connivence, son
dernier livre, Jean-Marc Daniel répond en un mot : la connivence. De quoi
s’agit-il ? D’un copinage entre secteur public et secteur privé, sur le dos du
consommateur et du citoyen. Des entreprises cherchent auprès de l’État des
protections financières ou réglementaires. Elles veulent échapper à la
concurrence et demandent à l’État de les protéger contre la perversité du
marché ou la déloyauté de la concurrence. Autant de fausses justifications
destinées à maintenir un niveau de prix largement supérieur à ce qu’il devrait
être.
Connivence entre un patronat qui craint la concurrence
par-dessus tout, une gauche protectionniste et un gouvernement qui affiche des
tendances colbertistes. Connivence organisée autour du maintien des rentes de
toutes natures, et notamment celles des nombreuses professions qui vivent des largesses
de l’État-providence… Connivence, donc, garantie par l’État, sorti de son rôle.
Et seule la concurrence permettra de mettre fin aux privilèges. Toujours
stimulant, Jean-Marc Daniel défend ici une société fondée sur le talent plutôt
que sur la rente.
Une citation résume bien son propos. Elle provient
de Luigi Zingales, dont s’inspire Jean-Marc Daniel et dont
j’avais traduit un article (ici) :
« Les Tea Parties dénoncent l’accroissement du poids de
l’État, le mouvement Occupy Wall Street dénonce lui le poids et l’emprise
énorme de grandes entreprises. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est qu’ils
combattent deux faces d’un même monstre : l’entremêlement entre l’État mammouth
et les grandes entreprises. » (A Capitalism for the People: Recapturing the
Lost Genius of American Prosperity)
Comme Zingales, Jean-Marc Daniel préconise un capitalisme au
service du peuple, un capitalisme qui tourne le dos à la connivence pour
permettre à chacun d’exprimer ses talents en se confrontant aux autres sur des
marchés concurrentiels. L’enjeu, c’est la défense du « travailleur pauvre,
mal protégé par les syndicats fonctionnarisés, qui paie trop cher les produits,
qui subit une pression fiscale devenue confiscatoire pour payer une fonction
publique pléthorique ».
Les vraies fonctions
de l’État
Selon l’auteur, l’État ne doit pas se tromper de priorité :
il doit contribuer à créer un environnement favorable à l’élévation du revenu
des pauvres, plutôt que de chercher à taxer les riches au nom de la lutte
contre les inégalités. L’impôt sur le revenu est punitif, il n’aide pas les
pauvres, il punit les riches. Le but de la politique n’est pas d’abaisser une
partie de la population. C’est au contraire de faire émerger les talents.
La politique monétaire américaine des années 2000, menée
pour permettre à l’État de s’endetter sans limites et à moindre coût, a échoué.
La concurrence est l’outil privilégié de l’action publique.
L’État ne doit pas s’interdire de réfléchir à ses propres missions en termes de
concurrence. Dans beaucoup de domaines, il n’a pas besoin d’agir lui-même, il
doit laisser le secteur privé s’organiser. « De maître d’œuvre, il doit devenir
maître d’ouvrage », écrit Jean-Marc Daniel.
La concurrence est à la fois le plus puissant outil de
régulation et de redistribution et en même temps le plus juste. C’est pourquoi
l’auteur plaide pour la suppression du statut de fonctionnaire, à l’instar de
la Suède et pour la privatisation de l’assurance maladie
Finalement, conclut-il, nous sommes arrivés à un stade où
nous pouvons changer radicalement de direction. Le communisme est derrière
nous, le keynésianisme également. Il devient possible de revenir à Quesnay et à
la concurrence.
Jean-Marc Daniel, L’État de connivence, Ed. Odile
Jacob, 198 pages.
La réflexion du jour
Les Industries Bernard et Fils ont investi ces dernières années à Island Pound, au Vermont, où ils veulent entailler jusqu’à un million d’érables. C’est de là que cette entreprise québécoise prendra son expansion future aux États-Unis, sans limites ni contraintes, sauf celles de la nature et du marché.
Le potentiel du Vermont est impressionnant, puisque seulement 2 % des érables ont été entaillés jusqu’à maintenant. On y comptait un million d’entailles en 2004 et plus de cinq millions cette année.
Est-ce que le Québec est en train de perdre son statut de royaume de l’érable à cause d’une autre de ces politiques agricoles faites pour protéger ses acquis plutôt que se positionner vers l’avenir ?--- Pierre Duhamel
Le potentiel du Vermont est impressionnant, puisque seulement 2 % des érables ont été entaillés jusqu’à maintenant. On y comptait un million d’entailles en 2004 et plus de cinq millions cette année.
Est-ce que le Québec est en train de perdre son statut de royaume de l’érable à cause d’une autre de ces politiques agricoles faites pour protéger ses acquis plutôt que se positionner vers l’avenir ?--- Pierre Duhamel
14 avril, 2015
La réflexion du jour
Pétro-Canada affiche maintenant sur son site web les détails des hausses de prix qui sont refilés aux consommateurs. Notez que c’est encore pire que prévu pour les automobilistes, car c’est bien 3.57 cents de plus que vous payez depuis le 3 mars 2015, et jusqu’à 4.55 cents de plus si vous utilisez un véhicule à moteur diesel. Remarquez aussi que le texte spécifie d’entrée de jeu que ces frais sont pour les « clients du Québec seulement ».---Youri Chassin
13 avril, 2015
Notre système d’éducation produit des cancres
Le vox pop de Guy Nantel, auprès des étudiants en grève,
démontre la profonde ignorance de nos futures élites. Il est indécent de payer
des taxes pour maintenir aux études d’éternels adolescents irresponsables.
La réflexion du jour
Cela fait de la société québécoise une société hybride, résolument scandinave dans sa conception collectiviste de la solidarité et du rôle de l'État, et donc quand il s'agit de ses droits, mais fortement teintée par l'individualisme américain quand il s'agit de ses devoirs, que ce soit la discipline, l'éthique fiscale ou la responsabilité budgétaire.--- Alain Dubuc
12 avril, 2015
11 avril, 2015
La réflexion du jour
En ajoutant la dimension monopolistique du secteur éducatif, on comprendra que les parents en ont hérité l’école de la médiocrité et le chômage, les contribuables, l’appesantissement fiscal et réglementaire. Les salaires excessifs et la permanence sont allés aux protégés du monopole syndical et bureaucratique. Le monopole public de l’éducation n’est pas qu’inefficace, il est inconciliable avec la diversité, avec la liberté de choix.--- Jean-Luc Migué
10 avril, 2015
Haïr les Américains et les armes à feu, une valeur québécoise?
Le 27 mars dernier, la Cour Suprême du Canada a conclu que
le gouvernement fédéral n’avait pas l’obligation de remettre les données du
défunt registre des armes d’épaule au gouvernement du Québec. La ministre de la
Sécurité publique, Lise Thériault, sans même réfléchir, a aussitôt répliqué que
le Québec créerait son propre registre avec ou sans les données d’Ottawa.
Je n’arrive pas à comprendre l’entêtement du gouvernement du
Québec à vouloir créer un registre des armes d’épaule aussi inutile que
coûteux. La ministre Thériault a imprudemment avancé le chiffre de 30 millions
de dollars pour créer un nouveau registre. Faut-il rappeler à la ministre que
le défunt registre du gouvernement fédéral devait coûter 2 millions $, mais à
la fin a coûté mille fois plus. Dans un contexte de rigueur budgétaire où
chaque dollar économisé compte, cet entêtement n’est pas seulement contre-productif,
il est irresponsable.
Un registre inutile
Les représentants hyperactifs du lobby proregistre affirment
que c’est un bien petit prix à payer pour éviter des catastrophes comme celle
de l’Assemblée nationale (caporal Lortie), de Polytechnique (Marc Lépine), du
collège Dawson (Kimveer Gill) et de l’université Concordia (Valéry Fabrikant).
Ne savent-ils pas que dans chacun de ces cas, les armes utilisées étaient
dûment enregistrées? Il faut vraiment être de mauvaise foi pour prétendre
qu’une arme enregistrée protégera la population des méfaits d’un détraqué.
Ils prétendent aussi que le registre est un outil utilisé
par les corps policiers lorsqu’ils répondent à un appel d’urgence. Il leur
permet de déterminer si l’individu recherché possède une arme. C’est pourtant tout
le contraire. Je doute qu’un détraqué va se dire : « zut, mon arme
est enregistrée, je ne peux donc pas m’en servir ». Même si la personne
interpellée ne possède pas d’arme à feu, elle représente toujours un danger
sérieux pour les policiers. Un marteau, une hache ou une pioche sont des outils
potentiellement létaux. Donc, un policier qui supposerait que la personne
interpellée est non armée, puisque son nom ne figure pas dans le registre,
mettrait en danger sa vie et celles de ses coéquipiers. Enfin, les criminels
n’enregistrent pas leurs armes.
La politique a ses
raisons que la raison ignore
Il faut donc chercher ailleurs les motivations du lobby proregistre
et des politiciens qui militent en faveur de la création d’un registre des
armes d’épaule.
Les politiciens font fi de la réalité, car ce qui compte
pour eux c’est de donner l’impression qu’ils font quelque chose pour protéger
la population des crimes commis par arme à feu. Ils choisissent donc d’appuyer
le lobby proregistre et de donner l’illusion que la sécurité publique est renforcée
grâce à celui-ci.
La pensée unique véhiculée par les médias laisse croire que
les Québécois supportent quasi unanimement le registre. Donc, tous les
politiciens chantent en cœur « il nous faut un registre ». En clair,
les considérations électoralistes priment toujours.
Les mauvaises
priorités
Si le but du gouvernement était réellement de sauver des
vies, il existe des dossiers autrement plus importants que celui du registre
des armes d’épaule. Malheureusement, il n’y a jamais eu de débat dans ce
dossier monté en épingle par les arguments hyperémotifs du lobby proregistre.
Par exemple, selon l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, près d’une personne sur cinq
souffrira d’une maladie mentale au cours de sa vie. La maladie mentale est très
fréquente et les troubles mentaux représentent près de 20 % de la charge de
morbidité pour notre société, se situant ainsi au 2e rang, comparativement à 23 % pour les maladies
cardiovasculaires et 11 % pour les cancers. Le taux d’homicide par arme
d’épaule au Canada est moins de 0,1 par 100 000 personnes, environ une
trentaine d’homicides par année pour tout le Canada.
La dépression fait plus de victimes que les accidents de la
route. Le nombre de suicides reliés à la dépression (environ 950 par année)
dépasse le nombre de décès sur les routes du Québec (environ 600 par année). En
effet, 80 % des gens qui se sont suicidés souffraient de dépression.
Dans le contexte de rigueur budgétaire actuel, dépenser 30
millions de dollars pour créer un registre des armes d'épaule, pour faire
plaisir à un groupe de pression qui carbure à l’émotion, est non seulement
irresponsable, c’est criminel.
Conclusion
Comment expliquer que pas un seul député de l’opposition,
qui pourtant s’oppose à tout ce que le parti au pouvoir propose, s’oppose à ce
projet coûteux et inutile?
Au Québec, haïr les Américains et les armes à feu est un
phénomène qui s’est imposé comme valeur québécoise. Les artistes, les
intellectuels et l’ensemble des médias se donnent bonne conscience en diabolisant
les Américains et les armes à feu. Tout politicien qui oserait remettre en
question la nécessité d’un registre des armes d’épaule serait rapidement lapidé
sur la place publique et relégué aux banquettes arrière de l’Assemblée
nationale, voire banni de son parti.
La réflexion du jour
Depuis plusieurs années, on parle beaucoup des inégalités de revenus, mais il ne s’agit pas du cœur du problème ; ce n’est qu’une conséquence d’une situation qui s’aggrave. Il y a de plus en plus de gens qui ne veulent tout simplement pas se joindre au monde moderne.Alexandre Meterissan, Hatley conseillers en stratégie
09 avril, 2015
La réflexion du jour
L’élimination du déficit n’empêchera pas le gouvernement d’emprunter pour les travaux d’infrastructures par exemple. Dans le budget Leitao, on prévoit donc que la dette du Québec passera de 197 milliards (l’an dernier) à 206 milliards cette année, 210 milliards l’an prochain, puis 214, 216 et jusqu’à 220 milliards en 2020. En y ajoutant les réseaux et les sociétés d’État, la dette totale du gouvernement du Québec dépassera probablement les 300 milliards en 2020!--- Mario Dumont
08 avril, 2015
Le discours irrationnel de la gauche
La gauche française, tout comme la gauche québécoise, tient
un discours totalement déconnecté de la réalité. Croire qu’on peut indéfiniment
vivre au-dessus de nos moyens, ce n’est pas de la pensée magique, c’est de la
folie.
La réflexion du jour
Je comprends qu’ils soient fâchés, les étudiants. L’aide financière aux études dépassera le cap des 700 millions cette année. Un record.
C’est 52,3 millions de plus que l’an dernier. Il y a de quoi être furieux, y a pas à dire!
Pour les prêts, bourses, les mauvaises créances, les intérêts payables aux banques, les Québécois débourseront 705,6 M$ au profit des étudiants, indiquent les crédits budgétaires rendus publics jeudi.--- Michel Hébert
C’est 52,3 millions de plus que l’an dernier. Il y a de quoi être furieux, y a pas à dire!
Pour les prêts, bourses, les mauvaises créances, les intérêts payables aux banques, les Québécois débourseront 705,6 M$ au profit des étudiants, indiquent les crédits budgétaires rendus publics jeudi.--- Michel Hébert
07 avril, 2015
La réflexion du jour
Vous dépensez l’argent des autres pour les autres et dans ce cas, vous vous fichez éperdument combien ça coûte ou de ce que ça vaut. --- Milton Friedman
C’est ce qu’on voit régulièrement dans la façon cavalière que les deniers publics sont dépensés tant par les politiciens que les fonctionnaires et la façon indécente que certains se graissent la patte et celle de leur petits zamis. C’est ce qu’on voit dans la façon que certains programmes inutiles sont maintenus en vie, simplement pour préserver des jobs de fonctionnaires. ---Philippe David
C’est ce qu’on voit régulièrement dans la façon cavalière que les deniers publics sont dépensés tant par les politiciens que les fonctionnaires et la façon indécente que certains se graissent la patte et celle de leur petits zamis. C’est ce qu’on voit dans la façon que certains programmes inutiles sont maintenus en vie, simplement pour préserver des jobs de fonctionnaires. ---Philippe David
06 avril, 2015
La réflexion du jour
La Santé est malade ; il faut la soigner. La maladie est sérieuse, chronique et structurelle. Elle est devenue systémique.
De nombreux groupes d’intérêt tentent de résister au traitement et souhaitent faire dérailler cette réforme nécessaire. Seul un ministre de la Santé extrêmement fort, énergique, compétent, déterminé et bien informé pourra réussir à changer un système devenu dysfonctionnel et à en corriger le tir.--- Augustin Roy, ex-président du Collège des médecins
05 avril, 2015
04 avril, 2015
La réflexion du jour
Cette fatalité (ndlr : croissance infinie du gouvernement) est mathématique. D’une part, plus de 40% des gens ne paient pas d’impôt sur le revenu et n’ont donc aucun intérêt à la rationalisation des dépenses publiques. D’autre part, plus de gens encore travaillent pour l’État et/ou reçoivent indirectement des subsides de l’État et/ou bénéficient de l’aide directe de l’État et n’ont donc aucun intérêt à la rationalisation des dépenses publiques. Ceux qui remplissent les coffres de l’État,c’est-à-dire les vastes masses laborieuses de la classe moyenne, sont priés de se la fermer.--- Mario Roy
03 avril, 2015
Pourquoi les programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté sont-ils inefficaces?
La nécessité et l’urgence de réduire considérablement la
taille de l’État québécois pour assurer sa pérennité soulèvent automatiquement
la question : qu’arrivera-t-il aux plus démunis ? C’est une question
pertinente. Quel sera le sort des plus pauvres dans une société où tous les
programmes gouvernementaux d’aide aux plus démunis seraient abolis ?
Le gouvernement et la pauvreté.
1. Le modèle qui prévaut dans l’opinion publique québécoise.
En écoutant les lignes ouvertes et en lisant les pages d’opinion des journaux, j’ai souvent l’impression que les Québécois présument que les individus œuvrant dans le milieu des affaires se comportent systématiquement de façon égoïste. Qu’ils cherchent à maximiser leur utilité individuelle, souvent au détriment de leurs concitoyens plus naïfs, pour mieux satisfaire leurs besoins personnels. De plus, ils présument que les politiciens et les fonctionnaires sont des gens généralement altruistes qui ne cherchent pas à maximiser leur utilité personnelle, mais cherchent plutôt à promouvoir l’intérêt public. Ils considèrent donc que la tâche première du gouvernement est de protéger les faibles contre les forts. Ainsi, selon la croyance populaire, les individus sont divisés en deux groupes : les égoïstes qui œuvrent dans le domaine de l’économie de marché et les altruistes qui s'investissent dans la vie politique.
Les implications qui découlent de ces croyances politico-économiques sont importantes. Dans un marché libre de toutes entraves les individus égoïstes, économiquement forts, bien éduqués, peu scrupuleux dominent nécessairement les faibles : les handicapés physiques et mentaux, les sous-scolarisés, les minorités et les pauvres en général. Mais, puisque les individus œuvrant au sein du gouvernement sont censés être altruistes, il leur incombe d’imposer des politiques de redistribution de la richesse entre les dominants et les laissés-pour-compte. Ainsi, selon la croyance populaire, l’économie de marché cause la pauvreté des faibles alors que le comportement altruiste des politiciens et des fonctionnaires vise à rétablir un minimum d’équilibre.
Le gouvernement et la pauvreté.
1. Le modèle qui prévaut dans l’opinion publique québécoise.
En écoutant les lignes ouvertes et en lisant les pages d’opinion des journaux, j’ai souvent l’impression que les Québécois présument que les individus œuvrant dans le milieu des affaires se comportent systématiquement de façon égoïste. Qu’ils cherchent à maximiser leur utilité individuelle, souvent au détriment de leurs concitoyens plus naïfs, pour mieux satisfaire leurs besoins personnels. De plus, ils présument que les politiciens et les fonctionnaires sont des gens généralement altruistes qui ne cherchent pas à maximiser leur utilité personnelle, mais cherchent plutôt à promouvoir l’intérêt public. Ils considèrent donc que la tâche première du gouvernement est de protéger les faibles contre les forts. Ainsi, selon la croyance populaire, les individus sont divisés en deux groupes : les égoïstes qui œuvrent dans le domaine de l’économie de marché et les altruistes qui s'investissent dans la vie politique.
Les implications qui découlent de ces croyances politico-économiques sont importantes. Dans un marché libre de toutes entraves les individus égoïstes, économiquement forts, bien éduqués, peu scrupuleux dominent nécessairement les faibles : les handicapés physiques et mentaux, les sous-scolarisés, les minorités et les pauvres en général. Mais, puisque les individus œuvrant au sein du gouvernement sont censés être altruistes, il leur incombe d’imposer des politiques de redistribution de la richesse entre les dominants et les laissés-pour-compte. Ainsi, selon la croyance populaire, l’économie de marché cause la pauvreté des faibles alors que le comportement altruiste des politiciens et des fonctionnaires vise à rétablir un minimum d’équilibre.
2. La réalité.
L’hypothèse selon laquelle les individus œuvrant dans la sphère de l’économie de marché sont égoïstes alors que ceux œuvrant dans la sphère gouvernementale sont altruistes est un mythe. Il n’y a pas de raison de croire que la nature départage systématiquement les individus en deux groupes : les égoïstes et les altruistes. Chaque individu est un mélange d’altruisme et d’égoïsme dont les proportions diffèrent d’un individu à l’autre.
Il est évident qu’un grand nombre d’individus du milieu des affaires ont des comportements altruistes. Pour s’en convaincre, il suffit de faire l’inventaire de leurs contributions, en temps et en argent, aux nombreux organismes voués au mieux-être de la société. Il est tout aussi évident qu’un grand nombre d’individus œuvrant dans le domaine public ont des comportements égoïstes. Il suffit de s’arrêter aux grands titres des médias pour s’en convaincre. De plus, il est raisonnable de croire que les proportions d’individus altruistes et égoïstes dans les deux groupes, en supposant que chacun des groupes est représentatif de l’ensemble de la société, sont à peu près les mêmes.
Le fait qu’il y ait des individus ayant des comportements altruistes et égoïstes dans chacun des groupes formant une société implique que le modèle de société décrit ci-dessus ne peut exister. Le milieu des affaires et le gouvernement n’ont pas d’objectifs indépendants de ceux des individus qui les composent. Seuls les individus ont des objectifs et ceux-ci peuvent se situer n’importe où entre purement altruistes et purement égoïstes. L’économie de marché est l’outil utilisé par ceux qui y œuvrent pour atteindre leurs objectifs. De même, le gouvernement est l’instrument permettant à ceux qui y participent d’atteindre leurs buts.
Donc, la question fondamentale n’est pas de savoir si la société doit adopter le modèle dit « égoïste » (économie de marché) ou le modèle dit « altruiste » (gouvernement). Il faut plutôt s’attarder à choisir les instruments qui peuvent les mieux contribués à satisfaire les besoins de chacun des membres de la société. En d’autres mots, est-ce que l’économie de marché est un instrument plus efficace que le gouvernement pour permettre aux Québécois d’atteindre les objectifs sociaux qu’ils voudront bien se donner ?
3. Comment le gouvernement fonctionne-t-il ?
Avant de répondre à cette question, il est utile d’identifier les différences fondamentales entre le milieu des affaires et le gouvernement. Le milieu des affaires représente le domaine où les individus peuvent librement échanger des biens et services. Dans cet environnement, les échanges se font sur une base strictement volontaire. La force ne peut être utilisée pour obliger qui que ce soit à faire un échange qui ne lui convient pas. Ainsi, un échange sera effectué seulement si les partis impliqués perçoivent qu’ils reçoivent plus qu’ils ne donnent.
Au contraire, le gouvernement est le seul organisme dans une société qui peut faire appel à la force. Le gouvernement utilise son monopole sur l’utilisation de la force pour imposer le transfert des biens d’un groupe d’individus à un autre groupe d’individus. C’est cette caractéristique du gouvernement qui en fait un instrument si utile aux groupes qui en prennent le contrôle.
Puisque la démocratie implique que le gouvernement est contrôlé par la majorité, il est logique de croire que les pauvres, dans la mesure où ils sont en nombre suffisant, contrôleront le gouvernement. Ainsi, le gouvernement pourra adopter des politiques permettant de transférer une partie de la richesse des mieux nantis aux plus pauvres. Toutefois, la réalité est beaucoup plus complexe.
En fait, le concept de « majorité démocratique » est une vision de l’esprit plutôt qu’une réalité. Chaque individu a des intérêts personnels qu’il désire conserver ou améliorer. De plus, les individus ayant des intérêts en commun s’unissent pour former des groupes de pression (syndicats, associations, groupes sociaux) augmentant d’autant leur pouvoir politique.
Le but des groupes de pression est évidemment de promouvoir les intérêts de ses membres en influençant en leur faveur les politiques gouvernementales. Les syndicats demandent des lois du travail favorables à la syndicalisation. Le conseil du patronat demande la libéralisation des mêmes lois. Les agriculteurs exigent la gestion de l’offre et des prix planchers élevés. Les groupes sociaux demandent plus de subventions pour assurer leur pérennité. Etc.
Si le but premier d’un groupe de pression est d’influencer les politiques gouvernementales, ces groupes vont naturellement encourager leurs membres à voter pour les politiciens qui promettent de supporter les politiques qui leur sont favorables. Ainsi, le but du politicien est de s’engager à supporter les demandes des groupes de pression représentant suffisamment de votes pour être élus. On est loin d’une démocratie où chacun vote librement dans le but d’élire un gouvernement représentant les intérêts de la majorité de la population.
Dans ce système, malgré leur nombre, les pauvres sont les grands perdants. Ils leur manquent les trois éléments essentiels pour influencer l’appareil politique : le temps, l’argent et les compétences. Malgré le fait qu’il y ait de plus en plus de programmes et d’argent dédiés à enrayer la pauvreté, les pauvres sont toujours là. Il faut se rendre à l’évidence. La machine gouvernementale et les groupes de pression qui se sont donné pour mission d’aider les pauvres engloutissent la majorité des budgets et bien peu de cet argent se rend aux destinataires.
L’économie de marché et la pauvreté.
1. Les statistiques sont trompeuses.
Selon l’Institut de la Statistique du Québec, près de 16% de la population québécoise vit sous le seuil de faible revenue (SFR), soit plus d’un million de personnes. Ces statistiques trompeuses servent bien les nombreux groupes de pression dont l’existence même dépend du plus grand nombre possible de pauvres. Elles servent bien aussi les politiciens qui s’en servent pour justifier la croissance du gouvernement sous le prétexte vertueux de redistribuer la richesse.
Ces statistiques alarmantes soulèvent plus de questions qu’elles en répondent.
Une donnée statistique représente une photo de la situation
à un moment précis dans le temps. Il est certain qu’un grand nombre des
individus gagnant un revenu moindre que le SFR à un moment donné ne feront plus
partie de ces mêmes statistiques dans un mois, un an ou deux ans. Ces
personnes, en voie d’escalader l’échelle socio-économique, sont-elles vraiment
des personnes pauvres ?
Les taux de taxation marginaux quasi usuraires pratiqués au
Québec sont à une invitation à développer l’économie au noir. Différentes
études concluent que l’économie au noir représente entre 3% et 16% du PIB
canadien. Selon le ministère des Finances, l’économie au noir au Québec
représente des pertes fiscales de plus de 3 milliards $. Combien de personnes
gagnant moins que le SFR ont des revenus non déclarés ?
Un certain nombre de personnes choisissent un mode de vie
qui les maintient en bas du SFR. Certains par choix personnel, d’autres
beaucoup plus nombreux et moins scrupuleux, dans le but exprès de profiter au
maximum des largesses du système. Elles ne se considèrent pas pauvres pour
autant.
Il n’y a pas de doute qu’il existe des gens pauvres au Québec. Toutefois, la réalité est beaucoup moins dramatique que ne le laissent entendre les statistiques officielles.
2. Les limites de l’aide gouvernementale.
En supposant que la perception qui prévaut dans l’opinion publique soit réelle et que le gouvernement pratique des politiques altruistes favorables aux plus pauvres, la réalité impose des limites importantes à la capacité du gouvernement à enrayer la pauvreté.
Prenons le cas du système d’éducation. Un des objectifs visés par une politique d’éducation primaire et secondaire gratuite et obligatoire et par une politique de frais de scolarité ridiculement bas pour les études postsecondaires est de favoriser l’accès aux études aux enfants des familles pauvres. Ceci croyait-on allait briser le cycle de la pauvreté. Toutefois, en réalité, cette politique a favorisé l’accès aux études aux enfants des familles de classe moyenne et élevée. Les enfants des familles pauvres continuent trop souvent d’alimenter le marché du travail dès qu’ils atteignent l’âge légal.
Le monopole d’État centralise les décisions entre les mains
de quelques fonctionnaires. Le directeur d’école et les professeurs, coincés
entre les fonctionnaires et la convention collective, ne peuvent que constater
les dégâts. En particulier dans les milieux défavorisés, ils sont
continuellement soumis aux abus des enfants, des parents, des fonctionnaires et
des représentants syndicaux. Faut-il se surprendre si parfois ils remettent en
question leur choix de carrière. Le système est congestionné, sclérosé avec
pour conséquence l’augmentation sans fin des coûts et la diminution constante
de la qualité. Les parents qui sont prêts à tout sacrifier pour assurer
l’avenir de leur progéniture envoient leurs enfants à l’école privée. Les
enfants des parents pauvres n’ont d’autres choix que de fréquenter leur école
de quartier. Les plus débrouillards s’en tireront envers et contre tous, mais la
plupart reçoivent une éducation médiocre qui leur garantit une place permanente
chez les pauvres.
Cette constatation prévaut à des degrés divers dans tous les domaines monopolisés par l’état. Les pauvres sont bien utiles pour justifier l’interventionnisme de l’État, mais ils sont toujours les derniers à recevoir l’aide promise. Malheureusement, trop souvent ils ne reçoivent que des miettes.
Les statistiques économiques de l’OCDE démontrent que dans les économies modernes la pauvreté diminue lorsque la croissance économique excède la croissance démographique. Les programmes gouvernementaux mis sur pieds pour enrayer la pauvreté ont au mieux des effets positifs à court terme et au pire détournent des fonds qu’il aurait mieux valu utiliser pour créer de la richesse.
3. Les avantages de l’économie de marché.
Devant l’incapacité des gouvernements à enrayer la pauvreté il faut se demander si l’économie de marché peut faire mieux.
L’économie de marché tend naturellement à utiliser tous les facteurs de production disponibles, incluant la main-d’œuvre, de manière à améliorer son efficacité. En recherchant le profit, l’entrepreneur favorise l’utilisation de main-d’œuvre ou de machinerie selon qu’il juge que l’un ou l’autre lui procurera un avantage compétitif. Ainsi, les ressources nécessairement limitées d’une économie sont allouées de façon à optimiser la croissance économique ce qui en retour favorise la création d’emploi et la diminution de la pauvreté.
Certains des emplois créés seront peu rémunérés. Toutefois, ces emplois existeront seulement dans la mesure où des travailleurs seront disponibles pour les occuper. La plupart des gens préfèrent occuper un emploi, même peu rémunéré, plutôt que d’être exclus de la société par la rampe de l’aide sociale, comme cela se produit trop souvent aujourd’hui. Pour beaucoup de gens, le sentiment d’être utile, d’appartenir à une équipe, de contribuer à la société, sont des valeurs plus importantes que le seul salaire. Comment pourrions-nous expliquer autrement les milliers de Québécois (es) qui œuvrent comme bénévoles ? Ils transmettront ces valeurs à leurs enfants et ainsi brisera peut-être le cycle infernal de la pauvreté. L’économie de marché aide aussi les pauvres en tant que consommateurs. Les entrepreneurs libres d’optimiser les divers facteurs de production disponibles peuvent offrir des biens et services à moindre coût, les rendant ainsi plus accessibles.
4. Les vrais pauvres.
Dans un modèle de société où c’est l’économie de marché qui prédomine, qu’arriverait-il aux plus démunis, à ceux qui n’ont même pas les moyens de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires ? Quel que soit le modèle socio-économique que nous préconisons un certain nombre de personnes doivent être prises en charge par l’ensemble de la société. L’élimination de tous les programmes interventionnistes de l’état aurait deux conséquences : (1) la pauvreté découlant des politiques interventionnistes et mal avisés du gouvernement serait automatiquement éliminée ; et (2) la croissance économique accrue permettrait de dégager les surplus requis pour procurer à tous les groupes de la société des conditions de vie raisonnables.
Les Québécois sont de nature généreuse. Ils acceptent un taux de fiscalisation usuraire de plus de 50% dans l’espoir que l’argent qu’ils ont durement gagné sera utilisé parcimonieusement pour procurer à tous une qualité de vie raisonnable. De plus, ils contribuent des centaines de millions annuellement aux nombreuses campagnes de levée de fond pour financer des groupes communautaires, des activités de recherche et développement, des investissements en santé, en éducation, en infrastructures communautaires.
Devant l’incurie du gouvernement à fournir les services prépayés par les contribuables, près de 20% de la population de 15 ans et plus, plus d’un million de Québécois, consacrent 200 millions d’heures, l’équivalent de 100 000 emplois à plein temps, au bénévolat. De surcroît, le Secrétariat à l’action communautaire autonome évalue à 3,9 millions le nombre de personnes aidantes qui soutiennent des proches sans passer par un organisme communautaire. Sans l’apport des bénévoles des centaines de milliers de Québécois vivraient dans l’indigence totale. Ce n’est pas le gouvernement qui amenuise la misère des pauvres, mais les Québécois eux-mêmes. Toutefois, les politiciens, les groupes de pression et les fonctionnaires prennent tout le crédit sans même rougir.
Il n’y a aucun doute, si on leur en donne la chance, les Québécois sauront se responsabiliser face à leurs concitoyens moins chanceux. Le cas de la clinique du Dr Julien est un exemple probant. Devant l’incapacité des nombreux organismes gouvernementaux à subvenir aux besoins des enfants en difficulté du quartier Hochelaga Maisonneuve, le Dr Julien a mis sur pieds une clinique dont la réputation fait maintenant l’envie de tous. Pour éviter d’être assujetti aux politiques sclérosantes du gouvernement, le Dr Julien fait appel à la générosité des Québécois pour financer sa clinique. Il a recruté des bénévoles compétents et engagés pour remplacer le personnel syndiqué. Ainsi, il élimine le risque que l’application de la convention collective ait préséance sur les besoins des enfants. Si on pouvait mesurer le ratio de la valeur des services rendus par rapport aux ressources investies de la clinique du Dr Julien, je ne doute pas qu’il serait dix fois plus élevé que celui d’une clinique gouvernementale.
Si par miracle le gouvernement abandonnait tous les programmes d’aide aux pauvres et remettait aux Québécois, sous forme de réduction d’impôts, les économies ainsi réalisées, des milliers de Québécois de la trempe du Dr Julien auraient vite fait de mettre sur pied des organismes de remplacement qui eux sauraient apporter des solutions originales aux vrais problèmes.
Conclusion
L’opinion populaire québécoise, croyant à l’altruisme des politiciens et fonctionnaires œuvrant dans le gouvernement, demande toujours plus de politiques visant à enrayer la pauvreté. Dans les faits, les pauvres sont plus souvent les victimes plutôt que les bénéficiaires des programmes gouvernementaux. De plus, ce qui compte ce sont les résultats, pas les intentions. Même en supposant que le modèle socio-économique favorisé par les Québécois soit intrinsèquement altruiste la réalité impose d’importantes limites à la capacité du gouvernement à enrayer la pauvreté. L’économie de marché, au contraire, peut réduire la pauvreté en créant des emplois et en dégageant suffisamment de richesse excédentaire pour subvenir adéquatement au besoin des vrais pauvres.
Finalement, j’ai toutes les raisons de croire que les pauvres seraient beaucoup mieux servis par l’économie de marché que par le gouvernement.
La réflexion du jour
Pour assainir les finances publiques sans asséner le coup de grâce aux Québécois, il faut abolir les monopoles. Seul un contexte de concurrence obligerait les organes de l’État à améliorer leur productivité plutôt qu’à transférer la facture aux clients. La Suède a compris depuis fort longtemps les vertus de la concurrence.--- Nathalie Elgrably-Lévy
02 avril, 2015
La réflexion du jour
Il faut comprendre pourquoi les constituantes de l’État semblent particulièrement incapables d’équilibrer leurs budgets.
La réponse est simple: les organismes et sociétés d’État sont en situation de monopole. Or, qu’il soit privé ou public, un monopole ne ressent aucun incitatif à prioriser l’efficacité puisqu’il est à l’abri de l’impitoyable sanction exercée par la concurrence. Son marché étant par définition captif, le monopole n’a alors qu’à refiler, souvent avec outrecuidance, le coût de son inefficacité à ses clients. La flambée des tarifs d’électricité pour financer le fiasco de l’énergie éolienne en est un exemple péremptoire.--- Nathalie Elgrably-Lévy
La réponse est simple: les organismes et sociétés d’État sont en situation de monopole. Or, qu’il soit privé ou public, un monopole ne ressent aucun incitatif à prioriser l’efficacité puisqu’il est à l’abri de l’impitoyable sanction exercée par la concurrence. Son marché étant par définition captif, le monopole n’a alors qu’à refiler, souvent avec outrecuidance, le coût de son inefficacité à ses clients. La flambée des tarifs d’électricité pour financer le fiasco de l’énergie éolienne en est un exemple péremptoire.--- Nathalie Elgrably-Lévy
01 avril, 2015
Philippe Nemo : « La beauté d’une société libre »
Selon Philippe Nemo, il existe une relation entre la beauté
et la liberté, et a contrario une relation entre le socialisme et la laideur.
Revue de livre par Francis Richard
Jeudi 26 mars 2015, il est dix-neuf heures passées. Nous
sommes dans le Grand Salon Jaune de la Société de Lecture de Genève.
Laquelle se trouve dans un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle, au 11 de la
Grand-Rue, dans la vieille cité. Un lieu magique, qui fait rêver, avec sa
bibliothèque de 400.000 volumes… Après une brève présentation de Philippe
Nemo par Pierre Bessard, directeur de l’Institut Libéral, l’auteur d’Esthétique
de la liberté commence sa conférence sur « La beauté d’une société
libre ».
L’idée d’écrire son livre est venue à Philippe Nemo lors
d’un séminaire en Italie, à Dogliani, où il avait été invité à s’exprimer sur
le thème de l’anthropologie de la liberté, en octobre 2011. À cette occasion il
avait pu établir la relation entre la beauté et la liberté, la beauté et le
libéralisme. Et a contrario la relation entre le socialisme et la laideur.
Tout était en fait parti d’une fable de La Fontaine, Le loup et le chien.
Où le loup, tout maigre et efflanqué qu’il est, apparaît beau, tandis que le
chien, gras et poli, apparaît laid. Le premier est en effet libre, tandis que
le second a le cou pelé par le collier auquel il est attaché…
Philippe Nemo part de trois points :
·
Avec les philosophes grecs et chrétiens, et avec Kant, il apparaît que le
vrai, le bien et le beau ne peuvent être poursuivis que dans la liberté.
·
Il y a un lien étroit entre l’être et l’avoir :
la propriété privée permet de conserver ce que nous avons et ce que nous
sommes, alors que le collectivisme confond les avoirs et empêche les êtres de
se différencier ;
Le voyage, qui comporte de l’imprévu, change l’être et
révèle à nous-mêmes ce que nous sommes.
Conclusion : seules les sociétés libérales permettent de
donner un sens à la vie.
Barry
Smith, philosophe britannique qui enseigne à l’université de Buffalo,
définit ainsi le sens de la vie : créer une forme originale, qui modifie
le monde et qui est constatée par des témoins extérieurs. Exemples : Beethoven,
Mahomet, Alekhine (joueur d’échecs), Faraday ont donné, dans cette acception,
un sens à leur vie… Or, seules les sociétés libérales, c’est-à-dire libres,
maximisent les chances qu’un individu pris au hasard donne un tel sens à sa
vie.
Philippe Nemo conteste cependant qu’il soit besoin de
témoins extérieurs pour créer une œuvre originale qui donne du sens à la vie :
une vie peut avoir un sens sans conscience et inversement. Ce qui compte, c’est
le commerce avec les idéaux de l’esprit, une œuvre pouvant être créée en
réalité sans conditions. Une vie, si brève soit-elle, a d’ailleurs de la valeur
si elle a plu à Dieu…
Pour Philippe Nemo, ce qui importe, c’est donc de poursuivre
les idéaux de l’esprit : il faut ainsi préférer le bien au mal et aimer la
vérité quand bien même elle n’est pas reconnue. Pour ce qui est de la beauté,
il s’agit là d’un idéal de l’esprit différent des deux précédents.
Il existe en effet deux conceptions de la beauté :
·
platonicienne : la beauté est transcendante, elle
n’est pas fonctionnelle ;
· aristotélicienne : toute découverte est
merveilleuse, elle rend semblable à Dieu, elle est le signe de la perfection,
c’est-à-dire, étymologiquement, de ce qui est fait entièrement.
Dans les deux conceptions, c’est l’idée d’éclat qui ressort.
Le sage rayonne par sa beauté morale (les Grecs parlent de καλοκἀγαθία, Cicéron
d’honestas) : le sage est bel et bon, il pratique les vertus.
Pour que la beauté puisse éclore, il y a nécessité d’un
contexte. Ce contexte pour l’homme doit favoriser l’exercice par lui des quatre
vertus cardinales que sont la prudence, la tempérance, la force d’âme et la
justice. Mais la première de ces vertus est encore la justice, parce que les
autres s’ensuivent.
Il existe deux sortes de justice :
·
la justice distributive (selon le mérite) ;
·
la justice commutative (où il y a égalité dans
les échanges).
On ne peut être pleinement juste que dans la cité. On ne
peut pas être homme dans son coin. On ne peut pas l’être dans une société de
servitude.
Dans sa Somme théologique, Saint Thomas d’Aquin,
sur 3.000 pages, en consacre 2.000 à la morale et il passe en revue vertus et
vices. Parmi les vertus connexes :
·
la véracité peut se définir comme la propension
à dire le vrai : la société socialiste favorise au contraire la tromperie sur
la marchandise par l’irresponsabilité ;
·
la libéralité consiste à donner un peu plus que
ce que l’on doit : on ne peut pas être libéral dans ce sens-là si l’on ne
possède rien ;
·
l’esprit de paix reconnaît que la prédation
n’est pas payante : il est difficile de commercer en cas de guerre et
commercer, c’est renoncer à la violence ;
·
la tolérance revient à laisser autrui faire ce
qu’il veut et à ne pas se préoccuper de ce qu’il fait : les socialismes, au
contraire, sont intolérants, par construction, puisqu’ils font des comparaisons
entre ce que possèdent les gens.
Toutes ces vertus ne peuvent donc se développer que dans le
contexte d’une société libre, où on aime produire, et non pas dans celui d’une
société socialiste, où on fait du lobbying, ce qui se traduit par un
amoindrissement de l’humain.
Philippe Nemo termine par les trois vertus théologales, la
foi, l’espérance et la charité. Ce ne sont pas des vertus qui sont en
elles-mêmes favorisées par la société libre, mais il est tout de même plus
facile de les y pratiquer que dans la société socialiste.
Répondant à des questions, Philippe Nemo remarque qu’en
France les adversaires du libéralisme ont réussi leur coup en prenant l’école,
que, si la gauche a perdu en fait la bataille des idées, elle n’en possède pas
moins les institutions, qu’elle détient le pays légal et qu’elle n’écoute pas
le pays réel…
François Hollande a déclaré qu’il ne lisait pas de
livres. En sortant de La Société de Lecture, je fais remarquer à Philippe Nemo
la phrase latine – elle est de Saint Thomas d’Aquin -, inscrite sur son
frontispice : « Timeo hominem unius libri », c’est-à-dire « Je
crains l’homme d’un seul livre ». Il me fait remarquer en retour que c’est
une phrase qu’un musulman ne devrait en principe pas apprécier… Je lui réponds
qu’il faut de toute façon craindre davantage l’homme d’aucun livre…
Philippe Nemo, Esthétique de la liberté, PUF, 2014, 220 pages.
S'abonner à :
Commentaires (Atom)