Que l’État se contente d’être juste, nous nous chargerons d’être heureux.---- Benjamin Constant
Chaque Québécois doit plus de 34 000 $ au provincial seulement
Vaut mieux en rire!
Avant de couper des centaines de millions dans les services, est-ce qu’on peut avoir les services ? - Michel Beaudry
29 février, 2016
La réflexion du jour
Après sept ans de déficit, on aurait de quoi se réjouir. Espérer quelque oxygène pour les zombies fiscalisés. Ceux qui paient des impôts pour vrai...
Mais je ne vois pas comment le gouvernement pourrait véritablement alléger leur fardeau. La révision des programmes n’a rien donné. Rien n’a changé, le Québec reste un musée. On n’abolit rien, on fusionne. On ne soustrait pas, on additionne.--- Michel Hébert
28 février, 2016
27 février, 2016
La réflexion du jour
J’aurais toutefois aimé entendre aussi les conseils, conférences et ordres professionnels concernés par la protection de la jeunesse sortir au soutien des élus et encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, quels qu’ils soient.
L’Union des artistes, qui cherche à régir la société québécoise pendant chacun de ses galas, n’avait rien à dire non plus à ses membres?
Ces organismes ne sont jamais là quand c’est le temps.--- Jean-Jacques Samson
26 février, 2016
La réflexion du jour
Au Québec, toutes les activités humaines sont peu à peu devenues imposables. On taxe même les taxes qui ne sont ni un bien ni un service. Ici, l’État taxe l’assurance à laquelle sont astreints les automobilistes. Et pour ce faire, il exige des «frais d’administration».--- Michel Hébert
25 février, 2016
La réflexion du jour
Bernard et Bélanger (2007) calculent que le récent épisode de subventions à Alcan pour l’installation d’une nouvelle aluminerie au Saguenay-Lac St-Jean équivaut à 336 000$ par année par employé pendant 30 ans. L’une des récentes innovations dans l’art de dilapider l’argent des autres prend la forme de « créneaux gagnants », qui a elle-même succédée à la «stratégie des grappes».--- Jean-Luc Migué
24 février, 2016
Le capitalisme n’existe pas
Le discours de Michel Leter, auteur du « Capital. L’invention du capitalisme » pour le prix du livre libéral 2015.
Par Michel Leter.
Après avoir dédié ce prix au regretté Jacques de Guenin, voici le discours de présentation que nous avons prononcé devant le jury du prix libéral, à l’issue de l’assemblée générale de l’ALEPS, le 16 décembre 2015 :
Avant de tenter de vous résumer brièvement ce premier livre du Capital, je tiens à faire deux remarques liminaires :
Tout d’abord sur un sujet aussi controversé que le capital, qui n’a jamais donné lieu à un consensus scientifique inattaquable, je ne prétends pas faire œuvre d’économiste mais seulement d’honnête homme, au sens que le chevalier de Méré donnait à ce terme à savoir un homme qui n’a point pour métier de penser mais qui est curieux de l’essentiel, de ce qui, à proprement parler, est capital. Le seul titre que je brigue, et ce n’est pas à moi de dire si je le mérite, est celui d’historien, d’historien des idées, discipline presque introuvable en France et qui fait de vous un polymathe et un polygraphe, espèce honnie de tous les spécialistes qui peuplent nos universités d’État, université d’État en France étant un pléonasme, ce qui empêche le capital immatériel de notre chère patrie de se former et de se développer.
La seconde remarque est que, puisqu’on trouve des économistes au sein du jury du prix du livre libéral, ils ne doivent pas non plus être des économistes de métier si l’on en juge par la recension duCapital que donne la revue des économistes de métier, Alternatives économiques, dans son numéro de mars 2015, qui me qualifie, comme de bien entendu, « d’ultralibéral (de tendance autrichienne) ».
Pour mieux épouvanter le lecteur, l’auteur de l’article, Denis Clerc en personne, le fondateurd’Alternatives économiques, cite la maxime suivante tirée de mon livre : « la redistribution n’est que l’euphémisme du vol ». Si l’on ne redistribue plus effectivement à quoi diable M. Clerc, économiste de profession, va-t-il bien pouvoir être employé ? « ce qui, poursuit l’auteur de l’article, nous donne un curieux livre, abondamment nourri de citations d’auteurs libéraux du XIXème siècle, dans lequel il est affirmé que tout homme est pourvu d’un capital (ses outils et sa connaissance) légué par le passé car soustrait « à la consommation improductive et à la production stérile « . Conclusion de ce premier tome : le capitalisme est un mythe forgé par les adversaires du capital, comme seule l’école française l’avait compris. Je pense que les lecteurs pourront s’économiser l’achat des trois volumes à venir. »
La chute est excellente non seulement parce que c’était un de mes objectifs que d’avoir la gloire d’être éreinté par Alternatives économiques, sans oser espérer que je périrais par le glaive de Denis Clerc en personne, mais aussi parce que c’est bien la première fois que ce monsieur, gourou des profs d’éco qui sévissent dans nos salles de classe, propose de faire des économies.
Je vais donc tâcher, dans les quelques minutes qui me restent de compléter le propos de M. Clerc, en commençant par éclairer le titre de ce premier live, L’invention du capitalisme. Il s’agit d’un latinisme. J’emploie invention dans le sens du mot latin inventio à la manière d’Adam Smith qui, comme vous le savez, professait les Belles Lettres, et non pas l’économie, à l’Université d’Edimburgh. Selon Cicéron, dans son traité d’art oratoire qu’il intitule justement De Inventione, l’inventio est la première partie de la rhétorique. Elle consiste à rechercher les mots et les arguments qui vont constituer le discours. Par conséquent, vous l’avez compris, L’Invention du capitalisme, premier livre du Capital, n’a rien d’un travail classique d’allure wébérienne sur le prétendu système auquel les collectivistes ont attribué le nom de capitalisme, qui serait apparu subitement au moment de ce que l’on appelle, depuis Engels, la Révolution industrielle. Rompant avec les présentations traditionnelles du sujet, ce livre est le fruit de recherches sur les moyens rhétoriques, qui ont été mis en œuvre pour accréditer l’existence de ce monstre capitalisme, de ce vampire qui suce le sang du prolétariat par le surtravail, cause de tous nos malheurs, jusqu’au réchauffement climatique puisque que, comme le GIEC de l’ONU nous somme de le croire à coup de « crosses de hockey », le réchauffement de notre planète bien-aimée date de l’industrialisation capitaliste de l’Occident.
La thèse cardinale de ce volume et du suivant également, car il faut bien deux volumes pour l’étayer, est tout simplement que le capitalisme n’existe pas. C’est une fiction sortie tout armée de la rhétorique socialiste qui a été inventée pour attribuer au libéralisme les maux causés par le socialisme.
Ce qui existe, c’est le système anticapitaliste, dont les rentes nourrissent M. Denis Clerc et ses collègues.
Le premier livre est divisé en trois parties : anthropologie du capital, sociologie du capital et poétique du capitalisme.
Anthropologie du capital
Au chapitre anthropologie du capital, je rappelle cette vérité élémentaire, oubliée depuis Marx, que l’homme n’est pas concevable sans capital ne serait-ce que parce que tout homme libre est propriétaire d’un capital premier, son propre corps, ainsi naturellement que les facultés et la force de travail qui y sont attachées, acquises par la nature mais aussi et surtout par l’éducation. Singulièrement, Marx refuse à cette Arbeiskraft, à cette force de travail la qualité de capital et c’est bien là que réside la source de toutes les erreurs du travaillisme qui inspirent jusqu’à aujourd’hui les politiques économiques.
Alors qu’il est admis, sans examen, par la plupart des universitaires, qu’ils s’affichent comme marxistes ou non, que seule une poignée de bourgeois détient le capital au détriment de la plus grande masse qui en serait dépourvue, j’ai tenté non pas tant de démontrer mais simplement de rappeler, car je fais appel au bon sens, que le capital n’est pas un accident de l’histoire surgi à la faveur de l’instauration brutale d’un système baptisé capitalisme mais le fondement même de cette anthropologie élaborée par l’école française d’économie au XVIIIe et XIXe siècle et résumée par cette formule lumineuse d’Yves Guyot : « Le capital, c’est l’homme ».
Sociologie du capital
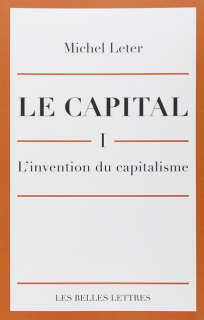 Abordons maintenant le deuxième partie du livre, intitulée « sociologie du capital ». Héritière de cette anthropologie, la sociologie du capital n’a pas été élaborée par les socialistes mais par l’école française. Marx, lui même, confessera que « des historiens bourgeois avaient exposé » bien avant lui « l’évolution historique de cette lutte des classes et des économistes bourgeois en avaient décrit l’anatomie économique ». J’identifie les auteurs auxquels fait allusion Marx et brosse un panorama de leur approche du capital : Quesnay, concepteur de la notion de classe ; Condorcet, le premier des républicains ; Destutt de Tracy, père de l’idéologie ; Augustin Thierry, historien de la spoliation ; Charles Dunoyer, auteur du texte fondateur de la lutte des classes et Adolphe Blanqui, premier historien de la pensée économique, autant d’esprits qui observent que le capital est universel et que, tandis que les excès de l’individualisme sont régulables par la loi et que rien ne régule les abus du collectivisme, le véritable antagonisme de classe n’oppose pas ceux qui accapareraient le capital à ceux qui en seraient privés mais ceux qui le créent à ceux qui vivent de sa destruction. C’est ainsi que Charles Dunoyer résume le véritable antagonisme de classes, qui selon l’école française n’oppose pas la bourgeoisie au prolétariat mais les spoliateurs aux spoliés, dans son texte fondateur publié dès 1818 dans Le Censeur européen « De la multiplication des pauvres, des gens à places et des gens à pensions ». C’est chez Dunoyer qu’apparaît l’idée, avant Marx, que la sphère sociale se divise en deux ensembles antagonistes. Mais, au lieu d’opposer frontalement les classes, la ligne de clivage passe au sein même des classes sociales, qui sont des catégories trop vagues pour rendre compte des intérêts en conflit : « Il n’existe dans le monde, souligne Dunoyer, que deux grands partis, celui des hommes qui veulent vivre du produit de leur travail ou de leurs propriétés, et celui des hommes qui veulent vivre sur le travail ou sur les propriétés d’autrui ».
Abordons maintenant le deuxième partie du livre, intitulée « sociologie du capital ». Héritière de cette anthropologie, la sociologie du capital n’a pas été élaborée par les socialistes mais par l’école française. Marx, lui même, confessera que « des historiens bourgeois avaient exposé » bien avant lui « l’évolution historique de cette lutte des classes et des économistes bourgeois en avaient décrit l’anatomie économique ». J’identifie les auteurs auxquels fait allusion Marx et brosse un panorama de leur approche du capital : Quesnay, concepteur de la notion de classe ; Condorcet, le premier des républicains ; Destutt de Tracy, père de l’idéologie ; Augustin Thierry, historien de la spoliation ; Charles Dunoyer, auteur du texte fondateur de la lutte des classes et Adolphe Blanqui, premier historien de la pensée économique, autant d’esprits qui observent que le capital est universel et que, tandis que les excès de l’individualisme sont régulables par la loi et que rien ne régule les abus du collectivisme, le véritable antagonisme de classe n’oppose pas ceux qui accapareraient le capital à ceux qui en seraient privés mais ceux qui le créent à ceux qui vivent de sa destruction. C’est ainsi que Charles Dunoyer résume le véritable antagonisme de classes, qui selon l’école française n’oppose pas la bourgeoisie au prolétariat mais les spoliateurs aux spoliés, dans son texte fondateur publié dès 1818 dans Le Censeur européen « De la multiplication des pauvres, des gens à places et des gens à pensions ». C’est chez Dunoyer qu’apparaît l’idée, avant Marx, que la sphère sociale se divise en deux ensembles antagonistes. Mais, au lieu d’opposer frontalement les classes, la ligne de clivage passe au sein même des classes sociales, qui sont des catégories trop vagues pour rendre compte des intérêts en conflit : « Il n’existe dans le monde, souligne Dunoyer, que deux grands partis, celui des hommes qui veulent vivre du produit de leur travail ou de leurs propriétés, et celui des hommes qui veulent vivre sur le travail ou sur les propriétés d’autrui ».
J’entreprends ensuite de restituer dans leur sens premier, les concepts libéraux qui ont été détournés par Marx : à savoir la lutte des classes, l’idéologie, le prolétaire. Ensuite j’actualise les définitions du capital proposées de Jean-Baptiste Say, Charles Coquelin et Yves Guyot, en proposant la définition suivante : « Le capital est dans l’ordre de la création ce qui ne vient pas du Créateur mais de la créature. Propriété d’un individu ou d’une communauté de savoirs, il est constitué par l’ensemble des valeurs antérieurement soustraites tant à la consommation improductive qu’à la production stérile et que le passé a légué au présent. »
Poétique du capitalisme
La dernière partie du livre, poétique du capitalisme, part de l’observation que le grand paradoxe ducapitalisme est qu’il n’a pas été forgé par ceux qui plaident la cause du capital mais par ses ennemis. J’entreprends alors, avec mes modestes lumières, de traquer le capitalisme dans le corpus des premiers socialistes. Rarement employé par Fourier, Leroux et Proudhon, presque introuvable chez Marx (on n’en relève qu’une seule occurrence dans le premier livre de son Capital), le mot est alors éclipsé par la figure centrale de l’imagerie antisémite, le capitaliste. Ce n’est donc pas la statistique qui imposera le capitalisme comme objet scientifique dans l’imaginaire universitaire de l’Université allemande, où domine le « socialisme de la chaire » mais une poétique où il se manifeste sous l’aspect de trois figures, l’hypotypose, l’hypallage et l’hyperbole. Tandis que l’hypotypose permet de donner à voir de façon frappante ce qui n’existe pas, l’hypallage inverse la réalité tout en la dilatant par l’hyperbole.
Vous noterez que nous n’évoluons pas seulement ici dans le vaste domaine de l’histoire des idées mais que nous sommes au cœur de l’actualité puisque ces trois fleurs de rhétorique ont orné tous les discours prononcés lors de la COP21, le réchauffisme étant, vous l’avez compris, le dernier avatar de la fiction capitalisme.
En mesurant la force de cette poétique qui domine encore aujourd’hui l’histoire des idées, on comprend, en dernière analyse, que le capitalisme n’est pas un système économique mais un mythe qui a pour fonction d’imputer au libéralisme les maux causés par le socialisme.
Les trois autres volumes
Comment une telle mythologie a-t-elle pu se constituer sans alarmer les intelligences ? C’est ce que nous tenterons de comprendre avec le livre II du Capital, intitulé Le Mythe du capitalisme, qui paraîtra en 2016. Dans ce volume, je tenterai de retracer l’histoire du système anticapitaliste, qui prend aujourd’hui trois formes principales : la guerre proprement militaire, la guerre sociale et la guerre des monnaies, ce trident étant alimenté par la monnaie-dette émise par les banques centrales.
Dans le troisième livre du Capital, intitulé Théologie du capital, prévu pour 2017, je développerai le concept de monothéisme méthodologique esquissé dans le livre I pour examiner les sources religieuses de l’anticapitalisme et tenter de penser théologiquement le capital afin de mieux le défendre, car c’est bien lui et non pas « la planète », révérée par les adeptes de la religion du citoyen, qui est en voie de disparition.
Enfin le quatrième livre, Être et capital, prévu pour 2018, doit nous conduire à réfléchir à la constitution d’une philosophie de l’avoir qui aurait dû être le fleuron de la pensée occidentale si cette dernière n’avait pas été frappée d’immobilisme par l’ontologie, cette philosophie omniprésente de l’être au nom de laquelle sont menées toutes les campagnes anticapitalistes contre l’égoïsme libéral.
- Michel Leter, L’invention du capitalisme, Les Belles Lettres, janvier 2015, 412 pages.
La réflexion du jour
Quand les entreprises peuvent transiger librement, la concurrence entre elles les force à innover et devenir plus efficaces pour survivre et se tailler une place dans le marché. Au profit du consommateur, mais aussi des travailleurs qui deviennent plus productifs grâce aux avancées technologiques, et qui voient leur pouvoir d’achat réel augmenter.
Plus fondamentalement, c'est le résultat du processus souvent incompris mais pourtant capital de la création de richesse.--- Michel Kelly-Gagnon
23 février, 2016
La réflexion du jour
Le policier, jadis protecteur du citoyen, n’est plus qu’un chasseur fiscal. Car celui qui se cache pour guetter et attraper une proie n’est rien d’autre qu’un chasseur qui, dans le cas du policier, sert d’instrument pour assouvir l’insatiable appétit d’un État glouton.--- Nathalie Elgrably-Lévy
22 février, 2016
La réflexion du jour
Comment expliquer ce comportement troublant (ndlr opposition à l'exploration pétrolière à Anticosti) de la part d’un premier ministre, autrement que par le fait qu’il soit habité, depuis Paris, d’une mission que personne ne lui a confiée, parce qu’il a été converti à l’idéologie verte ou encore parce qu’il se prépare à une carrière de prestige aux Nations unies. Qui sait? N’avait-il pas planifié la prochaine étape de sa carrière avant de démissionner du gouvernement Charest à l’époque?--- Joanne Marcotte
21 février, 2016
20 février, 2016
La réflexion du jour
Comme il se doit, les courants de gauche, très présents en santé, ont dénoncé cette réforme (ndlr l'argent suit le patient), que ce soit Amir Khadir ou les Médecins québécois pour le régime public, parce que l'idée de la concurrence leur donne de l'urticaire. Encore une fois, ils seront prêts à défendre des principes qui leur sont chers au lieu de défendre les malades, de défendre un statu quo qui ne donne pas de très bons résultats pour empêcher une réforme dont le principal résultat pourrait être de traiter plus de citoyens et de le faire plus rapidement.--- Alain Dubuc
19 février, 2016
La réflexion du jour
De toutes les époques, les gouvernements assoiffés d’un accroissement de leurs revenus ont cherché de nouveaux prétextes pour taxer davantage. Une taxe santé, une taxe pour les routes: une justification aide à faire passer la pilule. Avec de bons sondages, on trouve le prétexte à la mode!
Je dois avouer que l’environnement est le meilleur motif de tous les temps pour taxer sans être critiqué. Préparons-nous.--- Mario Dumont
18 février, 2016
La réflexion du jour
Mais dites-nous, Jean Bottari, vous qui avez travaillé auprès des aînés pendant 31 ans et qui militez aujourd’hui pour leur droit à la dignité, quel est le problème? Sa réponse ne surprend nullement: «Aucune consultation avec le milieu, tout tourne autour des besoins du système et non des patients et personne n’est imputable.»
Ah! ah! Le mal québécois dans toute sa splendeur. Celui-là, il faut plus que de l’argent pour le terrasser. Il faut des ministres à l’écoute et une volonté politique de fer.--- Lise Ravary
Ah! ah! Le mal québécois dans toute sa splendeur. Celui-là, il faut plus que de l’argent pour le terrasser. Il faut des ministres à l’écoute et une volonté politique de fer.--- Lise Ravary
17 février, 2016
La mondialisation et les mutations du Pouvoir
Le livre de Moisés Naim « The end of Power » nous parle intelligemment de la transformation contemporaine du pouvoir.
Par Jérôme Perrier.
 Pour ceux qui estiment que les sempiternelles ratiocinations de Michel Foucault, si courues dans les départements de philosophie et de science politique des universités du monde entier, n’épuisent pas la question du pouvoir, le livre de Moisés Naím, (The End of Power. From boardrooms to battlefield and hurches to states, why being in charge isn’t what it used to be, New York, Basic Books, 2013, 306 p.), devrait apparaître comme à la fois profondément iconoclaste, revigorant et roboratif.
Pour ceux qui estiment que les sempiternelles ratiocinations de Michel Foucault, si courues dans les départements de philosophie et de science politique des universités du monde entier, n’épuisent pas la question du pouvoir, le livre de Moisés Naím, (The End of Power. From boardrooms to battlefield and hurches to states, why being in charge isn’t what it used to be, New York, Basic Books, 2013, 306 p.), devrait apparaître comme à la fois profondément iconoclaste, revigorant et roboratif.
L’auteur, né en 1952 au Venezuela, est un économiste qui a occupé le poste de ministre du Commerce et de l’Industrie dans son pays natal à la fin des années 1980, avant de devenir l’un des directeurs exécutifs de la Banque mondiale. Il a aussi mené une carrière académique et une carrière de journaliste, en publiant dans de nombreux et prestigieux journaux du monde entier (El Pais, La Repubblica, The New York Times, The Washington Post, News Week, Time, etc.). En 1996, il est devenu rédacteur en chef du magazine Foreign Policy. Il est l’auteur de divers best-sellers qui lui ont valu plusieurs récompenses internationales (dont le « Prix Ortega y Gasset » en 2011) et qui lui ont aussi valu d’être classé à plusieurs reprises parmi les penseurs les plus influents de la planète1.
Son dernier livre, que nous présentons ici, a eu un écho considérable dans le monde entier. Il a été désigné par le Financial Times et le Washington Post comme l’un des meilleurs livres de l’année 2013, et il a été particulièrement remarqué par diverses personnalités mondialement connues, et surtout bien placées pour parler de la notion, au fond pas si évidente, de pouvoir. Ainsi, Bill Clinton a estimé que The End of Power « changera la façon dont vous lisez les journaux, dont vous pensez la politique et dont vous regardez le monde », tandis que Mark Zuckerberg a recommandé publiquement sa lecture en janvier 2015, renforçant ainsi l’écho déjà considérable que le livre avait acquis par ses propres mérites. Toutefois, mais nul ne s’en étonnera, ce titre, comme tous ceux de Moisés Naím, n’a pas été encore publié en français, et ne le sera vraisemblablement jamais ; ce qui témoigne une fois de plus du profond syndrome obsidional qui affecte la scène intellectuelle, et malheureusement trop souvent académique, française.
Il est vrai que l’ouvrage va à l’encontre de tous les poncifs qui saturent à longueur de journées les colonnes, les ondes et les écrans hexagonaux, par un perpétuel ressassement contre la mondialisation « qui corrompt, qui achète, qui écrase, qui tue, et qui pourrit jusqu’à la conscience
des hommes » (pour reprendre la célèbre formule mitterrandienne, qui visait alors l’argent en général). D’abord, le livre de Moisés Naím fourmille littéralement d’exemples concrets et de chiffres puisés aux sources les plus fiables, qui tous ou presque vont à l’encontre de l’image manichéenne que l’on donne en France d’un phénomène aussi complexe, et donc forcément contrasté, que ce que les anglo-saxons appellent Globalization. Sans entrer dans les détails (on pourrait citer des centaines d’exemples égrainés au fil du livre), l’auteur de The End of Power rappelle ce que tout le monde sait, au moins en dehors de l’Hexagone ; à savoir que la mondialisation des trente dernières années a permis, comme jamais auparavant dans l’histoire, à des centaines de millions, voire des milliards d’individus de par le monde, de sortir de la pauvreté, d’être mieux soignés, de vivre plus longtemps, d’être plus éduqués, etc…. ce qu’il appelle la « Révolution du More ». L’auteur ne dit évidemment pas que la pauvreté a disparu de la planète, mais il rappelle que jamais dans l’histoire les progrès économiques, sanitaires et techniques n’ont touché une telle masse de gens, et si rapidement. Et pour ceux qui le soupçonneraient de vouloir donner une image idyllique et biaisée de la réalité, je précise que Naím ne néglige aucunement certains aspects de la mondialisation qui, en France, paraissent rédhibitoires, comme la croissance de certaines inégalités (aux États-Unis notamment). Mais là ne réside pas l’intérêt majeur du livre, et surtout son caractère novateur. En évoquant d’emblée ces aspects, finalement secondaires, du propos de l’économiste vénézuélien, nous tentions simplement d’indiquer l’une des raisons pour lesquelles son livre n’a à peu près aucune chance de séduire un vaste public français, inondé du matin au soir par le psittacisme anti-mondialisateur qui fait malheureusement trop souvent office de pensée dans la patrie de Descartes…
L’intérêt profond et la grande nouveauté du livre de Moisés Naím réside en réalité ailleurs. Il réside dans la thèse principale qui le structure : à savoir, que contrairement à ce que l’on pourrait penser, le pouvoir, sous toutes ses formes, après avoir atteint son apogée au XXème siècle, connaît aujourd’hui un déclin, aussi radical que sous-jacent, et qui n’est d’ailleurs pas dénué de tout danger. Un tel argument est toutefois suffisamment contre-intuitif pour mériter quelques plus amples explications. Moisés Naím part d’abord d’une définition du pouvoir qui est assez extensive :
« Le pouvoir, écrit-il, est la capacité de dicter ou d’empêcher les actions présentes ou futures d’autres groupes ou individus » (p. 16).
Dès lors, loin de se cantonner au pouvoir politique ou militaire, Naím s’intéresse aussi de très près au pouvoir économique et culturel. De même, l’auteur ne se cantonne pas à ce que les politologues ont naguère baptisé le « hard power » (le pouvoir de contrainte, dont la forme la plus pure est le pouvoir militaire), mais il considère aussi le « soft power » (le pouvoir d’influence), dont la mesure exacte est bien entendu beaucoup plus délicate. S’inspirant de travaux célèbres (M. Weber) ou moins connus (MacMillan), Moisés Naím distingue quatre vecteurs de pouvoir : ce qu’il appelle le « Muscle » (le pouvoir de coercition) ; le « Code » (l’autorité des valeurs morales, au sens large) ; « l’Argumentaire » (« The Pitch », ou pouvoir de persuasion, de séduction), et enfin la « Récompense » (« The Reward », ou pouvoir d’incitation). Il s’agit là, bien entendu, d’idéaux-types qui, dans la réalité, sont toujours mélangés, dans une combinaison d’influence, d’autorité et de coercition qui définissent les modalités constamment mouvantes du pouvoir.
Une fois posées ces définitions préalables, l’auteur de The End of Power développe sa thèse et l’applique aux différents champs de l’activité humaine : la guerre, la politique, l’économie, le monde de la culture et de la philanthropie, etc. Et Moisés Naím montre que dans chacun de ces domaines, le pouvoir devient de plus en plus facile à acquérir, mais aussi de plus en plus difficile à exercer et à conserver. Dans une sorte d’allégorie, il commence son livre en développant l’exemple du monde des échecs, où les mutations de la compétition internationale sont comme une métaphore du phénomène général qu’il entend mettre en valeur ; à savoir des champions venus d’horizons de plus en plus variés, sur le plan géographique comme sur le plan social, et conquérant des titres de plus en plus précaires. Ensuite, à l’aide d’une multitude d’exemples, parfois anecdotiques mais toujours extrêmement parlants, Moisés Naím montre qu’alors que le XXe siècle aura été le siècle du Big-is-beautiful-and-powerful (« la taille entraîne le pouvoir et vice versa », p. 38), le XXIe siècle voit au contraire l’émergence de micro-pouvoirs qui concurrencent de plus en plus les géants en place, les supplantant parfois, avant d’être eux-mêmes concurrencés par de nouveaux entrants. Au Big Government, au Big Business, ou au Big Labor (bref aux grandes bureaucraties qui ont connu leur heure de gloire au XXe), succèdent ainsi des structures plus légères, qui sont d’autant plus redoutables qu’elles sont précisément plus souples et plus adaptables.
Depuis les guerres asymétriques (où les plus puissantes armées du monde peuvent être mises en échec par des bandes de mercenaires qui les harcèlent tels des moustiques faisant fuir un éléphant), jusqu’aux start-ups (qui en quelques années peuvent dépasser, voire absorber, des entreprises géantes qui s’étaient endormies sur leurs lauriers), en passant par les États (où de petits acteurs brouillent le classique concert des grandes puissances qui régentaient depuis plusieurs siècles les relations internationales), un même phénomène est à l’œuvre, rendant le monde à la fois singulièrement plus complexe et plus instable. Ce phénomène, qui brouille l’image d’une réalité devenue de plus en plus insaisissable, c’est l’affaissement des barrières qui jusque-là protégeaient ce que l’auteur appelle les « incumbents » (c’est-à-dire les « titulaires », ou encore les insiders, qui possèdent le pouvoir dans le système présent et font tout pour le garder et fermer la porte derrière eux), face aux assauts des « candidates » (c’est-à-dire les outsiders, les aspirants, bien décidés à tenter leur chance et à se faire une place au soleil).
La grande idée de Moisés Naím, c’est que la mondialisation se traduit, dans toutes les sphères où les hommes interagissent, par une érosion des barrières que cherchent immanquablement à dresser les pouvoirs en place pour se protéger des assauts d’acteurs de plus en plus nombreux et de plus en plus habiles à contester toute prétention au monopole du pouvoir (depuis les membres du G8 désireux de régenter entre eux l’ordre mondial jusqu’aux grandes entreprises aspirant à contrôler un marché, pour le rendre captif). Le constat de l’échec croissant de ces insiders à bloquer les outsiders(un échec qui conduit à rendre le pouvoir à la fois plus facile à acquérir et plus difficile à exercer et à conserver) est vrai du monde économique, où aucune domination du marché n’est jamais acquise (une idée que les lecteurs familiers de Mises et des autrichiens trouveront familière), comme du monde politique, où les gouvernants ont de moins en moins de prise sur les événements, réduisant trop souvent la vie politique à une sorte de scène de théâtre où l’agitation frénétique des acteurs a toutes les peines du monde à masquer leur profonde impuissance à changer la réalité. Ici, le propos de Naím est d’autant plus intéressant qu’il sait concrètement de quoi il parle, ayant lui-même, dans ses diverses carrières, côtoyé de très près les acteurs globaux, qu’ils soient gouvernementaux ou appartenant au monde des grandes entreprises.
Bien entendu, l’auteur de The End of Power relie le phénomène qu’il décrit à des évolutions bien connues, à commencer par la révolution technologique, et notamment internet. Mais justement, l’intérêt du livre réside en ceci qu’il ne se focalise pas uniquement sur la révolution du net et ne se contente pas de reprendre des idées déjà abondamment développées par d’autres. Son propos est bien plus ambitieux et prend en compte des évolutions beaucoup plus générales, à commencer par ce que Naím appelle les trois révolutions et transformations « qui définissent notre temps » (p. 11) : la « Révolution du Plus » (« the More revolution », comme la croissance économique et la croissance démographique ») ; la « révolution de la Mobilité » (« the Mobility revolution », c’est-à-dire l’explosion des échanges affectant les marchandises, les hommes, les capitaux et les informations) ; et enfin la « révolution des Mentalités » (« the Mentality revolution », à savoir les bouleversements des valeurs engendrés par les deux révolutions précédentes. Pour mieux mesurer la pertinence et l’intérêt de cette fertile grille de lecture (il n’est pas un jour où l’actualité n’apporte une kyrielle d’illustrations nouvelles du propos de l’auteur), nous renvoyons au tableau synthétique que Naím dresse à la page 72 de son livre, et que nous traduisons à la fin de cet article.
Ces quelques lignes, bien entendu, n’épuisent pas l’immense richesse d’un livre, qui impressionne à la fois par la force de son idée maîtresse et par la diversité des exemples qu’il développe à l’appui de cette thèse iconoclaste. Sa lecture est donc urgente pour tous ceux qui tentent – forcément avec difficulté – d’y voir un peu plus clair dans une mondialisation complexe, porteuse d’opportunités évidentes, mais également d’incertitudes. Ainsi, l’auteur de The End of Power ne cache pas que le phénomène qu’il identifie n’est pas sans l’inquiéter, dans la mesure où il voit dans la dissolution du Pouvoir avec un grand P un authentique risque d’anarchie, notamment dans le domaine des relations interétatiques, où la notion d’ordre international semble de plus en plus précaire. D’autres, de tendance libertarienne, pourront au contraire s’en réjouir, ou tout au moins considérer qu’après le siècle des totalitarismes, l’érosion du Big Power est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est sûr en tous les cas, c’est que ce livre roboratif est une invitation à penser la complexité du monde, loin des jugements manichéens de trop nombreux intellectuels français, perdus dans les subtilités byzantines de l’exégèse foucaldienne, ou dans les diatribes démondialisatrices, qui ne sauraient mener beaucoup plus loin que la simple indignation. Le regretté Jean-François Revel avait coutume de dire qu’un bon cours de démographie apprenait plus de choses sur le monde que toutes les ratiocinations d’Heidegger. J’ai envie de dire que quelques pages de Naím vous apprendront plus sur le monde que bien des ratiocinations médiatico-académiques.
- Moisés Naím, The End of Power. From boardrooms to battlefield and hurches to states, why being in charge isn’t what it used to be, New York, Basic Books, 2013, 306 p.
La réflexion du jour
Cette fois-ci, la confirmation nous vient de l'économiste Pierre Emmanuel Paradis, qui explique, dans une étude étoffée, qu'«en isolant de façon précise l'impact de l'école privée québécoise sur le rendement scolaire, la recherche académique confirme la valeur ajoutée de l'éducation dispensée dans ces établissements d'enseignement privés. Enfin, la concurrence entre les écoles publiques et privées a des effets bénéfiques sur la performance et l'efficacité opérationnelle de l'ensemble du système d'éducation.» --- Michel Kelly-Gagnon
16 février, 2016
La réflexion du jour
Les Québécois, pour des raisons historiques évidentes, ont tendance à s'inspirer du modèle français. Ce peut être une bonne chose, car ce grand pays est exemplaire à plusieurs égards. Le problème, c'est que nous cherchons souvent à imiter ce qu'il y a de pire du modèle français, sa conception de l'État et sa façon de réglementer les activités quotidiennes.--- Alain Dubuc
15 février, 2016
La réflexion du jour
Il ne fait pas de doute que les monopoles syndicaux opposeront une résistance farouche à toute tentative de restaurer la concurrence dans l’industrie de la santé. Ils préfèrent négocier avec un monopole d’État, à l’abri du risque de faillite et de la concurrence, qu’avec un employeur soumis aux risques du marché et déterminé à résister aux demandes excessives du syndicat.--- Jean-Luc Migué
14 février, 2016
13 février, 2016
La réflexion du jour
L’investisseur Jean-David Chamboredon le rappelait en effet récemment en citant Emma Marcegaglia, présidente d’ENI et ancienne présidente du patronat italien : « Quand il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la réglementent. » On pourrait ajouter que les Français (ndlr et les Québécois), eux, l’interdisent, en attendant d’y voir plus clair et surtout pour éviter que ceux qui ont construit une rente ne soient mis en danger.--- Philippe Silberzahn
12 février, 2016
La réflexion du jour
Peu importe que les jeunes ne s’instruisent pas. On attend d’eux qu’ils deviennent de petits soldats de gauche, de futurs manifestants, des partisans de l’impôt et de la dépense.--- Michel Hébert
11 février, 2016
La réflexion du jour
Donc, les chauffeurs de taxi veulent la désactivation de l’application Uber au Québec.
C’est quoi, la suite?
Les allumeurs de réverbères vont demander la destruction immédiate des lampadaires?
Les typographes vont militer pour l’interdiction des ordis dans les salles de rédaction?--- Richard Martineau
10 février, 2016
Uber, un exemple à suivre
Quoiqu’en disent les quelques clients qui ne savent pas
compter et qui feignent devant les caméras avoir été arnaqués pendant la
période des fêtes, ce n’est pas Uber le problème, ce sont eux. C’est trop
facile de blâmer les autres pour expliquer nos propres erreurs.
Nous devrions nous réjouir. Pour une fois, une entreprise
place les intérêts des consommateurs avant ceux des politiciens et d’un groupe
d’intérêt, les taxis. Ce n’est pas Uber le problème, c’est une réglementation
anachronique et les intérêts corporatistes de l’industrie du taxi.
Ezra Levant et Alex Pierson, porte-parole des taxis Co-Op de
Toronto, en discutent.
La réflexion du jour
Le Québec est la province la moins économiquement libre du Canada et la plus « à gauche ». On ne s'étonnera donc pas qu’il soit aussi l’une des provinces les moins riches du Canada.
On ne crée pas la richesse en la répartissant. Le gouvernement ne la crée pas non plus, car tout ce qu’il donne à l’un, il l’a confisqué de l’autre. Il est temps de changer la vieille recette de gauche appliquée au Québec depuis 40 ans qui nous appauvrit à petit feu.--- Adrien Pouliot
09 février, 2016
La réflexion du jour
Nos écoles, avec leurs diplômes soufflés à l’hélium, leurs statistiques truquées, leurs décrocheurs en vrille, leurs fonctionnaires enkystés, leurs enseignants exténués, leurs penseurs en panne de contenu, nos écoles sont à notre image collective. En désuétude.---Denise Bombardier
08 février, 2016
La réflexion du jour
Robin des Bois était un héros parce qu'il rendait aux producteurs de richesse ce que le fisc leur volait. Ce genre de héros serait certainement utile dans une société comme la nôtre, et comme dans bien d'autres aussi. Quand on voit le niveau de taxation déjà élevé qui ne cesse d'augmenter, on aurait bien besoin d'un héros en collants verts pour nous venir en aide.--- Jasmin Guénette
07 février, 2016
06 février, 2016
La réflexion du jour
Naturellement, personne ne refuserait de payer des impôts raisonnables afin de financer des services publics de qualité. Mais lorsque le régime fiscal flirte avec l’extorsion, lorsque les cas de corruption et de dilapidation de fonds publics sont légion, pourquoi alimenterait-on davantage l’appétit gargantuesque d’un État glouton? Et pourquoi garnirait-on les coffres de ces experts en gaspillage alors que la qualité des soins de santé, du réseau routier et du système d’éducation est inversement proportionnelle aux sommes dépensées?--- Nathalie Elgrably-Lévy
05 février, 2016
La réflexion du jour
Dans l’ensemble du pays, les employés publics comptent pour 18% de la main-d’œuvre mais pour plus de la moitié des jours perdus en grève dans une année type. Certains analystes estiment même que la production publique devient dans ce contexte, non pas une activité au service de la population consommatrice, mais plutôt une machine à fabriquer des jobs et des conditions favorables aux syndiqués. --- Jean-Luc Migué
04 février, 2016
La réflexion du jour
L’État redistribue ou investit avec incompétence l’argent puisé dans nos poches et dans celles des entreprises. On n’a qu’à suivre nos prétendus investissements collectifs dans des projets d’avions et d’éoliennes risqués et peu rentables pour se convaincre qu’il est beaucoup plus facile de dilapider la richesse des autres que de la créer.--- Pierre Simard
03 février, 2016
Le modèle québécois égal pauvreté
Nous sommes tellement
habitués à ce genre de manchettes, c’est à peine si cela se fraye encore une
place dans les bulletins de nouvelles. Le Québec est la province la plus pauvre
du Canada. L’Île-du-Prince-Édouard a connu une meilleure croissance depuis deux
ans. Cette minuscule province nous a dépassés. Dixième sur dix.
Ces données de
l’Institut de la statistique du Québec auraient dû semer la panique dans la
population, nous servir un électrochoc pour revoir tout notre modèle
économique.
On devrait voir des
gens s’arracher les cheveux, des vieillards frapper les lampadaires avec leur
canne et des politiciens pleurer de rage. Rien de tel ne se produit au Québec.
Les causes
structurelles à la base de tout ça? Et là, c’est moi qui le déduit: des
politiques sociales qui favorisent la dépendance plutôt que la mobilité sociale
et un réel appui ciblé aux plus vulnérables, un plus grand nombre de personnes
âgées, une prétention à vouloir se payer un État qui est le « paradis des
familles », une incapacité à attirer des investisseurs étrangers qui
offriraient des « jobs plus payantes », une soumission à la nouvelle
religion verte, et un système d’éducation qui réussit trop peu à
diriger nos jeunes vers des techniques et des professions en manque de
main-d’oeuvre hautement qualifiée. A-t-on besoin de nous rappeler que la
proportion d’analphabètes fonctionnels est plus élevée chez les 16-24 ans (49
%) que chez les 25-44 ans (42 %) si l’on en croit ce
que raconte le Journal? Pas diable mieux chez les chômeurs, selon
ce que rapporte Francis
Vailles de La Presse. Gênés?
À écouter et à réécouter, surtout par tous les syndicalo-gauchistes
qui s’évertuent à appauvrir les Québécois.
(Tiré du film documentaire québécois réalisé par Joanne
Marcotte - L'Illusion Tranquille sortie en 2006.)
La réflexion du jour
Pourtant, les hôtels et les taxis sont ceux qui ont réclamé une réglementation avec des coûts élevés pour exclure les petits concurrents hors de ces industries. Maintenant que des concurrents qui peuvent facilement échapper à cette réglementation ont émergé, cette réglementation coûteuse se retourne contre eux. Si tout le monde devait être mis sur un pied d'égalité, ce devrait être en abaissant les taxes et en réduisant la réglementation, non pas par le renforcement des barrières réglementaires qui créent des inégalités de traitement.--- Mathieu Bédard
02 février, 2016
La réflexion du jour
La dernière étude du Centre sur la productivité et la prospérité, dont il est le directeur, montre que l’aide de 3,4 milliards offerte aux entreprises en 2013-2014 a essaimé dans quelque 50 différents crédits d’impôt, dans 84 programmes administrés par au moins 11 ministères et organismes, et dans 500 organismes financés, à leur tour, par l’entremise de 40 programmes administrés par 8 ministères.--- Robert Gagné
01 février, 2016
La réflexion du jour
Le Québec ne peut pas bloquer systématiquement les projets qu’on lui présente en invoquant une part de risque. Le risque zéro n’existe pas. Ou bien, pour être conséquent, il va falloir consentir à une réduction des paiements de transfert. C’est la vieille histoire du beurre et de l’argent du beurre. On ne peut pas avoir les deux. Il faut choisir.--- René Vézina
S'abonner à :
Commentaires (Atom)

