Que l’État se contente d’être juste, nous nous chargerons d’être heureux.---- Benjamin Constant
Chaque Québécois doit plus de 34 000 $ au provincial seulement
Vaut mieux en rire!
Avant de couper des centaines de millions dans les services, est-ce qu’on peut avoir les services ? - Michel Beaudry
31 décembre, 2016
La réflexion du jour
Aux usagers de la STM, je souhaite que la Société s’ouvre aux collaborations avec le secteur privé, à l’exemple de ce qui se déroule un peu partout ailleurs dans le monde. On pourrait peut-être alors bénéficier d’une réduction des coûts et d’une amélioration du service.--- Germain Belzile
30 décembre, 2016
La réflexion du jour
Aux familles plus pauvres et qui consomment des produits laitiers, de la volaille, des œufs et des produits de l’érable, je souhaite que la gestion de l’offre disparaisse, ce qui permettra une libre concurrence et une baisse des prix.--- Germain Belzile
29 décembre, 2016
La réflexion du jour
Aux amateurs de vin, je souhaite que le gouvernement permette une libre concurrence dans la vente de ce produit et qu’il limite ses appétits en termes de taxes sur l’alcool.--- Germain Belzile
28 décembre, 2016
« 3 controverses de la pensée économique » de Jean-Marc Daniel
Dans son dernier ouvrage, Jean-Marc Daniel démontre que l’échec des politiques économiques récentes est malheureusement lié au manque de leçons tirées des expériences et controverses du passé.
Dans la lignée de son Histoire vivante des idées économiques, suivi entre autres de ses 8 leçons d’histoire économique, Jean-Marc nous conte, à sa manière unique, l’histoire de trois grandes controverses qui ont traversé les âges, au point de perdurer, malgré les enseignements que l’on devrait en tirer.
On ne dira jamais assez l’importance que revêt le poids du passé et les enseignements qu’il y a à en tirer. Trop rarement, hélas, suivi d’effets, par simple méconnaissance des grandes leçons oubliées de ces controverses et évolution des idées qu’elles ont pu susciter.
Plus que jamais, le terme d’histoires « vivantes » n’est ici nullement usurpé, surtout lorsqu’on se trouve replongé de manière si réelle dans la dynamique des débats du passé et les progrès de la « science économique ».
Ce dernier terme lui-même est-il d’ailleurs le mieux approprié ? Jean-Marc Daniel rappelle qu’il a remplacé celui d’ « Économie politique », inventé par Antoine de Montchrestien au XVIIème siècle, alors que « même les sciences les plus neutres et les plus incontestables sont menacées de« lyssenkisme ». » Une idée que l’on retrouve chez Pierre Cahuc et André Zylberberg dans leur essai sur Le négationnisme économique, avec qui on peut dire que Jean-Marc Daniel partage l’idée selon laquelle :
« de fait, l’économie a souffert et souffre souvent encore de la méconnaissance qui l’entoure et de la pollution de son message par des prises de position qui semblent d’autant plus fasciner qu’elles sont fallacieuses ».
Première controverse : nos emplois sont-ils menacés par les machines ?
Intitulé « La manivelle de Sismondi, ou quel est l’avenir du travail ? », ce chapitre aborde la question demeurée traditionnelle des craintes liées au progrès technique et aux incidences qu’il pourrait avoir en termes d’emploi. Question lancinante qui remonte au moins à l’Empereur Vespasien qui, déjà, craignant les effets du progrès technique sur l’emploi, décida purement et simplement de l’interdire. À l’encontre de tout bon sens, de l’efficacité et du bien-être qu’il était pourtant en mesure d’occasionner.
Mais si Jean-Marc Daniel nous expose l’évolution de la question à travers les époques, c’est surtout l’épisode de la révolte des luddites (avant celle un peu plus tard des canuts lyonnais) qui retient notre attention. Ces ouvriers tisserands anglais, dans les années 1810, se mirent à briser des métiers à tisser, les accusant de détruire leurs emplois (sans que cela s’avère pleinement fondé, les circonstances historiques jouant, en l’occurrence, un rôle non négligeable en l’affaire, mais sans qu’ils en aient pleinement conscience).
C’est là qu’interviennent, alors que s’organisent la répression et le projet de condamnations à mort, Lord Byron, puis Jean de Sismondi. Ce dernier, qui est aussi le premier théoricien des crises et inventeur de la distinction entre économistes orthodoxes et hétérodoxes (mais dans le cadre strict du caractère scientifique attaché à l’économie), et l’un des premiers économistes à fonder ses raisonnements autour de la notion de demande, émet l’idée suivante, destinée à frapper les esprits :
« Si le machinisme arrivait à un tel degré de perfection que le roi d’Angleterre pût en tournant une manivelle produire tout ce qui serait nécessaire aux besoins de la population, qu’adviendrait-il de la nation anglaise ? »
Mais, outre la présentation des influences qui ont été celles de Sismondi et l’évolution de ses idées, c’est à une très intéressante « réponse » des économistes classiques que nous sommes conviés, David Ricardo notamment, et Jean-Baptiste Say à travers sa célèbre loi des débouchés, mais aussi, et de manière presque étonnante par Karl Marx. Le philosophe de l’exploitation du prolétariat désapprouve ainsi, paradoxalement, le mouvement luddite, lui reprochant de s’en prendre à la machine, qui n’est pas coupable, au lieu de s’en prendre au système capitaliste et ceux qui organisent l’exploitation de l’homme au travail, ne cherchant que le dégagement du maximum de plus-value.
Et la question ne s’arrête pas là : après l’échec des révolutions de 1848, à travers les écrits de Charles Gide on remarque que le luddisme semble rangé aux greniers de l’histoire.
Puis vient l’époque de la bureaucratie et de la montée des emplois correspondants, et encore plus tard, sous l’influence des « socialistes de la chaire » la montée des dépenses publiques, mais aussi des théories protectionnistes. Jusqu’aux rebondissements de la controverse à notre époque, après les deux chocs pétroliers. Dénoncées par Alfred Sauvy et son Economie du diable, avec la loi du déversement et les débats sur l’ubérisation, ainsi que les inquiétudes qu’elle suscite, c’est une forme de « néo-luddisme » qui apparait, laissant ressurgir un débat dont on aurait pourtant pu imaginer qu’il était enterré depuis longtemps.
Mais, sur tous ces points, il faut bien entendu lire l’ouvrage lui-même, dont je ne restitue à dessein que quelques brefs éléments épars, espérant juste vous mettre en appétit.
Deuxième controverse : peut-on parler d’une « bonne » et d’une « mauvaise » dette ?
Intitulé « La lettre de Keynes, ou qu’est-ce que la dette ? », ce passionnant chapitre nous convie à une exploration de l’évolution de la réflexion sur la question de la dette publique. Partant de la problématique de son caractère de « transfert » ou au contraire de « promesse » vis-à-vis de l’avenir, David Ricardo, de nouveau lui, montrait en quoi la dette publique était un mécanisme antiredistributif (bénéficiant à ses souscripteurs, donc aux rentiers). Où l’on découvre, au passage, et non sans intérêt, que :
« au XIXème siècle les partis de gauche réclamaient l’équilibre budgétaire au nom de la nécessité de protéger les pauvres des générations futures. »
D’Aristote, puis Saint Thomas d’Aquin, sur la question de l’usure et du prêt à intérêt, on entre véritablement dans la science économique avec les réflexions sur l’endettement des États. Des conceptions hostiles de François Quesnay, Anne-Robert Turgot, et un certain Frédéric Bastiat, entre autres, on évolue, avec le XIXème siècle, dans le prolongement de celles plus nettement favorables d’Adolph Wagner et des socialistes de chaire, vers l’avènement de John Maynard Keynes et ses disciples.
Un chapitre instructif, au cours duquel nous allons retrouver, en pleine réflexion sur le New Deal, l’opposition entre, d’une part, Henry Morgenthau et sa mise en garde contre l’effet d’éviction de la dépense publique et, d’autre part, un John Meynard Keynes opportuniste et quelque peu méprisant, appelé à la rescousse par un certain Alvin Hansen, non moins opportuniste, qui en sera un digne vulgarisateur et successeur.
Le théorème d’Haavelmö, le multiplicateur, le modèle IS-LM du keynésiannisme triomphant de Hickset Hansen, Bretton Woods, l’influence de Walter Heller, autant d’épisodes entremêlés qui nous font vivre la dynamique du XXème siècle en matière de politiques budgétaires et monétaires, jusqu’à l’échec des politiques de relance de 1975.
Place alors à la critique théorique, avec Robert Lucas, Robert Barro et la Nouvelle économie classique, le retour en grâce de Ricardo à travers le théorème de Ricardo-Barro, mais aussi John Muth et les apports novateurs de Richard Musgrave en matière de justification des fonctions de l’État. Un vaste panorama qui nous est ainsi offert dans sa pleine dynamique. Un chapitre qui se conclut par une intéressante recension des arguments en faveur et contre la dette, et une tentative de réconciliation post-mortem de Keynes et Morgenthau.
Troisième controverse : le capital est-il trop rémunéré par rapport au travail ?
Intitulé « La controverse des deux Cambridge », ce troisième et dernier chapitre aborde la question du capital, en partant des travaux de Thomas Piketty et son ouvrage Le capital au XXIème siècle. Le problème, selon Jean-Marc Daniel, provient de la définition que l’on donne au Capital. Or, toute la théorie de Piketty repose sur la fameuse équation r>g, selon laquelle la rémunération du capital aurait augmenté plus vite que la croissance, contrairement à l’égalité supposée normale par les économistes. Sans qu’il ait ignoré pour autant la difficulté de cette définition que l’on donne au capital, et les débats auxquels elle a donné lieu, Jean-Marc Daniel constate que Piketty n’en passe pas moins un peu vite dessus, ce qui est gênant et prête le flanc à la critique.
L’occasion de revenir sur une controverse née dans les années 1950 au sujet de la nature du capital et de sa rémunération, opposant les chercheurs et professeurs anglais de Cambridge à leurs homologues du Cambridge américain. Avec toutes les conséquences que cela implique en matière à la fois fiscale, de science économique, mais aussi « d’ultime tentative de résistance anglaise à la prise de pouvoir intellectuel par les économistes américains », après celle d’Hansen sur les théories keynésiennes (chapitre précédent).
Déjà au XIXème siècle, Karl Marx était resté assez elliptique, selon notre auteur, au sujet de la définition précise du capital, pourtant titre de son ouvrage le plus important, Le Capital. Une définition plus explicite fut proposée par Eugen Böhm-Bawerk, qui en fit toutefois « plus une théorie de l’investissement à l’origine du capital que du capital lui-même ». Ce qui renvoyait alors au rôle de l’épargne dans le processus, et donc au rôle des taux d’intérêt. Un instrument économique essentiel formalisé de manière plus explicite par Knut Wicksell. Dans sa détermination de deux taux, l’un naturel égalisant l’épargne et l’investissement, l’autre réel tenant compte de la correction des erreurs liées à la politique monétaire et du taux d’inflation, se pose indirectement la question de la définition du capital, et les débats que cela va donc susciter au milieu du XXème siècle, époque à partir de laquelle les statistiques et comptes de la nation font leur entrée remarquée dans l’appui des théories.
La fonction de production prend ainsi appui sur les notions de capital fixe et capital circulant. Mais c’est sur la fonction de Cobb-Douglas que la controverse va être lancée par la Britannique Joan Robinson. Dont le futur prix Nobel Robert Solow ne tiendra toutefois aucun compte dans sa théorie de la croissance. Avec, au centre, la notion de productivité, désormais devenue majeure et pour laquelle, nous rappelle Jean-Marc Daniel,
« L’économiste spécialiste mondialement connu de la productivité est un Français. Il s’agit de Jean Fourastié (…) [dont les] analyses sont construites sur une approche empirique de l’économie française. Si bien que Robert Solow lui a décerné le nom de « Kuznets français » ».
Robert Solow s’appuie donc sur les avancées de Jean Fourastié pour fonder son modèle de croissance autour de deux facteurs essentiels : l’augmentation de la productivité, d’une part, et la démographie, d’autre part, le taux de croissance devant s’assimiler au taux d’intérêt naturel tel que défini par Wicksell (et ainsi que l’avait montré le futur Nobel français Maurice Allais neuf ans plus tôt). Dès lors, « les périodes où le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance [correspond à] des périodes de déflation et de chômage, celles où le taux d’intérêt est inférieur au taux de croissance étant des périodes d’inflation et de tension sur le marché du travail. »
Joan Robinson, en pure keynésienne, va contester le modèle de Solow, d’essence néo-classique, à partir de différents arguments de fond expliqués dans le présent livre. Elle rejette la construction fondée sur l’offre pour privilégier une approche par la demande et une explication des récessions, en réhabilitant notamment le multiplicateur théorisé par son ami Richard Kahn.
La réponse va venir de Paul Samuelson, un autre Nobel très proche de Solow, qui lui répond point par point, considérant toutefois les positions de Joan Robinson comme des arguties qui détournent les économistes des vrais problèmes et des politiques économiques à élaborer en réponse aux problèmes du moment (à l’époque, la lutte contre l’inflation).
Ce qui était sans compter l’intervention dans le débat de Piero Sraffa, fondateur du « néo-ricardisme » et fidèle adepte de Karl Marx, dont il tente de réhabiliter les théories de la valeur-travail.
Un débat de fond relativement complexe que Samuelson va finalement chercher rapidement à esquiver, tout en subtilité, mettant ainsi fin poliment à la controverse, malgré les quelques tentatives qui suivront par certains pour tenter, sans succès, de la réhabiliter. Une controverse au sujet de laquelle les Américains suspectent les Anglais de l’avoir montée par dépit au regard de leur déclin et perte d’influence depuis la gloire keynésienne récupérée par Hansen et l’Amérique après-guerre.
Jean-Marc Daniel conclut le chapitre en revenant à Piketty qui, bien que plus proche en réalité des positions politiques de Joan Robinson et Piero Sraffa, s’appuie paradoxalement sur les conclusions de Solow-Samuelson-Allais sur l’égalité entre taux d’intérêt et taux de croissance, pour fonder sa démonstration.
Ce à quoi Jean-Marc Daniel fait remarquer que la prise en compte complète des travaux de ces Nobels supposerait, plutôt que l’instauration d’une taxation du capital, des mesures de renforcement de la concurrence et une politique économique de résorption du chômage, pour tenir compte des conclusions de Solow relatives au progrès technique et à la démographie.
Mais sa critique plus fondamentale porte sur la question de la définition du capital, à propos de laquelle Joan Robinson aurait été, dit-il, la plus fervente opposante aux travaux de Piketty. Selon Jean-Marc Daniel, il faudrait en fin de compte en revenir à Ricardo et s’interroger plutôt sur la répartition des revenus et la légitimité de leur origine, à partir de la distinction qu’il effectuait entre rentes, profits et salaires, pour aboutir à l’idée que « ce qu’il faut réduire, c’est la rente et non le profit ».
En conclusion, et comme Jean-Marc Daniel y insiste lui-même, l’échec des économistes et des politiques économiques récentes est malheureusement en partie lié au manque de leçons tirées des expériences et controverses du passé. Il est donc essentiel de s’y référer de manière plus importante si l’on entend commettre moins d’erreurs et assurer mieux l’avenir et la condition des populations.
- Jean-Marc Daniel, 3 controverses de la pensée économique – Travail, dette, capital, Odile Jacob, septembre 2016, 175 pages.
La réflexion du jour
À l’ensemble des jeunes du Québec, je souhaite que les générations actuelles ne leur refilent pas une dette publique de plus en plus lourde. Rappelons que la dette publique québécoise par contribuable est présentement de 68 760 $.--- Germain Belzile
27 décembre, 2016
La réflexion du jour
Aux usagers du système public de santé (les « patients »), je souhaite d’être soignés plus rapidement, grâce à la mise en œuvre de réformes qui introduisent plus de choix et de concurrence. --- Germain Belzile
26 décembre, 2016
La réflexion du jour
Aux contribuables du Québec, parmi les plus taxés en Amérique du nord, je souhaite une réduction de la pression fiscale. Quand on sait que l’élément de dépense #1 des ménages de la classe moyenne est la fiscalité, plus que le logement, la nourriture et les vêtements combinés, un répit serait le bienvenu.--- Germain Belzile
25 décembre, 2016
24 décembre, 2016
23 décembre, 2016
La réflexion du jour
L’économiste Assar Lindbeck est connu pour avoir écrit que « outre un bombardement, la meilleure façon de détruire une ville est par une politique de contrôle des loyers ».--- Mathieu Bédard
22 décembre, 2016
La réflexion du jour
Alors, il sera désormais interdit de promener son poisson rouge sans laisse à Montréal – sauf à Westmount. Les canaris sans muselière seront confisqués et offerts aux chats munis d'un permis valide. Les chats sans permis seront confisqués et offerts aux pitbulls, qui, eux, sont interdits. Sauf les mardis.---Benoît Aubin
21 décembre, 2016
Qui a encore besoin des États-nations ?
L’État-Nation est souvent décrit comme un archaïsme inadapté au XXIème siècle, qui impose des frontières dans un monde qui a besoin d’être global. Dans son dernier essai, Henri Guaino cherche à prouver le contraire. Analyse.
Dans son livre En finir avec l’économie du sacrifice, Henri Guaino (j’en ai déjà parlé ICI) s’en prend, chapitre après chapitre, à ceux qu’il appelle les « bons élèves », ceux qui savent trop bien une leçon qu’il estime valable pour une autre époque, « celle où ils sont formés et promus », et qu’ils continuent d’appliquer à une époque, la nôtre, où le contexte est différent. Discours contre l’élite, qui s’appuie paradoxalement sur de nombreuses citations tirées des économistes du XIXème siècle entre autres, de Keynes à Malthus et Léon Walras.
Une défense originale de l’État-nation
 Parmi les sujets, la disparition des États-nations. On constate en effet que l’État-nation est souvent décrit comme un archaïsme inadapté au XXIème siècle, qui impose des frontières dans un monde qui a besoin d’être global, avec une unité du commerce, bénéficiant du progrès des techniques de communication. Les États-nations sont sources de coûts, de droits de douane, de contrôle des capitaux, mais surtout de discontinuités juridictionnelles et de différences de devises.
Parmi les sujets, la disparition des États-nations. On constate en effet que l’État-nation est souvent décrit comme un archaïsme inadapté au XXIème siècle, qui impose des frontières dans un monde qui a besoin d’être global, avec une unité du commerce, bénéficiant du progrès des techniques de communication. Les États-nations sont sources de coûts, de droits de douane, de contrôle des capitaux, mais surtout de discontinuités juridictionnelles et de différences de devises.
Pour défendre l’État-nation Henri Guaino va chercher un article de 2012 d’un économiste de Harvard, Dani Rodrik.Cela donne envie de comprendre de plus près leurs arguments. D’ailleurs Henri Guaino n’hésite pas à les reprendre un par un dans le chapitre qu’il consacre au sujet : Les trop bons élèves ont appris que les États-Nations allaient disparaître, ils en tirent des plans sur la comète.Mais il est utile, pour comprendre, de se référer aussi au texte original.
Se libérer des instances nationales
C’est vrai que l’on pourrait croire qu’avec le développement de l’internet, de l’information, de la mondialisation, on se sent de plus en plus citoyen du monde. Les entreprises sont mondiales, leurs employés voyagent d’un continent à l’autre. Les instances qui régulent le commerce et les échanges sont de plus en plus internationales.
Ce besoin de se libérer des instances nationales ne date pas d’hier, et rassemble à la fois les libéraux et les socialistes, puisque Dani Rodrik vient citer Léon Trotsky, en 1934, à l’appui : « Comment garantir l’unité économique de l’Europe, tout en préservant la totale liberté du développement des peuples qui y vivent ? La solution à cette question peut être obtenue en libérant les forces productives des fers que leur imposent les États nationaux. » Quels libéraux ne deviendraient pas trotskystes à cette lecture ?
Citoyens du monde
D’ailleurs, ces citoyens du monde existent. Mais là où l’étude de Dani Rodrik est intéressante, c’est qu’elle montre, à partir d’une enquête de World Values Surveys, couvrant 83.000 individus dans 57 pays, à partir de questions sur leur attachement au local, au national, et au global, que c’est bien l’attachement national qui est le plus fort, pour toutes les régions, dépassant aussi, et c’est là la surprise, l’attachement local.
On pourrait penser que cet attachement national est surtout le fait de sous-groupes particuliers, et que les jeunes, bien éduqués, entrepreneurs, seront plus attachés au global. Il y a en effet des différences, mais cela ne change pas le résultat général : y compris chez les jeunes de moins de 25 ans ayant une éducation universitaire, et les professionnels, l’identité nationale est plus forte que le local et le global.
Ce sentiment s’est amplifié avec la crise de 2008-2009, car ce sont les interventions nationales qui ont permis d’éviter l’effondrement ; ce sont les gouvernements nationaux qui ont apporté les stimulations fiscales. Comme l’a dit Mervyn King, chairman la la Bank of England, « les banques sont globales dans la vie, et nationales dans la mort ».
L’attachement à la nation
Bon. Mais une fois que l’on a dit que les peuples ont un attachement à l’échelle nationale, la question qui reste est : mais est-ce que c’est une bonne chose ? Est-ce que ce sentiment national n’est pas quand même un frein à l’obtention de tous les bénéfices économiques et sociaux de la globalisation, et que ceux qui l’ont compris sont encore une minorité, mais qui a raison de le croire contre la majorité des retardataires ? Est-ce que la mondialisation n’est pas malgré tout une fatalité ? Ne va-t-on pas vers un mode de gouvernance unifié, adapté au bon fonctionnement des marchés mondiaux ?
Dani Rodrik est convaincu qu’une gouvernance globale est impossible. Pourquoi ?
La géographie, la grande diversité des préférences et des cultures créent un besoin de diversité institutionnelle qui ne converge pas entre les pays. On ne peut pas isoler la production et les échanges qui sont aussi dépendants d’institutions non marchandes. Au-delà des échanges, existent aussi des besoins d’investissements dans les transports, les infrastructures, les moyens de communications, la logistique.
Le cadre étatique
Mais aussi un droit des contrats, la prévention de la fraude, ou la distribution des revenus en conformité avec les normes sociales. Ceci forme un tout, et chaque pays peut avoir son modèle, chacun tout aussi bénéfique, selon le contexte, au marché. Et ce sont principalement les États qui fournissent ce cadre.
Autre frein, ou résistance, à la convergence : la distance et la géographie. On pourrait croire que dans un monde où les communications et les échangent s’accroissent, les différences entre les frontières juridiques diminuent, les modes de vie se rapprochent, tout le monde s’habille de la même façon, et écoute la même musique. La baisse des coûts de transport et de communication va accentuer ce phénomène.
Oui, et non, car justement les études montrent que la distance géographique a encore des effets notables. Dani Rodrik cite une étude de Disdier et Head de 2008, qui concerne le comportement des internautes américains : ceux-ci sont d’autant plus enclins à visiter les sites internet des autres pays que ces pays sont proches du leur (et inversement). Pour les pays non membres de l’OCDE ils indiquent que 10% de distance en plus abaisse la probabilité de visite de 44%. Pour les pays de l’OCDE la baisse reste quand même de 9%. La proximité avec le niveau de développement et la culture reste donc bien important.
La géographie indépassable
Ces études montrent que la distance est toujours décisive dans l’économie mondiale du début du XXIème siècle. Les relations interpersonnelles restent aussi conditionnées par la géographie. Rodrik indique que l’Iphone d’Apple pourrait être produit n’importe où, mais qu’une fois que l’écosystème local, les relations avec les fournisseurs locaux, sont établis, il devient plus difficile d’aller produire ailleurs.
Finalement dans ce modèle de la mondialisation et de la globalisation, les États-Nations sont au centre. Citons maintenant Henri Guaino :
« À la place des villes-États d’hier et des grandes concentration urbaines d’aujourd’hui qui fracturent la société au lieu de l’entraîner, imaginons les Nations comme des centres d’économies-monde dont les métropoles ne seraient que des parties, certes essentielles et au sommet de la hiérarchie, mais étroitement imbriquées dans un ensemble plus vaste formant un tout, un système productif cohérent sans pour autant se suffire à lui-même. Représentons-nous ces Nations occupant le centre d’une économie-monde non comme des ensembles fermés mais comme des foyers qui irradient bien au-delà de leurs frontières. Les Nations, donc, au centre, au cœur des économies-monde qui se chevauchent et se concurrencent, formant chacune un assemblage de culture, d’espace, de logistique, de capital humain, de capital social, de biens publics, de biens communs, d’institutions agencés par l’Histoire, la géographie, le génie d’un peuple, la politique pour créer, découvrir, inventer, innover, imaginer, produire des biens, des services, des idées, du bien-être et de la prospérité, rayonnant dans le monde à travers ses œuvres, ses productions et ses entreprises. L’enjeu pour une Nation dans le monde actuel : être un centre, éviter d’être rejetée à une périphérie. »
Le défi n’est pas de supprimer les États-Nations mais de bien agencer les différents éléments qui font une Nation, en mobilisant les ressources matérielles et immatérielles pour éviter que, à l’intérieur même de l’ensemble, se forment des périphéries qui mettraient de côté des populations ou des territoires aux marges de pôles de développement en nombre trop limités, qui provoquerait la révolte des laissés pour compte.
À la fin de son article Dani Rodrik répond à la question, la réponse à ma question « Qui a besoin des États-Nations ? We all do. »
Pour Henri Guaino, deux voies sont possibles pour l’ordre du monde et l’économie mondiale : la première est celle d’un archipel de grandes métropoles « accaparant toutes les forces vives et les richesses au centre des économies-monde. C’est le choix de ceux qui rêvent d’une Europe qui dissoudrait les Nations. » On a compris que ce n’est pas sa préférence.
« La deuxième voie est celle où chaque Nation, mobilisant toutes ses ressources, cimentant sa cohésion, tissant sans relâche les liens de sa solidarité, sachant protéger sans faveur, s’efforce de s’ériger en centre d’une économie-monde et de la faire rayonner. »
De quoi nous inspirer pour ne pas opposer l’État-Nation à la mondialisation, mais y trouver des convergences stratégiques.
Il ne suffit pas de penser global…
- Henri Guaino, En finir avec l’économie du sacrifice, Odile Jacob, 670 pages.
La réflexion du jour
Lorsqu’une entreprise choisit dans quelle ville elle va s’établir, elle prend en compte plusieurs indicateurs. À Montréal, par exemple, la qualité de vie, le coût de la main-d’œuvre raisonnable et des coûts d’exploitation relativement faibles jouent en faveur de la ville. Mais la Ville de Montréal plombe ces avantages par des taxes et des impôts parmi les plus élevés au Canada.--- Mathieu Bédard
20 décembre, 2016
La réflexion du jour
Dès qu’on est confronté avec des projets du secteur public, le mot déficit n’est pas loin. Quand ce n’est pas un problème de déficit d’opérations, on assiste souvent à une forte augmentation des coûts de construction. Partout au Canada, on ne compte plus les projets dans lesquels les coûts ont littéralement explosé. Une courte liste, qui en oublie beaucoup : le stade Olympique (+800 %), le métro de Laval (+ 350 %), le train de Mascouche (+ 123 %), la centrale de Muskrat Falls (+ 50 %), le remplacement de l’échangeur St-Pierre (+ 38 %), le registre fédéral des armes longues (+ 50 000 %).--- Germain Belzile
19 décembre, 2016
La réflexion du jour
Allons-y avec une courte liste des irritants qui minent l’investissement : les évaluations environnementales interminables qui aboutissent à des décisions politiques plutôt qu’administratives, l’incertitude amenée par des blocages législatifs (l’adoption de la loi 106 est un exemple dans l’actualité), la pression à la hausse sur la masse salariale (et donc, les frais d’exploitation) causée par les importantes cotisations des employeurs, la multiplication de la paperasse associée à la production et aux ventes, l’impôt sur les profits, etc.
L’économie, c’est finalement simple : rendez les investissements moins rentables et plus risqués, et les investisseurs en feront moins.--- Germain Belzile
18 décembre, 2016
17 décembre, 2016
La réflexion du jour
Louis Têtu qui, par ailleurs, n'arrive pas à se faire à l'idée que le dossier Santé Québec ne soit pas encore terminé.
«On est rendu à 2,4 milliards $ avec ce projet. Avec une telle somme, Elon Musk envoie des fusées vers la planète Mars!»---Gilbert Leduc
16 décembre, 2016
La réflexion du jour
La tarte n’est pas fixe! Nous avons le droit de cuisiner collectivement une plus grosse tarte. On ramasse plus de bleuets. On cultive plus de blé pour faire plus de farine. On fabrique une plus grosse tarte pour que chacun ait une plus belle pointe.---Mario Dumont
15 décembre, 2016
La réflexion du jour
Le cul-de-sac (ndlr du modèle québécois) s’explique simplement: les politiciens sont au lit avec la bureaucratie depuis quarante ans. Ils se sont taillé un modèle politique sur mesure. Leur devise pourrait être celle-ci: duplicité, complicité, fiscalité...Michel Hébert
14 décembre, 2016
What is risk?
Prenez trois minutes pour vous faire expliquer ce qu’est le risque d’investissement de la manière la plus originale qui soit. Cette animation de la firme Quietroom, teintée de l’humour particulier que l'on connaît des Anglais, explique dans un langage simple et imagé les notions de base du risque et du rendement. Un petit bijou dont devraient s'inspirer nos organismes de réglementation!
La réflexion du jour
La colère populiste, qui monte partout en Occident, n’est pas une mode passagère. C’est la conséquence d’une crise de confiance grave dans nos institutions et leurs dirigeants.--- Joseph Facal
13 décembre, 2016
La réflexion du jour
Mais surtout : sans réforme en profondeur, sans changement dans la façon dont les services sont livrés, et par qui ils sont livrés, on risque simplement de jeter l'argent dans un puits sans fond, comme on le fait depuis des décennies. La structure actuelle, bureaucratique, centralisée et sclérosée, doit être revue de fond en comble.--- Jasmin Guénette
12 décembre, 2016
La réflexion du jour
À la question «Pourquoi le tiers des Québécois n’ont pas 500 $ de côté en cas de coup dur?» deux réponses sont possibles.
Ou ces gens font comme notre gouvernement et gèrent mal leur budget. Ils s’endettent et multiplient les dépenses inutiles sans tenir compte de leur capacité de payer.
Ou ils sont pressés comme des citrons par un État trop gourmand.--- Richard Martineau
11 décembre, 2016
10 décembre, 2016
La réflexion du jour
Finalement, selon le sondage de PwC, en plus de l’impôt sur les profits, les grandes entreprises canadiennes doivent payer et percevoir pas moins de 68 taxes et frais divers. Au total, elles envoient plus d’argent aux gouvernements en taxes et autres paiements que ce qu’elles génèrent comme profits après impôt.--- Nathalie Elgrably-Lévy
09 décembre, 2016
La réflexion du jour
Des trois paliers de gouvernement, fédéral, provincial et municipal, ce sont les employés municipaux qui gagnent, et de loin, la rémunération la plus élevée.
...
Si vous vous demandez pourquoi votre compte de taxes municipales s’est fortement apprécié depuis 2009, vous saurez que la rémunération de «vos» employés compte pour beaucoup dans la hausse.--- Michel Girard
Si vous vous demandez pourquoi votre compte de taxes municipales s’est fortement apprécié depuis 2009, vous saurez que la rémunération de «vos» employés compte pour beaucoup dans la hausse.--- Michel Girard
08 décembre, 2016
La réflexion du jour
Pendant qu’ailleurs ils agissent, nous préférons étudier, débattre, pérorer, consulter, promettre, tabler, point-de-presser et, quand on est dans la m..., réclamer la clause dérogatoire.--- Lise Ravary
07 décembre, 2016
Le vote libéral, de Jacques Garello
Le projet libéral, dont le livre de Jacques Garello donne les grandes lignes, est le seul qui permet de relever les défis actuels.
Les élections présidentielles françaises approchent : le premier tour aura lieu dans tout juste sept mois. Pour un libéral, comme pour tout électeur français, le choix semble simple : il ne peut que s’abstenir ou se résigner à voter pour le moins mauvais. C’est mal connaître Jacques Garello de croire que lui, comme d’autres de son acabit, puisse se satisfaire d’un tel dilemme. D’autant que la situation actuelle de la France plaide comme jamais pour l’antidote au mal français des idées libérales…
Le vote libéral rarement sans lendemain
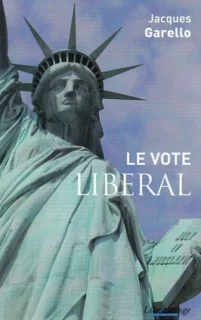 Jacques Garello montre d’abord que, pour en expliquer les votes, l’approche sociologique de l’électorat français exagère le poids de l’appartenance à un groupe, qu’il soit familial ou professionnel, ou religieux, ou géographique ; ensuite que le vote libéral en France est rare et sans lendemain ; enfin que ce n’est ni le cas en Allemagne ni en Grande-Bretagne, et que le vote libéral est même présent dans la quasi totalité des pays européens…
Jacques Garello montre d’abord que, pour en expliquer les votes, l’approche sociologique de l’électorat français exagère le poids de l’appartenance à un groupe, qu’il soit familial ou professionnel, ou religieux, ou géographique ; ensuite que le vote libéral en France est rare et sans lendemain ; enfin que ce n’est ni le cas en Allemagne ni en Grande-Bretagne, et que le vote libéral est même présent dans la quasi totalité des pays européens…
Le dilemme cornélien évoqué ci-dessus résulte de l’examen des options qui se présentent au libéral, comme d’ailleurs à tout électeur français : il ne peut être satisfait d’un vote socialiste, qui menace son emploi et sa propriété, ni d’un vote conservateur, qui reconduit une classe politique usée et des privilèges abusifs, ni d’un vote écologiste qui mène à l’utopie et au sectarisme, ni d’un vote populiste qui nie la diversité et la compréhension.
Le libéralisme mal connu
Les idées libérales ne sont pas celles qu’on croit : Beaucoup de Français se croient et se disent libéraux, mais ne le sont pas en réalité. À l’inverse, sont encore plus nombreux les Français qui sont libéraux mais ne le savent pas. Rien d’étonnant à cela puisque le libéralisme n’a que très rarement été enseigné, et presque jamais appliqué. Le libéralisme est ignoré, donc caricaturé, diabolisé, ou dévié.
Jacques Garello rappelle qu’il ne faut pas réduire le libéralisme à une doctrine économique prônant la libre entreprise et le libre-échange, c’est-à-dire décentralisée, à l’opposé de l’économie dirigée, enfermée derrière des frontières politiques ou administratives, centralisée : il n’a rien à voir non plus avec le capitalisme de connivence, qui se nourrit, par exemple, de subventions ou d’exemptions fiscales.
Le libéralisme est un humanisme
Le libéralisme est une conception de l’être humain qui lui confère sa dignité, sa spécificité, sa vocation. Un libéral a ainsi confiance en l’être humain, il est humaniste. Il sait que l’être humain a besoin de la liberté pour développer ses capacités et que la propriété, fondement de la pensée libérale, a pour ennemi le collectivisme, fondement de la pensée socialiste. Il sait que l’homme libre est non seulement créateur, mais qu’il est serviteur :
C’est la rencontre des besoins des autres qui lui permet de satisfaire ses propres besoins, d’où la nécessité de l’empathie, ce sentiment moral mis en évidence par Adam Smith, sentiment qui est à la base de l’échange, lui-même base de l’économie.
Si le libéral a confiance en l’être humain, c’est parce qu’il le sait faillible, mais perfectible, capable de tirer des leçons et de rendre compte de ses actes, c’est-à-dire d’être responsable. Une société de confiance est fondée sur la coopération volontaire, sur la solidarité spontanée, sur l’état de droit. La crise actuelle est une crise morale, qu’il ne sera possible de résoudre qu’en se libérant de l’État Providence, inefficace et asservissant.
La prétention de l’État Providence
L’État Providence a en effet la prétention de prendre totalement en charge les individus, de la naissance à la mort, et de les guider dans leurs activités économiques, voire dans leur vie privée. Il étend indéfiniment son emprise : à travers ses réglementations et ses administrations il couvre tous les besoins et toutes les aspirations : la santé, l’éducation, la formation, l’emploi, la culture, la recherche scientifique, le logement, les transports, le sport, l’environnement etc.
Comment en sortir ? Jacques Garello perçoit des signes de réveil de la société civile. Il donne notamment deux exemples encourageants, celui de Contribuables Associés (350.000 adhérents), qui a pour objectif moins d’impôts, moins de dépenses publiques, moins d’État ; et celui de l’UNPI, Union Nationale de la Propriété Immobilière (250.000 adhérents), qui a pour objectif la défense de la propriété immobilière privée contre une législation pénalisant les bailleurs.
Réveiller le vote libéral
Les primaires ouvertes à droite et au centre présentent une opportunité pour transformer ce réveil en vote. Le Collectif des libéraux, CDL, s’est constitué à cette fin. Il regroupe actuellement l’ALEPS, le Cercle Droit & Liberté, le site Contrepoints et Liberaux.org, Contribuables Associés, le Cerel, l’Institut Économique Molinari, l’IREF-Europe, le think-tank Libéral Sciences-Po, l’UNPI. Ce collectif s’est donné pour objectif de rencontrer les candidats, de leur poser une liste de questions et de rendre public un rapport sur leurs réponses.
Le CDL s’est donné en fait pour objectif de persuader le plus grand nombre de libéraux de participer à ces primaires de telle manière à peser sur elles en leur apportant l’information qui peut les aider dans leur choix : On peut estimer à 500.000 les adhérents et militants de la droite et du centre qui participeraient à la primaire. Recueillir 50.000 votes libéraux est une performance suffisante, puisque 10% des voix mettent les électeurs en position d’arbitrage et démontrent l’importance et la mobilisation des électeurs libéraux.
Prise de conscience libérale
Si l’essai est transformé, il sera dès lors bien difficile aux politiques et aux médias de continuer à ignorer et à mépriser le libéralisme. Et nombre de Français pourront se rendre compte qu’ils sont, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, des libéraux sans le savoir, parce qu’ils ont simplement du bon sens :
Ne pas dépenser l’argent qu’on n’a pas, gagner son argent par le travail, le mérite et l’effort, ne pas réduire les faibles et les pauvres à l’assistanat qui les exclut de la société, respecter la propriété, accepter les différences, respecter la tradition mais innover et s’adapter au changement, etc.
Le projet libéral
Le projet libéral, dont le livre de Jacques Garello donne les grandes lignes, est le seul qui permet de relever les défis actuels : Le proposer, l’expliquer, l’imposer à la classe politique, c’est gratifiant et motivant pour ceux qui le conçoivent et le propagent.
Ce projet est à même de :
– porter la croissance économique
– réduire le chômage
– mettre un frein à l’endettement public et à l’oppression des prélèvements obligatoires
– redonner des perspectives de retraites solides
– apaiser les tensions sociales
– réduire l’État à son seul domaine d’intervention: la sécurité intérieure et la défense extérieure
– promettre une justice plus lucide.
– porter la croissance économique
– réduire le chômage
– mettre un frein à l’endettement public et à l’oppression des prélèvements obligatoires
– redonner des perspectives de retraites solides
– apaiser les tensions sociales
– réduire l’État à son seul domaine d’intervention: la sécurité intérieure et la défense extérieure
– promettre une justice plus lucide.
Puisse ce rêve à partager sans modération devenir réalité…
- Jacques Garello, Le vote libéral, Libréchange, 198 pages.
—
S'abonner à :
Commentaires (Atom)
