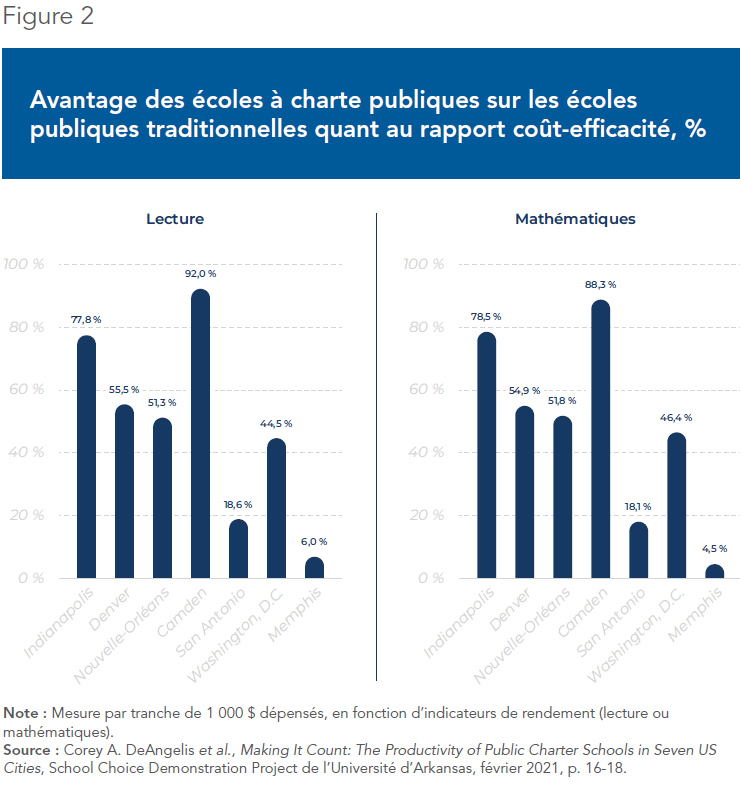Par Samuel Gregg.1
Toute discussion sur la nature et la finalité de la liberté et la justice aborde inévitablement la question du rôle de l’État et du droit dans la société. On peut commencer cette réflexion sur la façon dont le droit naturel aborde ces questions avec Thomas d’Aquin et son approche du droit.
Dans sa Summa Theologiae, Thomas d’Aquin définit le droit comme « Une ordonnance de raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté, » (ST I-II, q. 90, a.4) [translation source : Summa Theologiae, La Somme de Théologie en 5 fichiers doc (composée entre 1269-1272), Traduction dominicaine, 1984, à partir du texte de la commission Léonine.]
Dans ce contexte, le terme droit désigne les lois formellement adoptées par l’autorité politique légitime. Raison signifie le droit naturel, qui indique que la loi elle-même doit être raisonnable plutôt que dictée par les autorités. Celui indique l’autorité politique, c’est-à-dire l’État et les responsables juridiques comme les législateurs, les juges et les ministres du gouvernement. Enfin, le bien commun désigne les conditions qui aident les individus et les groupes d’une communauté politique donnée à faire des choix libres pour les biens qui aident l’épanouissement humain.
Ce dernier point est particulièrement important car le bien commun d’une communauté politique donnée n’est pas une licence pour l’État de faire ce qu’il veut. Ce que l’on appelle « le bien commun politique » impose des limites sur ce que l’État peut faire vis-à-vis des individus et des communautés non étatiques, allant de la famille aux entreprises.
Le bien commun politique
Le droit naturel considère le bien commun politique comme étant constitué, dans une communauté politique donnée (comme le Commonwealth d’Australie, l’État du Michigan ou la ville de Montréal), de toutes les conditions qui tendent à favoriser, faciliter, et encourager la participation cohérente de chaque individu à des biens comme la vérité, le travail et la beauté, qui sont manifestement bons pour tous les humains.
On remarquera qu’une caractéristique particulière du bien commun de la communauté politique est qu’il ne constitue pas une finalité en soi pour ses membres. Il joue plutôt un rôle instrumental dans la mesure où il vise à aider à l’épanouissement des individus en favorisant les conditions qui facilitent — au lieu d’essayer d’accomplir directement — le libre choix de ses membres de s’épanouir.
Les moyens grâce auxquels les autorités légitimes d’un groupe politique atteignent cet objectif peuvent inclure, entre autres, l’interaction avec d’autres autorités politiques légitimes, la protection des membres de la communauté politique contre les étrangers hostiles, la justification de la justice en punissant les auteurs d’actes répréhensibles et la détermination et l’arbitrage des responsabilités associées à des relations particulières, comme les obligations contractuelles. Par exemple, il est plus difficile de choisir de poursuivre le bien de la connaissance dans une situation de désordre civil. De même, nous savons que les incitations à travailler sont radicalement réduites s’il n’y a aucune garantie que nos revenus ne seront pas arbitrairement confisqués par d’autres ou par l’État.
Il est cependant important de se rappeler que l’objectif est d’aider les gens à s’épanouir, et qu’aider les individus et les associations dans une communauté politique donnée signifie précisément cela : aider. L’État n’aide pas les individus et les communautés en amoindrissant, en usurpant ou en annulant leur capacité et leur responsabilité personnelle de faire les choix libres qui mènent à l’épanouissement humain.
En bref, les activités et les pouvoirs des autorités politiques sont eux-mêmes limités par la raison d’être d’un groupe politique. Cela signifie que l’objectif du bien commun politique n’est pas l’accomplissement moral complet de chaque membre de cette communauté. Le bien politique commun limite ainsi ce que les fonctionnaires de l’État peuvent faire dans une communauté politique donnée. Cela inclut le domaine de ce qu’on appelle la moralité publique.
Droit naturel, État et moralité
L’approche du droit naturel au sujet du rôle de l’État en matière de moralité publique repose sur trois points cruciaux.
Toute loi humaine (droit positif) a une dimension morale
Même quelque chose d’aussi banal que le Code de la route est considéré comme possédant une logique morale sous-jacente. Il réglemente à juste titre le libre choix de conduire de millions de personnes parce que sans ces lois, la vie et la santé humaines sont exposées à des risques déraisonnables. Quand nous respectons les règles de la circulation, nous embrassons implicitement cette logique morale.
Les principes moraux et les normes de justice qui s’appliquent à toutes les formes d’action humaine s’appliquent autant aux acteurs étatiques qu’aux individus et aux communautés
Dans le premier chapitre, nous avons observé que le droit naturel souligne le fait qu’il existe des normes morales absolues qui identifient certains choix comme étant toujours et dans tous les cas mauvais, et donc ne devant jamais être choisis par des individus ou des groupes. Ceux qui écrivent les lois, appliquent les politiques ou interprètent les lois ne sont pas exemptés du respect de ces normes. Par conséquent l’État ne peut pas participer à des activités telles que voler les biens des gens, violenter leur intégrité physique par la torture ou les forcer à mentir, etc
Tout préjudice moral ne peut et ne doit pas être interdit par l’État
Par exemple, le libre choix de mentir est toujours mauvais car il nuit toujours au bien de la vérité. Pourtant, nous n’interdisons pas et ne punissons pas légalement tous les mensonges. Un mensonge nuit au menteur lui-même et à différents groupes (amitiés, familles, etc.). Mais tous les mensonges ne compromettent cependant pas directement le bien commun politique. Donc nous limitons généralement l’interdiction légale et la punition du mensonge à des domaines tels que les procédures judiciaires ou des mécanismes comme les contrats.
En revanche, tous les meurtres sont non seulement répréhensibles en eux-mêmes, mais ils portent gravement atteinte au bien commun politique dans la mesure où le fait de ne pas dissuader et pénaliser les meurtriers compromet gravement l’aptitude des individus et des collectivités à rechercher le bien. En conséquence la loi interdit et punit les actes de meurtre.
Thomas D’Aquin s’est penché sur quelques-unes de ces distinctions en détail.
Prenons, par exemple, la description de l’objectif approprié du droit dans la Summa :
« Pour la loi humaine, c’est la tranquillité de la cité dans le temps présent; la loi y parvient en refrénant les actes extérieurs, dans la mesure où leur malice peut troubler la paix de la cité. » ST I-II, q. 98 a.1c
Les termes actes extérieurs et paix de la cité nous montrent que le droit positif s’intéresse principalement aux demandes de justice et de paix.
Thomas d’Aquin en précise une signification plus complète quand il explique :
« La loi humaine vise une communauté civile, celle qui s’établit entre les hommes par le moyen d’activités extérieures, puisque c’est par de tels actes que les hommes entrent en rapports les uns avec les autres. Les rapports de cette sorte sont du ressort de la justice, spécialement qualifiée pour l’organisation des rapports sociaux parmi les hommes. C’est pourquoi les préceptes proposés par la loi humaine n’intéressent que les actes de justice… » (ST I-II q.100 a.2c)
Ensuite, comme pour s’assurer que ses lecteurs le comprennent bien, il ajoute :
« Si des actes d’autres vertus sont prescrits, c’est dans la mesure seulement où ces actes revêtent un caractère de justice » (ST I-II q.100 a.2c)
À la base de cette affirmation se trouve l’argument de Thomas d’Aquin selon lequel tous les actes de vertu ne visent pas le bien commun politique. De nombreux actes de vertu ont pour objet le bien privé des particuliers, des familles et des autres collectivités. De tels actes sont hors du champ d’application immédiat du bien commun politique dont les gouvernants sont responsables.
Cela devient encore plus clair quand Thomas d’Aquin répond à la question, « La loi humaine doit-elle ordonner les actes de toutes les vertus ? »
Il répond de la manière suivante :
« Les espèces des vertus se distinguent d’après leurs objets […] Or tous les objets des vertus peuvent se référer soit au bien privé d’une personne, soit au bien commun de la multitude; ainsi peut-on exercer la vertu de force, soit pour le salut de la patrie, soit pour défendre les droits d’un ami; et il en va de même pour les autres vertus. Or la loi […] est ordonnée au bien commun. C’est pourquoi il n’y a aucune vertu dont la loi ne puisse prescrire les actes. Toutefois, la loi humaine ne commande pas tous les actes de toutes les vertus ; mais seulement ceux qui peuvent être ordonnés au bien commun, soit immédiatement, par exemple quand certains actes sont directement accomplis en vue du bien commun ; soit médiatement, par exemple quand le législateur porte certaines prescriptions ayant trait à la bonne discipline qui forme les citoyens à maintenir le bien commun de la justice et de la paix. » (ST I-II, q.96 a.3c).
Certes, Thomas d’Aquin ne considère pas la justice et la paix comme ayant un contenu minimaliste. Mais dans son esprit, la préoccupation légitime de la loi pour la justice et la tranquillité n’autorise pas l’État à promouvoir tous les actes de vertu. La conception du bien commun politique par le droit naturel impose donc des contraintes de principe à l’utilisation du droit positif pour façonner les choix et les actions libres des individus et des groupes vivant au sein d’une communauté politique donnée.
La subsidiarité et l’État
Ce n’est pas la seule façon dont le droit naturel limite la portée du pouvoir de l’État.
Le bien commun politique limite non seulement ce que l’État peut faire en ce qui concerne les individus, il restreint également ce que l’État peut faire en ce qui concerne les libertés des communautés sur lesquelles il exerce son autorité.
On peut comprendre cela à travers le principe de subsidiarité du droit naturel. Le mot lui-même vient du latin subsidium, qui veut dire aider.
Cette idée a été partiellement formulé par Thomas d’Aquin quand il a commenté :
« De même donc que pour un chef de cité, s’opposer si ce n’est momentanément en raison de quelque nécessité à ce que ses sujets accomplissent leur tâche, serait contraire au sens d’un gouvernement humain » (Aquin, SCG III c.71, n. 4) .
Un exemple d’une telle nécessité serait que l’État exige que mon entreprise fournisse certains biens pour l’armée en temps de guerre, même si le fait de les produire me rend incapable de remplir mes obligations contractuelles de fournir les mêmes biens aux acteurs privés. Dans ce cas, la responsabilité de l’État de protéger le pays contre les agresseurs externes l’emporte à juste titre sur mes obligations personnelles.
Le principe de subsidiarité nous rappelle ainsi qu’il existe de nombreuses associations et communautés libres qui précèdent l’État et créent de nombreuses conditions qui aident les gens à atteindre la perfection. Elles ont ainsi une responsabilité première de donner aux autres ce qui leur est objectivement dû en justice.
La façon dont cela fonctionne en pratique a été esquissée par Jean Paul II dans son encyclique de 1991, Centesimus Annus.
Il y dit :
« Une société d’ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d’une société d’un ordre inférieur, en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l’aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société, en vue du bien commun. » (Jean Paul II, 1991 :48) Source : Vatican website
Cette même encyclique précise que :
« Ces interventions de suppléance, que justifie l’urgence d’agir pour le bien commun, doivent être limitées dans le temps, autant que possible, pour ne pas enlever de manière stable à ces groupes ou à ces entreprises les compétences qui leur appartiennent et pour ne pas étendre à l’excès le cadre de l’action de l’Etat, en portant atteinte à la liberté économique ou civile. » (Jean Paul II, 1991 :48) Source : Vatican
Les interventions de sociétés d’ordre supérieur, telles que l’État, dans les activités de groupes inférieurs doivent ainsi prendre place en référence au bien commun politique : par exemple les conditions qui permettent aux individus de faire de libres choix par lesquels ils s’accomplissent eux-mêmes. Ainsi la subsidiarité combine des axiomes de non-interférence et d’assistance. Il s’ensuit que lorsqu’un cas nécessite l’assistance ou la coordination par la loi ou l’État, on doit respecter le plus possible les libertés légitimes des personnes ou sociétés assistées.
La signification primordiale de ce principe réside ainsi dans le fait que de telles libertés sont essentielles si les gens doivent choisir librement les biens et les vertus morales : par exemple en agissant et faisant des choses pour nous-mêmes – comme le fruit de notre propre réflexion, choix et action – plutôt que d’autres personnes le fassent pour nous.
Ainsi la subsidiarité suggère que l’État n’intervienne directement que lorsqu’il est évident qu’il n’existe pas d’autre association ou communauté à proximité de ceux qui ont un besoin particulier, ou bien que toutes les autres associations ou communautés proches n’ont pas pu répondre à ce besoin particulier. Et même dans ce cas, quand l’État semble être la seule institution qui puisse satisfaire un besoin, le principe de subsidiarité suggère qu’une fois qu’un groupe ou une association non-étatique émerge qui est capable de répondre à ce besoin, l’État devrait laisser cette association assumer la responsabilité de répondre à ce besoin.
Il est aussi vrai qu’existent des responsabilités particulières que le droit naturel considère comme prérogatives de l’État. La plus importante est ce que les sociétés libres considèrent comme fondamental pour leur identité même: l’État de droit.
La raison et l’État de droit
Thomas d’Aquin précise que la règle de droit « n’est pas la règle des hommes » (Aquinas Sententia Libri Ethicorum, V. 11 n. 10 in Busa, 1996).
Par primauté du droit, Thomas d’Aquin ne voulait pas dire principalement que les personnes chargées d’appliquer la loi maintenaient simplement les règles établies de façon cohérente. Pour lui, la primauté du droit était une question d’agir selon la raison plutôt que nos passions ou d’une manière arbitraire.
Thomas d’Aquin considérait que le droit devrait déterminer aussi longtemps à l’avance que possible ce que les juges devraient décider (Thomas d’Aquin, 1271-1272, Sententia Libri Ethicorum, V. II n.10, in Busa, 1996). Néanmoins, même après que les lois soient faites, annoncées et mises en œuvre, Thomas d’Aquin reconnaissait que d’autres exercices de jugement (et donc de raison) sont nécessaires, notamment parce que de nombreuses lois obligent inévitablement les juges à dénouer les ambiguïtés inévitables de signification, concilier les différentes lois et combler les lacunes du droit.
Cette attention à la raisonnabilité est au cœur de la conception de la primauté du droit que nous donne la loi naturelle. Elle met en valeur le fait que l’idée même de l’État de droit est dérivée en partie de la conclusion qu’il est raisonnable de limiter le pouvoir arbitraire. La primauté du droit inclut donc une moralité intérieure distincte dans la mesure où l’arbitraire est considéré comme intrinsèquement injuste.
Au XXe siècle ce point a été souligné par le philosophe juridique Lon L. Fuller. Il a soutenu que la primauté du droit incarne un raisonnement moral intrinsèque dans la mesure où il y a certaines conditions de raison qu’une loi doit remplir avant d’être considérée comme une loi légitime (Fuller, 1977).
Pour Fuller, la prééminence du droit signifie qu’une loi :
- doit être suffisamment générale ;
- doit être promulguée publiquement (on ne peut avoir de lois secrètes) ;
- doit être prospective (par exemple, la loi s’applique aux actions futures, et non pas passées) ;
- claire et intelligible ;
- doit éviter les contradictions ;
- doit rester constante, être suffisamment stable pour permettre à chacun d’être guidé par la connaissance du contenu des règles ;
- ne doit pas demander l’impossible, il doit être possible de lui obéir ;
- doit être administrée d’une manière qui ne s’écarte pas à l’extrême de son sens évident ou apparent (Fuller 1977 : 33-38)
Une loi doit être claire et promulguée, sinon elle ne répond pas à une exigence fondamentale de raison et est donc injuste. Il convient toutefois de noter que cette exigence n’est pas simplement une condition technique préalable au fonctionnement d’un système juridique. Elle contient un caractère raisonnable intérieur dans la mesure où ces exigences attestent du fait qu’il existe des façons cohérentes et justes (raisonnables) et incohérentes et injustes (déraisonnables) d’appliquer les lois. Par conséquent, c’est en se conformant à ces principes de base de raisonnabilité que le droit répond aux exigences minimales de la justice et contribue de façon essentielle à la protection contre la coercition injuste et de prise de décision arbitraire par ceux qui exercent un pouvoir coercitif légitime.
Du droit à l’économie
Le concept d’État limité et d’État de droit au sein du droit naturel dépend fortement de la notion que la protection de l’aptitude des individus et des communautés à faire des choix libres ne peut être fondée sur une notion de liberté détachée de la raison, ou l’idée de liberté simplement pour l’autonomie.
Cette même logique se manifeste dans un domaine auquel les penseurs de droit naturel ont longtemps consacré une attention considérable : le domaine de la propriété et des relations économiques.
Ceci est un extrait (chapitre 3 de The Essential Natural Law) publié pour l’Institut Fraser en 2021