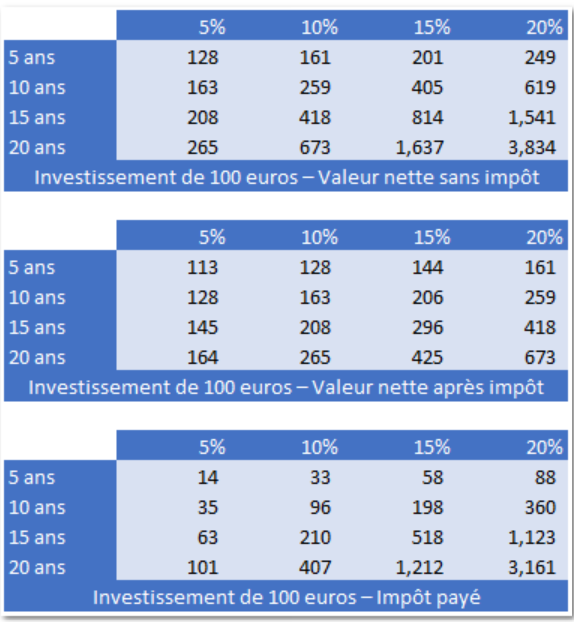Pour Isaiah Berlin, 2 définitions de la liberté s’opposent. Ces 2 définitions induisent deux conceptions rivales de l’État et de la société. La mini-série philo de l’été avec le Podcast Conflits en companie de D. Theillier et JB Noé.
La liberté est un concept confus que tout le monde aime revendiquer sans savoir de quoi on parle vraiment. Il suffit d’observer le débat sur le pass sanitaire en France. Pour les uns c’est un dispositif qui permet la liberté, pour d’autres c’est une nouvelle forme d’oppression (voir mon article ici).
Pourtant tous revendiquent la liberté. Alors qui a raison, qui a tort ?
En réalité, nous dit Isaiah Berlin, deux définitions de la liberté s’opposent et ne sont pas toujours compatibles entre elles. Et ces deux définitions induisent deux conceptions rivales de l’État et de la société.
LA LIBERTÉ NÉGATIVE COMME LIMITE AUX ACTIONS HUMAINES
Dans la tradition classique des Lumières anglo-françaises, la liberté négative s’énonce en termes de limites à l’ingérence d’autrui. Je suis libre si personne ne m’empêche de faire mes choix.
Elle répond à la question suivante : dans quelles limites une personne peut-elle faire ses propres choix, sans être soumise à la contrainte des autres ou de la loi ?
En ce sens, je suis libre si je ne suis pas sujet à l’ingérence et à la coercition d’autrui. La liberté c’est le fait d’avoir une vie privée protégée, c’est aussi le fait de pouvoir agir et s’exprimer librement dans la sphère publique sans interférence de la part du pouvoir.
La liberté consiste alors dans la préservation d’un domaine dans lequel la personne doit avoir la possibilité de faire ses choix, à sa façon, sans en être empêchée par autrui.
Bien entendu, cette liberté n’est pas absolue. Elle est limitée par l’existence des autres. « Nul n’a le droit de porter préjudice à autrui », comme l’explique bien John Stuart Mill. Et la contrainte est légitime dans ce cas précis, lorsqu’un individu cause du tort à autrui, porte atteinte à sa personne ou à ses biens. La liberté négative n’a donc de valeur que dans la mesure où elle s’exerce avec une responsabilité morale et politique.
En termes de droits, on parlera de droits de faire quelque chose, de droits individuels, constitutionnels.
Exemples : le droit de propriété (ne pas être spolié), le droit de religion (ne pas être empêché de pratiquer un culte), le droit d’expression (ne pas être censuré)…
Exemple : la Déclaration des droit de l’Homme de 1789, la Déclaration d’indépendance américaine (liberté de recherche le bonheur sans être entravé) ou les amendements de la Constitution américaine.
Les libéraux, les conservateurs anglo-américains, parlent de liberté en ce sens négatif.
LA LIBERTÉ POSITIVE COMME EXTENSION DES MOYENS D’ACTION
Un second sens de la liberté apparait chez des auteurs pré-romantiques comme Rousseau et chez les socialistes : la liberté positive. Elle s’énonce en termes de capacités, de moyens.
Cette liberté répond à la question de savoir comment je peux étendre mon pouvoir d’action et atteindre mes objectifs. Dès lors je suis libre si je peux maîtriser mon action, si j’ai la capacité, à la fois morale, intellectuelle et matérielle, de réaliser mes choix.
On trouvait cette liberté chez les Anciens, au sens moral d’une volonté libre d’accomplir ce que la raison m’indique comme étant le bien. On est libre quand on maîtrise ses passions, quand on obéit à la raison. Mais à l’époque moderne, la liberté positive prend un sens plus politique et elle devient synonyme de justice sociale, dans le cadre d’un processus collectif.
En ce sens, un homme n’est pas libre s’il ne dispose pas d’un accès à l’éducation gratuite, à la santé gratuite, à un salaire minimum, etc. En termes de droits, on parlera de droits à, de droits matériels ou de droits sociaux, comme le droit au travail, le droit au bonheur, le droit à l’éducation, à la santé, au logement.
Isaiah Berlin suggère que cette liberté est celle que défend le marxisme. Quand les marxistes opposent la liberté matérielle (ou liberté réelle) à la liberté formelle (ou liberté abstraite), ils veulent dire que la vraie liberté est celle qui donne un pouvoir d’agir.
Bien évidemment cette liberté positive a un coût et ce coût doit reposer sur la collectivité. La propriété privée étant inégalement répartie, il faudra la taxer et redistribuer les revenus. Dès lors une société libre ne peut être qu’une société collectivisée, planifiée par un État central.
En termes de droits, on parlera de « droits à », de droits matériels ou de droits sociaux, comme le droit au travail, le droit au bonheur, le droit à l’éducation, à la santé, au logement. Étendre le domaine de la liberté positive consiste donc à élargir le champ des droits économiques et sociaux, les « droits à » quelque chose.
DEUX CONCEPTIONS DU RÔLE ET DE L’ACTION DE L’ÉTAT
La liberté négative fonde la critique du pouvoir et la revendication d’une frontière entre l’espace public et l’espace privé.
Ainsi selon Benjamin Constant, John Stuart Mill ou Alexis de Tocqueville, loin d’accroître la liberté, le transfert du pouvoir à la volonté générale souveraine ne fait que déplacer le fardeau de l’esclavage. Pour un individu, il n’y a guère de différence entre être écrasé par un gouvernement populaire, un monarque ou des lois répressives. Une doctrine de la souveraineté absolue, même au nom du peuple, est une doctrine de la tyrannie. Car les lois peuvent aussi opprimer.
Pour être libre, au sens négatif, je dois édifier une société dans laquelle il existera des limites que personne ne sera autorisé à transgresser, ce que permet le droit en général.
Comme l’écrit Benjamin Constant :
Il y a une partie de l’existence humaine qui, de nécessité, reste individuelle et indépendante, et qui est de droit hors de toute compétence sociale.
En revanche, la liberté positive fonde la revendication d’un pouvoir tutélaire. Le rôle de l’État est de donner à chacun la capacité d’exercer sa liberté, en combattant ce qui fait obstacle à celle-ci : l’inégalité, l’ignorance, la misère et la maladie.
Le risque, selon Isaiah Berlin, est qu’au nom de la liberté positive (assimilée de nos jours à la justice sociale), la puissance publique soit habilitée à s’immiscer dans tous les aspects de la vie du citoyen. En effet, le pouvoir de faire toujours plus (la liberté positive) séduit davantage les masses que l’imposition de limites sur l’action humaine (la liberté négative). Beaucoup préfèrent payer le prix de l’ingérence de l’État dans leur vie privée, plutôt que la responsabilité individuelle et le libre marché.
En conséquence, les libertés négative et positive sont donc généralement incompatibles : plus un parlement légifère pour faire progresser la liberté positive, plus la liberté négative se réduit.
L’HÉRITAGE CONTROVERSÉ DES LUMIÈRES
Selon Isaiah Berlin, cet héritage est ambigu, mélangé et trouble. Tous les grands systèmes philosophiques de l’époque moderne vont reposer sur certaines idées des Lumières mais vont les pousser à l’extrême, au point d’aboutir à l’exact opposé de ce que ces idées suggèrent au départ.
Certaines idées, bonnes en soi, comme la raison ou l’universel, vont être absolutisées et devenir les pierres angulaires de systèmes abstraits et totalisants.
C’est le cas de cet universalisme rationaliste et optimiste qui voit dans l’histoire un progrès nécessaire et indéfini vers une société juste, pacifique et heureuse ou l’homme serait réconcilié avec lui-même, ou le mal et l’ignorance auraient disparu (Hegel et Marx). Le progressisme est un avatar de cette croyance dans la nécessité historique et dans la perfectibilité indéfinie de l’Homme.
Pourtant, nous rappelle Isaiah Berlin, l’histoire est tragique. Elle est traversée de conflits entre des valeurs qui ne sont pas toujours compatibles entre elles. C’est pourquoi la réaction romantique au XIXe siècle, dans les arts, la culture mais aussi la philosophie politique, va prendre le contre-pied des Lumières pour exalter le pessimisme, l’irrationnel, l’émotion, la passion.
DEUX GRANDES CATÉGORIES DE PENSEURS : LES MONISTES ET LES PLURALISTES
Le monisme c’est l’idée que l’histoire a une cause unique et qu’une solution unique et définitive existe à tous les problèmes de l’humanité. Toutes les valeurs politiques – liberté, égalité, justice, prospérité, sécurité, etc. – sont compatibles. Une société idéale harmonieuse est possible.
Le pluralisme affirme qu’une société idéale et sans conflit n’est pas possible car les valeurs ne sont pas toutes compatibles entre elles. Davantage de justice peut conduire à moins de liberté ; davantage de sécurité peut conduire à moins de justice. Des compromis imparfaits sont donc inévitables.
IL EN RÉSULTE DEUX CONCEPTIONS RIVALES DE LA SOCIÉTÉ
D’un côté se trouvent les avocats du pluralisme, de la variété, d’un marché ouvert aux idées, un ordre des choses qui implique des conflits et le besoin constant de conciliation, un ordre qui est toujours dans une situation d’équilibre imparfait.
De l’autre côté se trouvent ceux qui croient que cette situation précaire est une forme de maladie chronique et provisoire puisque la santé consiste en l’unité, la paix, l’élimination de la possibilité même de désaccord, la reconnaissance d’une seule fin ou d’une série de fins non conflictuelles, seules rationnelles, avec le corollaire que le désaccord rationnel ne peut affecter que les moyens.
La conclusion de Berlin est claire : tout système de pensée totalisant est une prison qui aveugle.